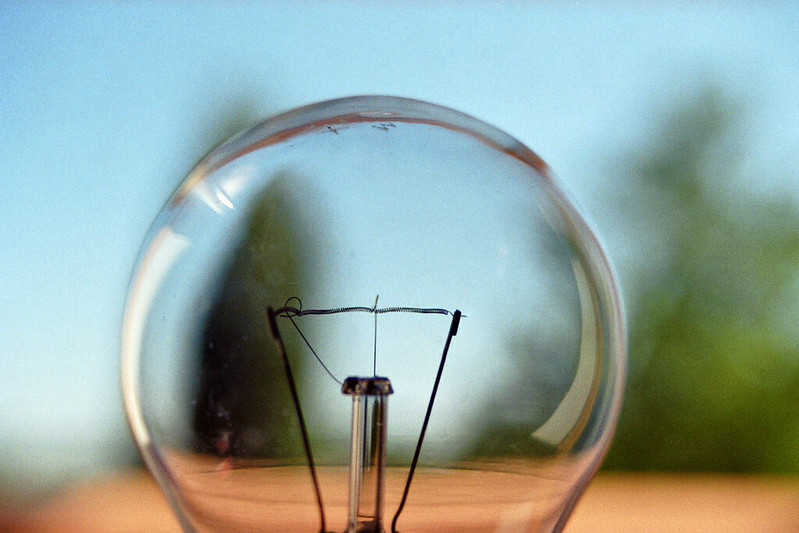Par Olivier Maurice.
Avec le procès des attentats de 2015, la réédition par Charlie Hebdo des caricatures et la tempête provoquée par la caricature de Danièle Obono, le débat sur la liberté d’expression s’invite ironiquement sur le devant de la scène, alors que la France encaisse sans vraiment broncher depuis six mois une cascade ininterrompue de privations de libertés en tout genre.
Comme d’habitude, tout ce que la France compte d’opposants déclarés et affichés au libéralisme en profite pour donner des leçons de liberté à la Terre entière, se succédant dans les divers médias en fanfaronnant et en s’élevant en messie sauvant le peuple élu de la tyrannie renégate.
Et comme d’habitude, le débat s’embourbe dans une magistrale confusion entre liberté de penser et liberté d’expression, entre liberté civile et liberté fondamentale. Toute cette marmelade permet bien évidemment aux uns et aux autres de dire comme à leur habitude tout et son contraire et de justifier leurs lubies, leurs manipulations et leur irresponsabilité au nom de la liberté.
Elle a bon dos la liberté.
Pourquoi ne pas plutôt inviter des libéraux à parler de liberté, plutôt que des admirateurs béats des pires totalitarismes meurtriers du siècle dernier ? Après tout, le libéralisme, prônant depuis plusieurs siècles la primauté des principes de liberté et de responsabilité individuelle sur l’autorité du souverain a du quand même accumuler quelques petites réflexions sur le sujet… Liberté d’expression
La liberté d’expression est une liberté civile, parce que son usage impacte le bon fonctionnement de la société. S’exprimer est un acte public, qui peut avoir des conséquences. Les mots ont un sens, un poids.
Les libertés civiles sont des libertés accordées par l’autorité et qui sont soumises à une règle de cohérence�: la loi. Le but d’avoir un ensemble de normes bien définies, établissant les libertés civiles comme les obligations civiles de chacun, est de permettre à l’autorité de remplir au mieux sa mission : protéger la société des prédateurs.
La liberté d’expression s’inscrit dans les normes sociales qui régulent la société, normes qui peuvent être différentes d’un lieu à un autre et d’une époque à une autre. Cette évolution permanente est bénéfique : elle permet à la société d’évoluer et de s’adapter. Elle est surtout inévitable : un mot qui était un compliment peut très bien se transformer en insulte au fil du temps.
Comme toute liberté, la liberté d’expression est indissociable de la responsabilité qui l’accompagne. C’est cette relation que doit expliciter la loi. Liberté de penser
Mais pour les libéraux, il existe des libertés qui dépassent celles accordées par la loi des Hommes. Ces libertés fondamentales, également nommées droits naturels, droits fondamentaux, droits inaliénables, sont accordées par la nature, par la vie elle-même. Ce ne sont ni plus ni moins que les possibilités offertes par le monde qui nous entoure et dont le respect est essentiel à la vie en bonne harmonie et au développement de la société.
La liberté de penser est une liberté fondamentale. Les individus naissent et vivent avec une conscience. Cette conscience, cette capacité de réfléchir et de répondre de ses actes est un don de la nature, indivisible de l’être humain et qui n’a nullement besoin des autres pour exister. Il est donc moral et juste de la protéger, ce qui est à la fois un droit et un devoir. Il est par conséquence immoral et répréhensible de la contraindre, de la manipuler, de l’encadrer sans le libre consentement de l’individu.
Comme il peut y avoir conflit entre liberté civile et liberté fondamentale, et afin d’éviter que l’autorité n’abuse de son pouvoir pour bafouer les secondes qui sont garantes des premières, il convient de déterminer les limites accordées au pouvoir.
Les libertés fondamentales ne définissent donc pas ce que les individus ont le droit de faire (la nature se charge elle-même d’imposer ces limites), mais elles impliquent l’établissement d’une Constitution compilant l’ensemble des règles, limitations, interdictions et obligations que doivent respecter ceux qui incarnent l’autorité afin que ces libertés fondamentales, et par voie de conséquence les libertés civiles, soient préservées.
La liberté de penser implique ainsi la stricte neutralité de l’autorité envers tous les modèles de croyance, coutumes, traditions, religions, athéisme compris. Elle interdit également à l’autorité d’user de contrainte pour définir ce que l’individu doit penser, ce qui est correct de penser. Un État juge et partie
Mais tout cela n’est que théorie. La réalité est très, très éloignée de ces principes, qui sont bien loin d’être respectés dans notre beau pays.
Force est de constater que la liberté de penser n’est dans la Constitution française qu’une vague idée fumeuse et que la réalité est encore pire que cela : la stricte neutralité de l’autorité envers tous les modèles de croyance, coutumes, traditions, religions est bien plus l’exception que la règle qu’elle est censée être. Entre :
* l’Éducation nationale unique, obligatoire et organisée par l’État ;
* le quasi-monopole public sur la culture et les musées ;
* l’Histoire, en particulier l’Histoire de France, établie et enseignée de façon uniforme ;
* l’interdiction d’usage et d’apprentissage des langues régionales et des patois ;
* la presse subventionnée ;
* les noyautages omniprésents des services de l’État par diverses idéologies ;
* les versions officielles du bien-être, du bien-vivre, du bien-manger, du bien parler…
* la morale républicaine enseignée à l’école.
L’État républicain et jacobin semble bien avoir remplacé l’Église d’antan par un catéchisme laïc, républicain, national et bien-pensant et investi une partie conséquente de son budget dans la mission d’évangélisation de la bonne parole officielle. Liberté et transgression
Il en est du même fiasco pour la liberté d’expression.
Non seulement elle est constamment confondue avec un pseudo-droit fondamental venu de nulle part : celui de dire n’importe quoi, peu importent les conséquences, et en se dédouanant de toute responsabilité ; mais elle est surtout constamment utilisée comme paravent à toute une batterie de contournements ayant pour but de faire du prosélytisme idéologique.
Lorsque l’État n’était pas omniprésent, la liberté d’expression trouvait ses bornes à l’aube et au bout d’un fleuret dans les fossés des remparts de la ville. La loi a remplacé le duel, et le petit jeu a alors consisté à faire interdire les arguments de l’adversaire afin de pouvoir le ridiculiser impunément.
Sortons quelques instants du jeu de postures dont personne n’est dupe. Si la liberté d’expression est aussi vaillamment défendue par tous les totalitaristes, c’est qu’elle leur sert clairement de couverture et leur permet de mener à bien leur agenda clientéliste en jouant sur la transgression ou en s’abritant derrière le « dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas ». Entre :
* l’anticléricalisme radical, caché derrière les parodies religieuses ;
* le racisme, caché derrière les discours anti-immigration ;
* la jalousie de classe, cachée derrière la dénonciation des inégalités ;
* la misanthropie et l’anticapitalisme, cachés derrière la préservation de l’environnement ;
* la revanche, cachée derrière la culpabilisation du passé et la repentance ;
* l’athéisme militant, caché derrière la défense de la laïcité.
La liberté d’expression sert bien plus souvent d’alibi qu’elle n’est réellement utilisée pour dire clairement ce que l’on pense. Liberté de quoi ?
Ne nous leurrons pas : dans un pays où l’éducation est normalisée et obligatoire, où l’histoire, la culture, les arts répondent de copinages et de subventions, où la presse ne survit que grâce à l’arrosage constant d’argent public, où la propagande nous explique sur toutes les ondes ce qu’il faut manger, ce qu’il faut aimer, comment il faut s’habiller ou se laver les mains… Dans un pays où la moindre interrogation devient du complotisme, la moindre observation du révisionnisme, la moindre envie de liberté de l’incivisme…
Dans ce pays fabuleux où la liberté de penser n’est que toute relative, que peut-on attendre de la liberté d’expression, à part un défouloir et un faire-valoir pour les politiciens en mal d’audience ?
Cela vaut-il vraiment la peine de s’étriper, où même de prêter la moindre attention au débat qui consiste à savoir s’il est fondamental d’avoir de droit de faire pipi-caca sur des symboles dans l’unique but d’avoir l’autosatisfaction de penser qu’on est en train d’embêter son voisin en lui montrant qu’on en a une plus grosse que lui ?
Faites-le, si ça vous fait plaisir. Ce n’est pas cela qui va sortir ce pays du carcan d’obligations et de restrictions que par ailleurs, vous prêchez tous les jours et à la moindre occasion. Ces articles pourraient vous intéresser: Liberté d’expression : ses défauts qu’il nous faut chérir Quand le camp de la tolérance dévore ses propres enfants Les libertés ne sont plus un droit mais une concession du pouvoir Lille : François Hollande censuré par l’extrême gauche
http://dlvr.it/RftKkf
jeudi 3 septembre 2020
La liberté par le marché, de Morris & Linda Tannehill
Par Francis Richard.
La liberté par le marché est paru il y a tout juste cinquante ans sous le titre The Market For Liberty. Le moins qu’on puisse dire est qu’il est toujours d’actualité : l’État était et demeure le problème de nos sociétés.
Ce livre n’est qu’un petit peu daté ici ou là parce qu’il a été publié avant certains événements tels que la fin de la convertibilité du dollar en or en 1971 ou la chute du Mur en 1989 et qu’il n’en tient pas compte, et pour cause. Le principe fondamental d’une société libre
Selon les auteurs de ce livre, la société vraiment libre, dont l’homme a besoin pour fonctionner avec le plus d’efficacité et de bonheur possible, repose sur un principe fondamental, la règle de base des relations humaines justes (toutes les autres règles en découlent: il n’est pas besoin de légiférer) :
Aucun homme ni groupe d’hommes (y compris tout groupe d’hommes se prétendant l’État) n’est moralement en droit d’initier l’usage de la force physique, la menace de force ou tout équivalent de la force (comme l’escroquerie) contre aucun autre homme ou groupe d’hommes.
Si un homme ou un groupe d’hommes initie la force contre un homme ou un groupe d’hommes, ceux-ci non seulement ont le droit, mais le devoir de se défendre :
Si un homme chérit vraiment ses valeurs, il a une obligation morale envers lui-même de les défendre. La nature spécifique de l’homme
L’homme a une spécificité : Afin de survivre, [il] doit penser. Penser lui permet en effet, en utilisant son esprit, de produire et en utilisant sa faculté de raison, de distinguer le bien, ce qui est pro-vie, du mal, ce qui est anti-vie :
Mieux il pensera, mieux il vivra.
Pour réaliser son plein potentiel, la société dans laquelle il vit doit le laisser en paix : il doit y être libre de penser et d’agir selon ses idées… sans que personne d’autre ne tente de le forcer à vivre selon�leurs normes :
Dès qu’un homme n’est pas libre de vivre paisiblement sa vie selon ses propres normes et de posséder pleinement ce qu’il gagne, il est esclave. Le droit naturel
Tous les droits sont des aspects du droit à la vie et sont le produit de la nature de l’homme et de la réalité. Ils ne peuvent qu’être individuels, car le collectif n’a aucune existence hors des individus qui le composent.
Le droit à la vie se traduit par une interdiction morale, celle d’interférer dans la vie de quiconque tant que ses actions sont non-coercitives. Si ce n’est pas le cas, comme vu plus haut, il est légitime de se défendre.
Tout homme a un droit sur sa propre vie : il la possède – il est son propre propriétaire – comme il possède chaque partie de sa vie. C’est pourquoi les auteurs disent que les droits de propriété sont les droits de l’Homme.
Une société vraiment libre est une société de laissez-faire : cela signifie la liberté pour chaque individu de gérer ses propres affaires comme il l’entend… pas juste dans le domaine de l’économie, mais dans tous les aspects de sa vie. Le marché libre et l’État
Le grand conflit entre liberté et esclavage, bien qu’il ait pris de nombreuses formes, trouve sa principale expression dans le conflit entre deux institutions humaines puissantes et opposées : le marché libre et l’État.
Qu’est-ce un marché libre, responsable de l’abondance, sinon un réseau d’échanges économiques volontaires ; il inclut tous les échanges volontaires n’impliquant pas l’usage de la coercition envers quiconque.
Si le marché est perturbé, son mécanisme d’autorégulation intégré ne fonctionne plus comme un système de signaux complexe, visible par tous et fiable, et ne permet plus d’accroître le bien-être humain.
Or, justement, l’État le perturbe avec la fiscalité et les dépenses, la réglementation et le contrôle de la monnaie et des banques, avec pour conséquences, comme le démontrent les auteurs, la pauvreté et le chômage. L’État malfaisant
L’État est un monopole coercitif qui a assumé le pouvoir et certaines responsabilités pour chaque être humain dans une zone géographique qu’il prétend être la sienne.
Alors qu’un monopole de marché ne peut empêcher la concurrence en utilisant la force physique, un monopole coercitif peut l’interdire ou l’autoriser de façon limitée. C’est là une grande différence.
Le but d’une entreprise privée est de faire du profit, en donnant satisfaction à ses clients : le profit est le signal du succès pour tout homme d’affaires opérant sur un marché libre. Il offre aux gens les choses qu’ils veulent.
Le but d’un politicien ou d’un bureaucrate est d’augmenter sa sphère de contrôle sur la vie d’autrui : le pouvoir est pour lui le signal du succès. Il se comporte comme un parasite qui prive les gens des choses qu’ils veulent par la saisie forcée de leurs biens (la fiscalité) ou par la réglementation :
Pour faire simple, l’État est le règne de certains hommes sur d’autres par la force initiée, ce qui est l’esclavage, qui est mal. Une société de laissez-faire
Les auteurs montrent dans le détail comment il serait logiquement possible de se passer d’État puisque celui-ci est malfaisant. Une société vraiment libre, une société de laissez-faire, serait une société où le marché libre remplacerait l’État.
Tous les domaines de la vie des individus pourraient être mis sur le marché libre et la sélection par eux-mêmes de ce qui est bien ou mal pour eux se ferait par la réputation, bonne ou mauvaise, qu’il s’agisse par exemple de l’éducation, de la médecine ou de la monnaie.
La propriété serait la solution à bien des problèmes, tels que la pollution ou la conservation des ressources naturelles : Une des différences les plus profondes d’une société de libre marché se verrait par le fait que tout ce qui a le potentiel d’être propriété serait possédé. Par exemple, il n’y aurait plus de propriété publique…
Les litiges seraient réglés par des agences d’arbitrage. La vie et les biens seraient protégés par des agences de protection. Les pertes causées à autrui, considérées comme des dettes, seraient remboursées par les agresseurs et les victimes seraient indemnisées autant qu’il est humainement possible etc. Comment parvenir à la société de laissez-faire
Est ancrée dans la culture de la majorité des hommes d’aujourd’hui que l’État est juste et/ou nécessaire. D’abord, leurs dirigeants le leur ont toujours dit, ensuite il y en a toujours eu un, enfin la liberté leur fait peur : c’est la peur d’être jeté seul face à un monde effrayant, sans personne qui dise quoi faire.
Il faut leur dire au contraire qu’il n’est pas un mal nécessaire, mais un mal inutile:
L’État, ce sont quelques hommes gouvernant (régnant sur) les autres par la force. […] Quand certains hommes règnent sur d’autres, il existe une condition d’esclavage, et l’esclavage est un mal en toutes circonstances. Préconiser un État limité, c’est préconiser un esclavage limité.
Il faut amener la majorité des gens à voir l’État pour ce qu’il est et à croire en la liberté. Car cela les conduira à une désobéissance passive de masse à des lois déraisonnables :
Nous pouvons amener à une société de laissez-faire, mais seulement grâce au pouvoir formidable et invisible des idées. Les idées sont la puissance motrice du progrès humain, l’énergie qui façonne le monde.
Morris & Linda Tannehill, La liberté par le marché, Résurgence, 252 pages (traduit par Stéphane Geyres et Daivy Merlijs).
—
Sur le web Ces articles pourraient vous intéresser: Pourquoi le libéralisme n’est ni le laisser-faire, ni le laisser-aller Messieurs Zemmour et Onfray, pourquoi nous déniez-vous notre droit naturel ? Libéralisme : oui, la théorie libertarienne est révolutionnaire ! « Contrôle de soi ou contrôle de l’État ? » sous la direction de Tom G. Palmer
http://dlvr.it/RftKkV
http://dlvr.it/RftKkV
La STEP : un trésor énergétique à (re)découvrir en France
Par Michel Gay et Serge Gil1.
Sous l’acronyme rêche et anodin de «�STEP » (station de transfert d’énergie par pompage) se cache un trésor : la possibilité d’absorber et de restituer beaucoup d’électricité à la demande, en quelques minutes, selon le besoin. Le miracle
Cette simple capacité est une prouesse remarquable car elle permet d’équilibrer le réseau électrique et d’augmenter la part de production d’électricité décarbonée (nucléaire et énergies aléatoirement variables ou intermittentes comme les éoliennes et les panneaux solaires) dans le mix énergétique.
Une STEP transfère de l’eau par pompage d’un réservoir bas vers un réservoir haut lorsque la production est momentanément supérieure à la consommation et que le prix de marché est bas. Ensuite, son turbinage (production d’électricité à travers une turbine) peut répondre au besoin lorsque l’électricité est rare et chère.
C’est la seule technique de stockage d’énergie à grande échelle dont la disponibilité permet de délivrer sur le réseau électrique une puissance équivalente à un ou deux réacteurs nucléaires (jusqu’à presque 1800 MW pilotables) en quelques minutes, et pendant quelques heures. Elle répond au besoin fluctuant de la consommation journalière en lissant les productions fatales des énergies renouvelables et en optimisant la production nucléaire.
Une STEP constitue donc un facteur essentiel de la stabilité du réseau d’électrique tout en évitant l’utilisation d’énergies fossiles polluantes. Pourquoi s’en priver ?
À ce jour, EDF exploite en France seulement 6 STEP représentant une puissance totale de 5000 mégawatts (MW). La plus grande STEP (Grand’maison), qui a un dénivelé de 1000 mètres, demande 1275 MW en pompage et produit 1790 MW en turbinage. La puissance d’un réacteur nucléaire de dernière génération (EPR) est de 1660 MW.
Ces chiffres sont à relativiser avec les 25 000 MW installés d’hydroélectricité dont 12 000 MW sont modulables avec une capacité de démarrage de 3 à 15 minutes.
Par comparaison, le parc de production électrique français a une capacité totale de l’ordre de 120000 MW, dont 61 000 MW de nucléaire.
Les STEP sont de plus en plus utiles dans un système électrique qui développe des énergies intermittentes électriques car leurs productions fatales, brutales et aléatoires nécessitent des centrales de compensation rapide à gaz, y compris à l’étranger (importations).
Selon le rapport Quinet de 2019 sur la valeur du CO2, « donner une valeur monétaire à l’action pour le climat, c’est signaler que les activités humaines doivent intégrer les bénéfices collectifs que procure la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C’est se donner une référence pour sélectionner et hiérarchiser les actions utiles à la collectivité ».
Or, EDF semble tergiverser en France alors que d’autres pays en construisent.
La PPE 2019-2028 estime que « l’hydroélectricité pourrait contribuer de manière décisive à répondre au besoin de flexibilité du système électrique, notamment grâce aux STEP » et envisage d’accroître la puissance totale des STEP de 1500 MW d’ici 2035 mais, paradoxalement, EDF hésite. Après avoir tergiversé pendant des années, elle a annoncé en mars 2018 prévoir d’autres STEP… restées à ce jour à l’état de projet, à l’exception de quelques modernisations. Où construire des STEP ?
Le rapport Dambrine avait identifié en 2006 plusieurs sites potentiels, notamment en Savoie et le long de la Durance.
Les STEP nécessitent un dénivelé important et un gros débit d’eau. Presque toutes les STEP disposent d’un réservoir haut constitué par la retenue principale d’un barrage d’altitude et un petit réservoir bas en vallée.
Mais l’inverse est aussi possible : un réservoir principal « en bas » et un « petit lac » réservoir de quelques millions de m3 « en haut ».
De nombreux grands lacs « bas », naturels ou artificiels, existent en France. Plus rares sont ceux entourés de hautes montagnes capables d’accueillir un petit réservoir « haut » à distance raisonnable avec un grand dénivelé d’environ 1000 mètres.
L’immense lac artificiel de Serre-Ponçon au confluent de la Durance et de l’Ubaye en fait partie. Il est situé à 780 m d’altitude avec quelques cuvettes naturelles proches et plus de 1000 m de dénivelé, dont le cirque de Morgon.
Le cirque de Morgon (voir carte), offre des conditions intéressantes d’aménagement.
Ce site de plus de 300 hectares (ha) à 2000 mètres d’altitude pourrait accueillir une retenue d’environ 25 ha (un carré de 500 mètres de côté, vide d’habitants) et 12 mètres de profondeur moyenne, correspondant à un volume d’eau (3 millions de m3) susceptible d’être pompé en quelques heures depuis le lac « bas » de Serre-Ponçon.
Ce dernier, d’une superficie de 28 km2, verrait son niveau varier d’environ 10 centimètres en cas de vidange ou de pompage complet (sa variation saisonnière dépasse 40 mètres), sans aucun impact sur la flore et la faune puisque l’eau pompée est restituée intacte.
Ce site permettrait de fournir une puissance de plus de 1500 MW (comparable à la STEP de Grand’maison), soit plus de 4 fois la puissance de l’usine électrique du barrage de Serre-Ponçon pendant 5 heures ! Est-ce intéressant et rentable ?
Les STEP présentent un intérêt croissant pour assurer l’équilibre du système électrique mais leur futur bilan économique reste incertain compte tenu du prix bas du pétrole (autour de 40 euros par baril) et du gaz. Ces énergies fossiles importées alimentent à bas coût des turbines à combustion (TAC), un autre moyen flexible de production d’électricité concurrent des STEP, bien que polluant et émetteur de gaz à effet de serre.
Mais au-delà d’un prix de marché de 65 euros/MWh dans les cas de forte demande (en heure de pointe), la production de STEP est moins chère que la consommation de pétrole
Les premières grandes STEP datent du début des années 1970. La réglementation du marché de l’électricité par les pouvoirs publics conférait alors à ces investissements une visibilité quant à leur rentabilité sur le long terme.
Aujourd’hui, avec la disparition du monopole d’État et l’ouverture des marchés européens de l’électricité à la concurrence, l’absence de visibilité compromet de futurs investissements en l’absence de mesures correctrices. Le développement des STEP a donc été stoppé à la fin des années 1980.
Les produits d’exploitation d’une STEP proviennent de la vente de l’électricité turbinée, mais aussi de la rémunération des différents services rendus au système électrique qui doivent être valorisés à leur juste valeur.
Car une STEP nécessite un investissement important sur le long terme.
Le coût de construction de la STEP de Nant de Drance près de Martigny en Suisse, qui sera inaugurée en décembre 2021, et d’une puissance comparable à celle de Grand’maison, a été évalué à environ 2 milliards d’euros avec des longueurs de galeries de 14 km (au lieu d’environ 4 km pour l’exemple du cirque de Morgon à Serre-Ponçon).
La STEP paye le Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité (TURPE) deux fois : une première fois pour l’électricité nécessaire au pompage, une deuxième fois pour la production lors du turbinage. Son taux a donc été logiquement diminué de 50 % pour les STEP en 2016, passant de 20 % à 10 %.
S’ajoutent ensuite les frais de fonctionnement et d’amortissement, et les pertes d’environ 25 % sur l’électricité « pompée » (la STEP restitue 75 % de l’électricité absorbée).
La majeure partie des frais de fonctionnement d’une STEP provient de la fourniture de l’électricité nécessaire au pompage.
Dans le cas de l’exemple du cirque de Morgon, il s’agirait d’environ 1800 gigawattheures par an (GWh/an) en pompage. La production du turbinage serait d’environ 1400 GWh/an d’électricité « propre » (deux fois plus que l’usine électrique de Serre-Ponçon) mobilisable en quelques minutes, améliorant ainsi la sécurité d’approvisionnement de la France entière.
Les lignes de transport capables d’évacuer la puissance de 1500 MW existent déjà en 230 000 volts
Tous les coûts doivent être compensés par la différence de prix entre l’achat pour le pompage et la vente lors du turbinage ainsi que par la rémunération de la plus-value de sa disponibilité pour l’équilibre du réseau.
Si l’électricité consommée au pompage provient régulièrement de sources dont le coût de fonctionnement est pratiquement nul (nucléaire) ou déjà payé par des subventions (énergies renouvelables électriques), non seulement la production d’une STEP devient rentable mais, en plus, elle rentabilise aussi d’autres moyens dont le coût de fonctionnement est marginal.
Par exemple, le coût global d’un réacteur nucléaire en fonctionnement à pleine puissance ou à l’arrêt est quasiment identique car l’usure du combustible est négligeable et les principaux coûts sont fixes (personnel, amortissement…). Il est donc préférable qu’il produise de l’électricité… quitte à la stocker « intelligemment ». Une énergie « intelligente »
Les installations hydroélectriques, dont les STEP, peuvent redémarrer seules sans nécessiter d’apport externe d’électricité. Elles constitueraient ainsi les premiers moyens remis en fonctionnement après une coupure généralisée du réseau afin de le « reconstruire ». Ainsi, progressivement, des moyens de production ajoutés successivement alimenteraient une zone géographique et, de proche en proche, toute la France.
En absorbant et en produisant rapidement de grandes quantités d’électricité, les STEP contribuent à égaler en permanence la production et la consommation pour maintenir le fragile équilibre du réseau électrique. Ce point important doit être valorisé.
Relancer le potentiel hydroélectrique de la France, notamment les STEP, constitue un enjeu majeur d’indépendance énergétique et d’économies d’importations de gaz et de pétrole pour contribuer à la politique énergétique définie par la Loi sur la Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) votée le 22 juillet 2015. Mais… il y a plusieurs « mais »…
1) Aujourd’hui, EDF est contraint par des lois européennes de mettre sur le marché les concessions de tous ses ouvrages hydrauliques. La durée maximale des concessions serait de 75 ans et pourrait être ramenée à moins de 40 ans. La rentabilité n’est donc pas assurée.
Dans ces conditions, les candidats à de nouveaux investissements dans des ouvrages prévus pour durer plus de 100 ans se font rares.
2) Les écologistes politiques veulent bien d’un stockage pour les excédents des énergies renouvelables mais ils craignent de favoriser le nucléaire… et aussi de noyer des espaces verts ! (voir l’émotion suscitée par la retenue de 34 ha qui était prévue à Sivens).
3) La politique énergétique actuelle est incohérente : EDF annonce un plan de stockage électrique en mars 2018, mais le 13 mars 2019, un rapport du Conseil Général de l’Économie intitulé « Stockage stationnaire d’électricité » indique que « le caractère très limité en France du potentiel de déploiement de nouvelles STEP hydrauliques ne permet pas de mobiliser cette solution pour notre pays ». Comprenne qui pourra… Un trésor à (re)découvrir
Le titre de cet article a été inspiré par un enfant de 5 ans qui, en regardant avec l’auteur de cet article la carte du projet de STEP à Serre-Ponçon (en annexe), a demandé : « Tu cherches un trésor ? ».
Réponse : « Oui, un trésor qui absorbe et produit sur demande beaucoup d’électricité avec de l’eau ! »
Les hommes politiques fascinés par ce qui brille devraient aussi s’intéresser aux vertus de l’hydroélectricité, et particulièrement aux pépites des STEP. Cet or blanc produit une électricité renouvelable adaptable au besoin pour assurer l’équilibre du système électrique français et européen.
L’hydroélectricité devient aujourd’hui une composante incontournable d’une politique de renforcement de la sécurité d’approvisionnement et de lutte contre l’effet de serre. Elle constitue par excellence l’énergie du développement durable.
La France, dans le Plan Climat de juillet 2017, s’est elle-même fixé l’objectif « zéro émissions nettes » (ZEN) de gaz à effet de serre à l’horizon 2050. La valeur du carbone évité doit être utilisée dans les évaluations d’investissements et plus généralement dans les politiques publiques comme un levier d’action nécessaire à la réussite des objectifs de ce Plan Climat.
Alors,
* pour respecterl’impératif de sécurité d’approvisionnement (Art. 100-1 2° du Code de l’énergie),
* pour diminuer l’importation d’énergies fossiles et les émissions de CO2,
* pour renforcer la stabilité du réseau électrique malmené par les productions erratiques des éoliennes et des panneaux photovoltaïques, ainsi que par les fortes variations de consommation,
* pour améliorer l’emploi avec du personnel local et du matériel français (pompes, turbines, travaux…)
la puissance publique pourrait (re)découvrir les avantages de ces trésors énergétiques « intelligents » et initier la construction de nouvelles STEP.
* Serge Gil est ingénieur hydraulicien de formation et a principalement travaillé au CEA. ↩
Ces articles pourraient vous intéresser: Électricité : faut-il s’inquiéter d’un possible black-out ? Le commerce honteux des indulgences renouvelables La PPE ignore que la France n’est plus une nation industrielle Le virus rend encore plus fou un marché de l’électricité qui l’était déjÃ
http://dlvr.it/RftKhY
http://dlvr.it/RftKhY