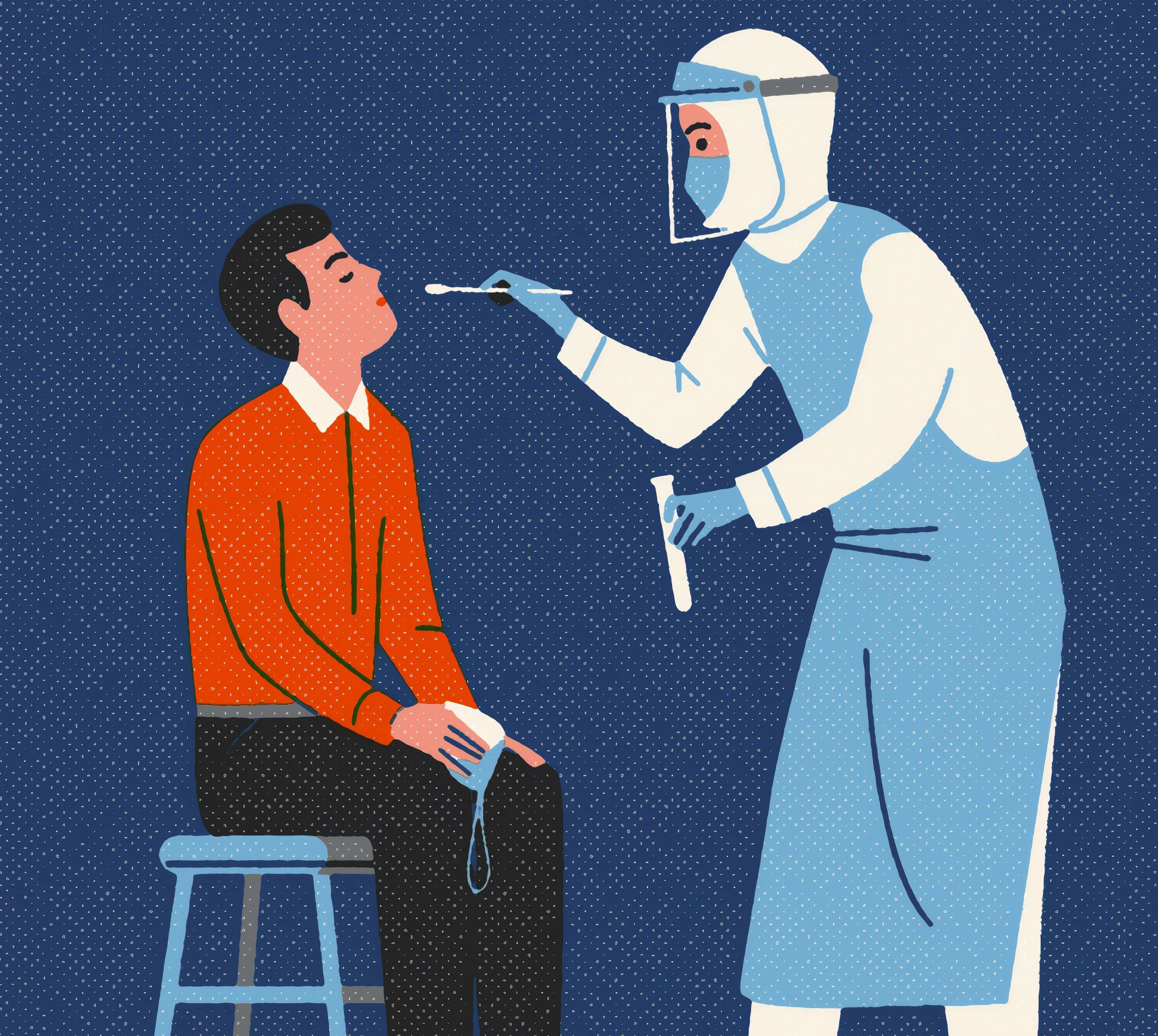Par Christophe de Brouwer.
La virulence du Covid-19, son caractère pathogène, est-elle en train de diminuer ? À constater la dissociation dans le profil des courbes entre ceux testés positifs, et celle de ceux en soins intensifs ou celle des décédés, la réponse apparaît positive.�
D’ailleurs, lorsqu’on observe les données mondiales publiées par worldometer, on voit une augmentation continue de cas testés positifs depuis la mi-mai et un taux de mortalité relativement stable. Mais est-ce significatif d’une augmentation réelle des personnes infectées ?
Il est possible que l’une des raisons est l’amélioration des traitements. Une autre raison avancée est la diminution de la virulence. La virulence du Covid diminue
Généralement, on observe une virulence très forte au début d’une épidémie, puis elle diminue au fur et à mesure de celle-ci. On a avancé l’explication d’une immunité croissante dans la population, mais ce n’est pas crédible avec en moyenne 10 % de la population européenne immunisée aujourd’hui contre ce Covid.
Par ailleurs, clairement, cette épidémie-ci est une épidémie saisonnière dite en cloche dans nos régions tempérées nord, alors qu’elle est endémique plus on se rapproche des régions intertropicales ; mais les raisons en sont inconnues. Beaucoup d’explications sont avancées, mais sans beaucoup de fondements scientifiques.
Donc la diminution intrinsèque de la virulence est une explication possible mais pas unique.
À quoi serait dûe cette diminution de virulence ? C’est très complexe et faire simple ne sera pas simple !
J’ai toujours été impressionné par l’écologie des trypasonomiases africaines (maladie du sommeil). La gabiensé (trypanosomiase d’Afrique de l’ouest) est une infection d’évolution lente, alors que la rhodiensé (celle de l’Est) est une infection brutale tuant le bétail et l’Homme, rendant des régions africaines désertes en hommes et en bétail, sans pour autant provoquer la disparition du parasite ni le rétrécissement de sa zone géographique ; ceci, avant que l’on ait assaini le milieu, ce qui a libéré le milieu du parasite. Il n’y a donc pas qu’un équilibre, un trade-off (voir ci-après), à prendre en compte pour une épidémie donnée. La critique du modèle du troc, trop simpliste
Il existe un modèle de transmissibilité souvent mis en avant, sur lequel beaucoup de nos épidémiologistes se basent dans l’analyse de la crise présente, modèle du reste fort critiqué, à juste titre, pour son simplisme, c’est le modèle trade-off, ou modèle du troc.
Pour évaluer un taux de reproduction (RO), ce modèle propose un équilibre entre transmissibilité, l’importance des hôtes susceptibles (densité, hôtes naïfs, etc.), la mortalité de l’hôte (naturelle et liée à l’infection), le taux de guérison. Vous avez d’ailleurs ces différents éléments être proposés sur différents sites internet.
L’hypothèse défendue est que la sélection naturelle va progressivement placer le virus dans un équilibre maximalisant sa reproduction. Cet équilibre se trouve en général pour une virulence plus faible que celle du début de l’épidémie.
Mais ces modèles ne mènent pas à grand-chose, sinon des modèles sur des modèles et des déclarations, d’ailleurs contradictoires entre eux, de nos trop fameux experts.
Pour répondre aux critiques du modèle trop simpliste on a proposé plusieurs trade-off (!) pour une même épidémie : encore des modèles sur des modèles. Soyons sérieux, les éléments influençant une épidémie sont très nombreux, comme l’activité d’un malade fiévreux : en général il reste au fond de son lit et ne transmet pas grand-chose !
Et puis que dire des épidémies saisonnières de nos zones tempérées qui ne répondent à aucun trade-off, le virus va vers sa propre extinction et non vers un équilibre. Et pourtant fréquemment nos experts s’ingénient à l’utiliser, ou un dérivé, pour deviner ce qui va se passer avec le Covid-19.
Sur cette fiction, ils nous prédisent un rebond et une deuxième vague. Ils nous donnent cette impression désagréable que pire c’est mieux. Nous sommes face à une instrumentalisation scientifico-politico-médiatique de modèles de type trade-off, alors qu’il n’est pas applicable dans notre situation. Observer le réel
Une fois de plus, nous devons surtout observer le réel. Tant mieux.
Et ce qu’on observe est une réduction de la virulence à travers un taux de mortalité toujours plus bas : l’analyse de l’épidémie réalisée par Nicolas Lewis pour la Suède est passionnante et nous propose un taux de létalité aujourd’hui bien inférieur à 0,1 %.
Vous allez, avec plein de bonne foi, me dire que l’observation me donne tort. Au sud des USA, l’épidémie flambe. Mais est-ce bien une épidémie ? N’avons-nous pas affaire, là -bas, à une endémie ?
Examinons le cas de la Floride aux USA, emblématique de cette « flambée ».
Cet État se situe au niveau du Qatar, nous sommes proches des zones intertropicales. Si nous comparons la date du 1er juin à celle du 15 juillet, nous observons une augmentation des cas testés positifs d’environ 15 fois, mais nous savons que c’est avant tout lié à une augmentation importante des tests pratiqués. En comparaison, on observe apparemment une augmentation modérée, multipliée par deux, des hospitalisations et des décès. Les données sont tirées des Tallahassee Reports publiés par le Florida Department of Health.
Pour les décès, nous observons grosso modo actuellement 90 décès par jour contre 45 à la mi-mai, pour cet État comptant 21,5 millions d’habitants, soit proportionnellement, dix fois moins que le sommet de la courbe de décès en France, ou 14 fois moins que celui du New Jersey dans le nord des USA. Sachons mesure garder.
La rupture du modèle épidémique dans cet exemple-ci, qui se répète pour d’autres États du sud, par rapport au nord, est spectaculaire.
Nous sommes là -bas, bien au sud, dans un modèle endémique bien plus qu’épidémique à plus faible intensité, jusqu’à dix fois moins importante que le sommet des cloches épidémiques des États du nord, endémie qui connaît actuellement des phases de regain et de déclin, et probablement une virulence qui décroît progressivement.
Revenons chez nous.
Notre épidémie ne se distingue donc pas, dans son aspect épidémiologique général, des épidémies saisonnières. C’est ce constat qui est raisonnable, il n’y en a pas d’autres.
Que le virus ait perdu de sa virulence, c’est cohérent. Mais ce qui est également important, c’est de comprendre la forme en cloche de la structure épidémique au cours du temps (saisonnière), qui ne connaît aucune exception dans les zones tempérées nord, quelles que soient les mesures de lutte prise (confinement ou non, masque ou non, traitement à l’hydroxycloroquine ou non, etc.).
Nous ne devons certainement pas craindre une ré-augmentation globale des cas de malades (hors période saisonnière) et de décès, à supposer qu’il y en ait une. L’épidémie est derrière nous.
Cependant, de façon itérative, causée par des cas isolés, généralement revenant de zones endémiques, l’infection peut encore se transmettre petitement à l’intérieur de cellules, notamment familiales, où les contacts sont fréquents et étroits mais qui n’a aucune tendance à la dispersion, tant la capacité du virus à se transmettre sous nos cieux est devenue faible. Ceci est très banal.
Ayons confiance dans notre avenir. Ces articles pourraient vous intéresser: Port du masque : une hystérie collective ? Ségur de la Santé : la réforme passe par la dé-bureaucratisation Les multiples agences de sécurité sanitaire contre le système de santé Traitement du Covid-19 : le bal des hypocrites
http://dlvr.it/Rc2Ry9
mardi 21 juillet 2020
La République otage des hauts fonctionnaires ?
Par Claude Robert.
Sans doute faut-il penser que se débarrasser de ce « Premier ministre bis�» était un véritable exploit car Le Monde a titré ce jeudi : « Comment Castex a obtenu le départ de Marc Guillaume, énarque faiseur de rois et coupeur de têtes ». Et d’ajouter, en sous-titre, que ce secrétaire général était pourvu d’un « rôle jugé démesuré par certains ».
Considérablement riche, tant d’un point de vue du contenu manifeste que du contenu masqué, cet article (Le Monde 16/07/20) suggère en effet que :
* ce changement de secrétaire général revêt une importance toute capitale. À coup sûr, le cours de la fin du quinquennat en sera transformé, puisque tel est le message que veut faire passer Matignon ;
* même au plus haut niveau de la hiérarchie gouvernementale, l’organigramme officiel se trouve en butte à un sociogramme1, une espèce d’organigramme parallèle dont la puissance s’apparente à celle d’un véritable cabinet fantôme ;
* les personnalités priment sur la politique gouvernementale, celle-ci n’étant finalement qu’un terrain de jeu pour des individualités issues d’un même sérail, celui des hauts fonctionnaires.
Un changement de tête pour faire croire à un changement de politique
Ce serait un horrible crime de lèse-majesté que d’accuser Le Monde de recopier les communiqués de presse du gouvernement. Pourtant, sans sourciller, le journal reproduit cette magnifique profession de foi de Matignon : « Le nouveau chemin tracé par le président, la nouvelle méthode et les priorités affirmées par le Premier ministre, entraînent aujourd’hui des changements à tous les étages ».
Idem dans cette autre partie de l’article : « C’est le Premier ministre, Jean Castex, qui aurait obtenu le ‘scalp’ de Marc Guillaume, assure-t-on volontiers dans les allées du pouvoir. Une manière pour le nouveau chef du gouvernement et son directeur du cabinet, Nicolas Revel, de poser leur autorité d’emblée, tout en se donnant toute latitude pour imprimer leur marque Rue de Varenne ».
Plus surréaliste encore, on peut lire un peu plus loin : « Macron a voulu mettre fin au centralisme, au jacobinisme, à cet entre-soi énarchique, observe un familier de l’Élysée. Pour cela, il envoie balader le représentant de l’establishment. C’est courageux ».
Tout juste si les problèmes du président ne prennent par leur source chez ce secrétaire général du gouvernement à cause de sa « rigidité pendant le confinement et sa gestion technocratique de la crise sanitaire » (sic). On croirait lire un communiqué de presse de l’Élysée taillé sur mesure autour du bouc émissaire idéal !
Ainsi, force est de constater que l’article retranscrit mot pour mot, au premier degré donc, les déclarations officielles, déclarations dont le but n’est pourtant que de parer ce changement de personnes de toutes les vertus possibles. Imaginons que les sources proches du pouvoir aient raconté exactement l’inverse. On peut craindre que la teneur de l’article en ait été toute différente…
Ne soyons donc pas aussi candides : malgré les 65 semaines d’émeutes des Gilets jaunes, le gouvernement Macron n’a aucunement infléchi sa politique, continuant contre vents et marées à servir ses propres intérêts. Quelle tristesse de constater que le Grand débat n’a accouché que d’une Convention pour le Climat, dans des conditions d’ailleurs statistiquement et donc démocratiquement douteuses !
Aucune convention pour la réforme de l’État, aucune convention pour la baisse des prélèvements obligatoires, aucune convention pour l’assouplissement du Code du travail n’a été évoquée un seul instant, malgré les urgences économiques et sociales du pays !
Comment un journaliste du Monde peut-il donc laisser supposer qu’un simple changement de secrétaire général du gouvernement pourrait infléchir quoi que ce soit ? Est-ce que le journaliste a écrit cela tout simplement parce que tel était le souhait de l’Élysée ou de Matignon ? La question est grave. Mais elle se pose inévitablement. Une organisation de fonctionnaires tiraillée par les luttes internes de pouvoir
Qu’elle soit une entreprise ou une administration, toute organisation digne de ce nom se profile dans l’optique d’atteindre le plus efficacement possible les objectifs qu’elle s’est assignée. Ceux-ci constituent sa feuille de route et chaque membre de l’organisation participe quotidiennement au respect de celle-ci, quelle que soit sa fonction et sa position. L’organigramme dans son ensemble est dévolu à cette tâche, gage d’une efficacité maximale.
Sur ce sujet, le nombre de témoignages cités dans l’article parait un peu plus consistant, et laisse pantois quant à cette guerre de tranchée quotidienne entre l’organigramme officiel et le sociogramme réel :
« ‘Le Léviathan’ , ‘Dieu’, ‘Premier ministre bis’, ‘Imperator’, ‘Monsieur non’… Marc Guillaume a accumulé les surnoms ces dernières années […] Le SGG, qui se trouve au cœur de la machine à arbitrer les décisions du quotidien, a surtout un rôle-clé de conseil juridique du gouvernement […] C’est celui qui souffle au politique ce qu’il est possible de faire ou non. Celui qui prépare le conseil des ministres puis rédige le compte rendu, auquel personne ou presque n’a accès. Qui relit, voire réécrit, les projets de loi avant de les envoyer pour avis au Conseil d’État. Ou encore qui propose des noms pour diriger les administrations ou occuper les plus beaux postes de la République. Il a droit de vie ou de mort administrative sur toi, glisse un directeur d’administration centrale. C’est à la fois un faiseur de rois et un coupeur de têtes. La personnalité de l’occupant du poste joue beaucoup ».
En comparaison d’une organisation qui se respecte, le gouvernement français ressemble donc beaucoup plus à un navire sur le pont duquel plusieurs capitaines se sont déclarés et s’affrontent sans relâche. Pour une raison ou pour une autre, ceux-ci ne partagent ni la même destination ni le même calendrier.
Il y a certes un capitaine officiel, mais de toute évidence, certains rivaux clandestins et recrutés bien avant lui2 veulent également tenir la barre et orienter le gouvernail.
On imagine combien la trajectoire finale du navire gouvernemental n’est que la résultante des tiraillements dans un sens puis dans l’autre. Et on découvre combien est grand, pour ce navire surchargé, le risque de faire des cercles dans l’eau. L’État, terrain de chasse du sérail de la haute fonction publique
Ce que ne dit pas l’article non plus, c’est que le secrétaire général du gouvernement qui remplace le précédent tant décrié provient du même cheptel : la prestigieuse ENA, l’école du pouvoir qui façonne depuis 1945 le profil de nos dirigeants. Moins glorieux aussi : l’école qui administre depuis la fin des années soixante-dix le puissant déclin économique de notre pays.
Une simple visite sur le site de Contrepoints montre l’effroyable casse que les décisions de nombreux diplômés de cette école ont pu provoquer, plombant voire même désintégrant des pans entiers de notre industrie. Pourquoi changer une équipe qui perd ?
Tandis que le président Macron avait émis le souhait de fermer cette matrice diabolique, la cooptation bat son plein. Ses clones administratifs trustent les postes et remplacent ceux qui s’en vont.
Pourtant, rien ne justifie de donner les clés du pouvoir d’un pays mal armé contre la concurrence internationale à des fonctionnaires dont pratiquement aucun n’a été formé et aguerri au sein de l’univers compétitif de l’entreprise.
Sans doute est-il nécessaire de le rappeler : l’entreprise est le haut lieu de la création de richesse d’un pays, l’unique endroit voué au culte de l’efficience. Qui pourrait donc remettre sur les rails un pays dont les parts de marché industrielles mondiales ont fondu de moitié en une vingtaine d’années ? Certainement pas des ronds de cuirs !
La persévérance d’une telle rente de situation est révélatrice du blocage de la société française en son sommet. Cela semble certes iconoclaste de le dire, mais l’Hexagone est dirigé par une caste de clones dont le profil administratif n’est absolument pas taillé pour enrayer notre déclin économique et social.
Pire encore, cette caste bénéficie d’une telle situation de domination qu’elle peut se maintenir au pouvoir indépendamment de ses ratages et de son train de vie. Elle s’offre même le luxe de s’affronter au sein de cet immense terrain de jeu qui s’appelle l’État, au frais du contribuable bien sûr, et avec l’aval de bon nombre de médias !
—
Sur le web
* Sociogramme : organigramme bis, non officiel mais opérationnel dans l’activité d’une organisation, basé sur des relations personnelles, sur des intérêts communs, ou sur des appartenances à des groupes spécifiques qui ne coïncident pas avec l’organigramme officiel et son fonctionnement normal. ↩
* Le secrétaire général du gouvernement évincé avait été recruté par Manuel Valls, soit plusieurs années avant l’arrivée du gouvernement Macron-Philippe puis Macron-Castex. Ni lui ni sa remplaçante n’ont été élus. Ils sont inconnus des citoyens. ↩
Ces articles pourraient vous intéresser: Jean Castex, l’homme des « territoires » au secours de Jupiter Gouvernement Castex : pas de rupture mais une surprise Remaniement de façade et continuité socialiste Macron : enfin seul, enfin roi
http://dlvr.it/Rc2Rxp
http://dlvr.it/Rc2Rxp
La France s’appauvrit
Par Eddie Willers.
Les Français ne s’en rendent peut-être pas tous compte mais leur pays est en voie de paupérisation. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder l’évolution du PIB par habitant depuis une quinzaine d’année et le comparer à ceux de nos voisins. Nous sommes plus pauvres par habitant que l’Allemagne, que la Belgique et depuis récemment que la moyenne de la zone euro :
PIB/habitant 2005-2019
Source : OCDE
Alors qu’une démographie dynamique devrait soutenir la création de richesses, nous remarquons que pour notre pays, celle-ci apparaît comme fortement limitée. Cela est dû à un point évoqué précédemment qui est celui de la faible croissance française, en particulier lors de la dernière décennie. La crise du Covid-19 n’arrangera évidemment pas cette tendance de long terme.
À cette création de richesse insuffisante, nous ajoutons des niveaux de redistribution très élevés et cela peut paraître surprenant, au profit de populations disposant parfois déjà d’un haut niveau de capital : les retraités. Nous nous retrouvons donc dans une situation où les forces productives du pays sont désintéressées à la création de richesse et appauvries par des niveaux de transferts très élevés.
Il en résulte des situations ubuesques où il est presque impossible pour un cadre faisant partie des 10 % des plus hauts revenus du pays d’acheter un appartement à Paris sans un apport très significatif. L’anti-syndrome de l’île de Ré
Nous faisons donc face à ce que j’appellerais l’anti-syndrome de l’île de Ré, en référence aux pêcheurs habitants de cette île dont les revenus étaient faibles mais le capital important du fait de l’appréciation de la valeur de leur maison.
Aujourd’hui il est devenu beaucoup plus difficile pour des cadres faisant partie du décile le plus élevé de la population d’acquérir un patrimoine immobilier comparativement aux générations précédentes.
Ce patrimoine immobilier n’est évidemment pas détenu par les jeunes populations mais essentiellement par les retraités de la génération des baby-boomers. Le Washington Post avait d’ailleurs publié en décembre dernier une infographie très éclairante montrant le pourcentage total des richesses détenues au même âge par les générations baby-boom, X et Y. La différence est sans appel :
Pour le graphique suivre le lien
De nouveau, la crise du Covid-19 impactera massivement les plus jeunes générations tandis que les retraités dont le niveau de revenu est garanti ne seront pas impactés. En France le niveau de vie des retraités pourrait d’ailleurs atteindre 110 % de celui de la population active d’ici la fin de l’année. Les créateurs de richesse de ce pays se constituent donc bien plus difficilement un patrimoine financier que les retraités actuels.
Ajoutez à cela des règles d’urbanisme délirantes et vous obtenez des prix de l’immobilier qui augmentent de façon extraordinaire, en particulier dans les métropoles où se concentre l’activité économique du pays. Le patrimoine des retraités grandit donc tandis que les primo-accédants rencontrent toujours plus de difficultés à acheter.
Faire partie du dernier décile de revenus de la population française ne garantit plus la constitution d’un capital car la France est un pays qui s’appauvrit sous le poids de ses transferts sociaux et de ses réglementations délirantes.
—
Sur le web Ces articles pourraient vous intéresser: Coronavirus : l’enjeu n’était pas de choisir entre les vies ou l’économie Déconfinement et mobilité : certains préparent le jour du pire plutôt que le jour d’après Covid-19 : la mondialisation n’est pas coupable Fusion Fiat-Chrysler Renault : l’échec du capitalisme d’État français
http://dlvr.it/Rc2RxJ
http://dlvr.it/Rc2RxJ