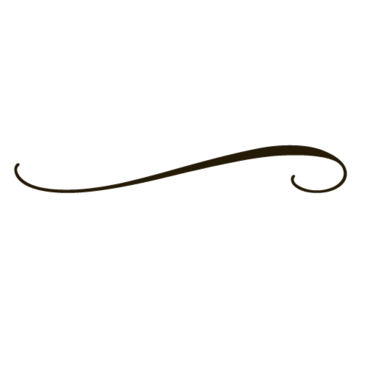L'idéologie du travail, par Jacques Ellul
Source : Le Partage, Jacques Ellul, 25-02-2016 Il faut, avant toute recherche ou réflexion sur le travail dans notre société prendre conscience de ce que tout y est dominé par l'idéologie du travail. Dans la presque totalité des sociétés traditionnelles, le travail n'est considéré ni comme un bien ni comme l'activité principale. La valeur éminente du travail apparait dans le monde occidental, au XVIIème, en Angleterre, en Hollande puis en France et elle se développe dans ces trois pays au fur et à mesure de la croissance économique. Comment s'explique, d'abord la mutation mentale et morale qui consiste à passer du travail peine ou châtiment ou nécessité inévitable au travail valeur et bien ? Il faut constater que cette réinterprétation qui aboutit à l'idéologie du travail se produit lors de la rencontre de quatre faits qui modifient la société occidentale. Tout d'abord le travail devient de plus en plus pénible, avec le développement industriel, et apparemment plus inhumain. Les conditions du travail empirent considérablement en passant de l'artisanat, et même de la manufacture (qui était déjà dure mais non pas inhumaine) à l'usine. Celle-ci produit un type de travail nouveau, impitoyable. Et comme, avec la nécessité de l'accumulation du capital, le salaire est inférieur à la valeur produite, le travail devient plus envahissant : il recouvre toute la vie de l'homme. L'ouvrier est en même temps obligé de faire travailler sa femme et ses enfants pour arriver à survivre. Le travail est donc à la fois plus inhumain qu'il ne l'était pour les esclaves et plus totalitaire, ne laissant place dans la vie pour rien d'autre, aucun jeu, aucune indépendance, aucune vie de famille. Il apparait pour les ouvriers comme une sorte de fatalité, de destin. Il était alors indispensable de compenser cette situation inhumaine par une sorte d'idéologie (qui apparaît d'ailleurs ici comme correspondant exactement à la vue de l'idéologie chez Marx), qui faisait du travail une vertu, un bien, un rachat, une élévation. Si le travail avait encore été interprété comme une malédiction, ceci aurait été radicalement intolérable pour l'ouvrier. Or, cette diffusion du « Travail-Bien » est d'autant plus nécessaire que la société de cette époque abandonne ses valeurs traditionnelles, et c'est le second facteur. D'une part les classes dirigeantes cessent de croire profondément au christianisme, d'autre part les ouvriers qui sont des paysans déracinés, perdus dans la ville n'ont plus aucun rapport avec leurs anciennes croyances, l'échelle des valeurs traditionnelles. De ce fait il faut rapidement créer une idéologie de substitution, un réseau de valeurs dans lequel s'insérer. Pour les bourgeois, la valeur va devenir ce qui est l'origine de leur force, de leur ascension. Le Travail (et secondairement l'Argent). Pour les ouvriers, nous venons de voir qu'il faut aussi leur fournir ce qui est l'explication, ou la valorisation, ou la justification de leur situation, et en même temps une échelle de valeurs susceptible de se substituer à l'ancienne. Ainsi, l'idéologie du travail se produit et grandit dans le vide des autres croyances et valeurs. Mais il y a un troisième facteur : est reçu comme valeur ce qui est devenu la nécessité de croissance du système économique, devenu primordial. L'économie n'a pris la place fondamentale dans la pensée qu'au XVII – XVIIIème. L'activité économique est créatrice de la valeur (économique). Elle devient dans la pensée des élites, et pas seulement de la bourgeoisie, le centre du développement, de la civilisation. Comment dès lors ne pas lui attribuer une place essentielle dans la vie morale. Or, ce qui est le facteur déterminant de cette activité économique, la plus belle de l'homme, c'est le travail. Tout repose sur un travail acharné. Ce n'est pas encore clairement formulé au XVIIIème, mais nombreux sont ceux qui comprennent déjà que le travail produit la valeur économique. Et l'on passe très tôt de cette valeur à l'autre (morale ou spirituelle). Il fallait bien que cette activité si essentielle matériellement soit aussi justifiée moralement et psychologiquement. Créateur de valeur économique, on emploie le même mot pour dire qu'il est fondateur de la valeur morale et sociale. Enfin un dernier facteur vient assurer cette prédominance. L'idéologie du travail apparaît lorsqu'il y a séparation plus grande, décisive entre celui qui commande et celui qui obéit à l'intérieur d'un même processus de production, entre celui qui exploite et celui qui est exploité, correspondant à des catégories radicalement différentes de travail. Dans le système traditionnel, il y a celui qui ne travaille pas et celui qui travaille. Il y a une différence entre le travailleur intellectuel et le travailleur manuel. Mais il n'y avait pas opposition radicale entre les tâches d'organisation ou même de commandement et celles d'exécution : une initiative plus grande était laissée au manuel. Au XVIIIème, celui qui organise le travail et qui exploite est lui-même un travailleur (et non pas un non travailleur, comme le seigneur) et tous sont pris dans le circuit du travail, mais avec l'opposition totale entre l'exécutant exploité et le dirigeant exploiteur. Il y a des catégories totalement différentes du travail dans le domaine économique. Ce sont là, je crois, les quatre facteurs qui conduisent à l'élaboration (spontanée, non pas machiavélique) de l'idéologie du travail, qui joue le rôle de toutes les idéologies : d'une part voiler la situation réelle en la transposant dans un domaine idéal, en attirant toute l'attention sur l'idéal, l'ennobli, le vertueux, d'autre part, justifier cette même situation en la colorant des couleurs du bien et du sens. Cette idéologie du travail a pénétré partout, elle domine encore en grande partie nos mentalités.
Quelles sont alors les principales composantes de cette idéologie : tout d'abord, l'idée centrale, qui devient une évidence, c'est que l'homme est fait pour le travail. Il n'a pas d'autre possibilité pour vivre. La vie ne peut être remplie que par le travail. Je me rappelle telle pierre tombale avec pour seule inscription, sous le nom du défunt : « le travail fut sa vie ». Il n'y avait rien d'autre à dire sur toute une vie d'homme. Et en même temps dans la première moitié du XIXème, apparaissait l'idée que l'homme s'était différencié des animaux, était devenu vraiment homme parce que dès l'origine il avait travaillé. Le travail avait fait l'homme. La distance entre le primate et l'homme était établie par le travail. Et, bien significatif, alors qu'au XVIIIème. on appelait en général l'homme préhistorique « homo sapiens », au début du XIXème. ce qui va primer ce sera « homo faber » : l'homme fabricant d'outils de travail (je sais bien entendu que cela était lié à des découvertes effectives d'outils préhistoriques, mais ce changement d'accentuation reste éclairant). De même que le travail est à l'origine de l'homme, de même c'est lui qui peut donner un sens à la vie. Celle-ci n'a pas de sens en elle- même : l'homme lui en apporte un par ses œuvres et l'accomplissement de sa personne dans le travail, qui, lui-même n'a pas besoin d'être justifié, légitimé : le travail a son sens en lui-même, il comporte sa récompense, à la fois par la satisfaction morale du « devoir accompli », mais en outre par les bénéfices matériels que chacun retire de son travail. Il porte en lui sa récompense, et en plus une récompense complémentaire (argent, réputation, justification). Labor improbus omnia vincit. Cette devise devient la majeure du XIXème. Car le travail est le père de toutes les vertus, comme l'oisiveté est la mère de tous les vices. Les textes de Voltaire, l'un des créateurs de l'idéologie du travail, sont tout à fait éclairants à ce sujet : « Le travail éloigne de nous trois grands maux, l'ennui, le vice et le besoin » ou encore « Forcez les hommes au travail, vous les rendrez honnêtes gens ». Et ce n'est pas pour rien que ce soit Voltaire justement qui mette au premier plan la vertu du travail. Car celui-ci devient vertu justificatrice. On peut commettre beaucoup de fautes de tous ordres, mais si on est un ferme travailleur on est pardonné. Un pas de plus, et nous arrivons à l'affirmation, qui n'est pas moderne, que « Le travail c'est la liberté ». Cette formule rend aujourd'hui un son tragique parce que nous nous rappelons la formule à l'entrée des Camps hitlériens « Arbeit macht frei ». Mais au XIXe s. on expliquait gravement qu'en effet seul le travailleur est libre, par opposition au nomade qui dépend des circonstances, et au mendiant qui dépend de la bonne volonté des autres. Le travailleur, lui, chacun le sait, ne dépend de personne. Que de son travail ! Ainsi l'esclavage du travail est mué en garantie de Liberté. Et de cette morale nous trouvons deux applications plus modernes : l'Occidental a vu dans sa capacité à travailler la justification en même temps que l'explication de sa supériorité à l'égard de tous les peuples du monde. Les Africains étaient des paresseux. C'était un devoir moral que de leur apprendre à travailler, et c'était une légitimation de la conquête. On ne pouvait pas entrer dans la perspective que l'on s'arrête de travailler quand on a assez pour manger deux ou trois jours. Les conflits entre employeurs occidentaux et ouvriers arabes ou africains entre 1900 et 1940 ont été innombrables sur ce thème-là. Mais, très remarquablement, cette valorisation de l'homme par le travail a été adoptée par des mouvements féministes. L'homme a maintenu la femme en infériorité, parce que seul il effectuait le travail socialement reconnu. La femme n'est valorisée aujourd'hui que si elle « travaille » : compte tenu que le fait de tenir le ménage, élever les enfants n'est pas du travail, car ce n'est pas du travail productif et rapportant de l'argent. G. Halimi dit par exemple « La grande injustice c'est que la femme a été écartée de la vie professionnelle par l'homme ». C'est cette exclusion qui empêche la femme d'accéder à l'humanité complète. Ou encore qui fait qu'on la considère comme le dernier peuple colonisé. Autrement dit, le travail, qui, dans la société industrielle est effectivement à la source de la valeur, qui devient l'origine de toute réalité, se trouve transformé, par l'idéologie en une surréalité, investie d'un sens dernier à partir duquel toute la vie prend son sens. Le travail est ainsi identifié à toute la morale et prend la place de toutes les autres valeurs. Il est porteur de l'avenir. Celui-ci, qu'il s'agisse de l'avenir individuel ou de celui de la collectivité, repose sur l'effectivité, la généralité du travail. Et à l'école on apprend d'abord et avant tout à l'enfant la valeur sacrée du travail. C'est la base (avec la Patrie) de l'enseignement primaire de 1860 à 1940 environ. Cette idéologie va pénétrer totalement des générations. Et ceci conduit à deux conséquences bien visibles, parmi d'autres. Tout d'abord nous sommes une société qui a mis progressivement tout le monde au travail. Le rentier, comme auparavant le Noble ou le Moine tous deux des oisifs, devient un personnage ignoble vers la fin du XIXème. Seul le travailleur est digne du nom d'homme. Et à l'école on met l'enfant au travail, comme jamais dans aucune civilisation on n'a fait travailler les enfants (je ne parle pas de l'atroce travail industriel ou minier des enfants au XIXème, qui était accidentel et lié non pas à la valeur du travail mais au système capitaliste). Et l'autre conséquence actuellement sensible : on ne voit pas ce que serait la vie d'un homme qui ne travaillerait pas. Le chômeur, même s'il recevait une indemnité suffisante, reste désaxé et comme déshonoré par l'absence d'activité sociale rétribuée. Le loisir trop prolongé est troublant, assorti de mauvaise conscience. Et il faut encore penser aux nombreux « drames de la retraite ». Le retraité se sent frustré du principal. Sa vie n'a plus de productivité, de légitimation : il ne sert plus à rien. C'est un sentiment très répandu qui provient uniquement du fait que l'idéologie a convaincu l'homme que la seule utilisation normale de la vie était le travail.
Cette idéologie du travail présente un intérêt tout particulier dans la mesure où c'est un exemple parfait de l'idée (qu'il ne faut pas généraliser) que l'idéologie dominante est l'idéologie de la classe dominante. Ou encore que celle-ci impose sa propre idéologie à la classe dominée. En effet cette idéologie du travail est, avec l'expansion de l'industrie, une création intégrale de la classe bourgeoise. Celle-ci remplace toute morale par la morale du travail. Mais ce n'est pas pour tromper les ouvriers, ce n'est pas pour les amener à travailler plus. Car la bourgeoisie elle- même y croit. C'est elle qui, pour elle-même, place le travail au- dessus de tout. Et les premières générations bourgeoises (les capitaines d'industrie par exemple) sont faites d'hommes acharnés au travail, œuvrant plus que tous. On élabore cette morale non pour contraindre les autres, mais en tant que justification de ce que l'on fait soi-même. La bourgeoisie ne croyait plus aux valeurs religieuses et peu aux morales traditionnelles : elle remplace le tout par cette idéologie qui légitime à la fois ce qu'elle fait, la façon dont elle vit, et aussi le système lui-même qu'elle organise et met en place. Mais bien entendu, nous avons déjà dit que comme toute idéologie, celle-là sert aussi à voiler, cacher la condition du prolétariat (s'il travaille, ce n'est pas par contrainte mais par vertu). Or, ce qui est passionnant c'est de constater que cette idéologie produite par la bourgeoisie devient l'idéologie profondément crue et essentielle de la classe ouvrière et de ses penseurs. Comme la plupart des socialistes, Marx se fait piéger par cette idéologie. Lui qui a été si lucide pour critiquer la pensée bourgeoise, il entre en plein dans l'idéologie du travail. Les textes abondent : « L'Histoire n'est que la création de l'homme par le travail humain. Le travail a créé l'homme lui-même » (Engels). Et voici de beaux textes de Marx lui-même :
Et l'une des attaques impitoyables de Marx contre le capitalisme portera justement sur ce point : le capitalisme a dégradé le travail humain, il en fait un avilissement, une aliénation. Le travail dans ce monde n'est plus le travail. (Il oubliait que c'était ce monde qui avait fabriqué cette image noble du travail !). Le capitalisme doit être condamné entre autres afin que le travail puisse retrouver sa noblesse et sa valeur. Marx attaquait d'ailleurs en même temps sur ce point les anarchistes, seuls à douter de l'idéologie du travail. Enfin : « Par essence le travail est la manifestation de la personnalité de l'homme. L'objet produit exprime l'individualité de l'homme, son prolongement objectif et tangible. C'est le moyen de subsistance direct, et la confirmation de son existence individuelle ». Ainsi Marx interprète tout grâce au travail, et sa célèbre démonstration que seul le travail est créateur de valeur repose sur cette idéologie bourgeoise (d'ailleurs c'étaient bien des économistes bourgeois qui, avant Marx, avaient fait du travail l'origine de la valeur…). Mais ce ne sont pas seulement les penseurs socialistes qui vont entrer dans cette optique, les ouvriers eux-mêmes, et les syndicats aussi. Pendant toute la fin du XIXème, on assiste à la progression du mot « Travailleurs ». Seuls les travailleurs sont justifiés et ont droit à être honorés, opposés aux Oisifs et aux Rentiers qui sont vils par nature. Et encore par Travailleur on n'entend que le travailleur manuel. Aux environs de 1900, il y aura de rudes débats dans les syndicats pour savoir si on peut accorder à des fonctionnaires, des intellectuels, des employés, le noble titre de travailleur. De même dans les syndicats on ne cesse de répéter entre 1880-1914 que le travail ennoblit l'homme, qu'un bon syndicaliste doit être un meilleur ouvrier que les autres ; on propage l'idéal du travail bien fait etc… Et finalement toujours dans les syndicats, on demande avant tout la justice dans la répartition des produits du travail, ou encore l'attribution du pouvoir aux travailleurs. Ainsi on peut dire que de façon très générale, syndicats et socialistes ont contribué à répandre cette idéologie du travail et à la fortifier, ce qui se comprend d'ailleurs très bien ! Jacques Ellul Source : Le Partage, Jacques Ellul, 25-02-2016 |