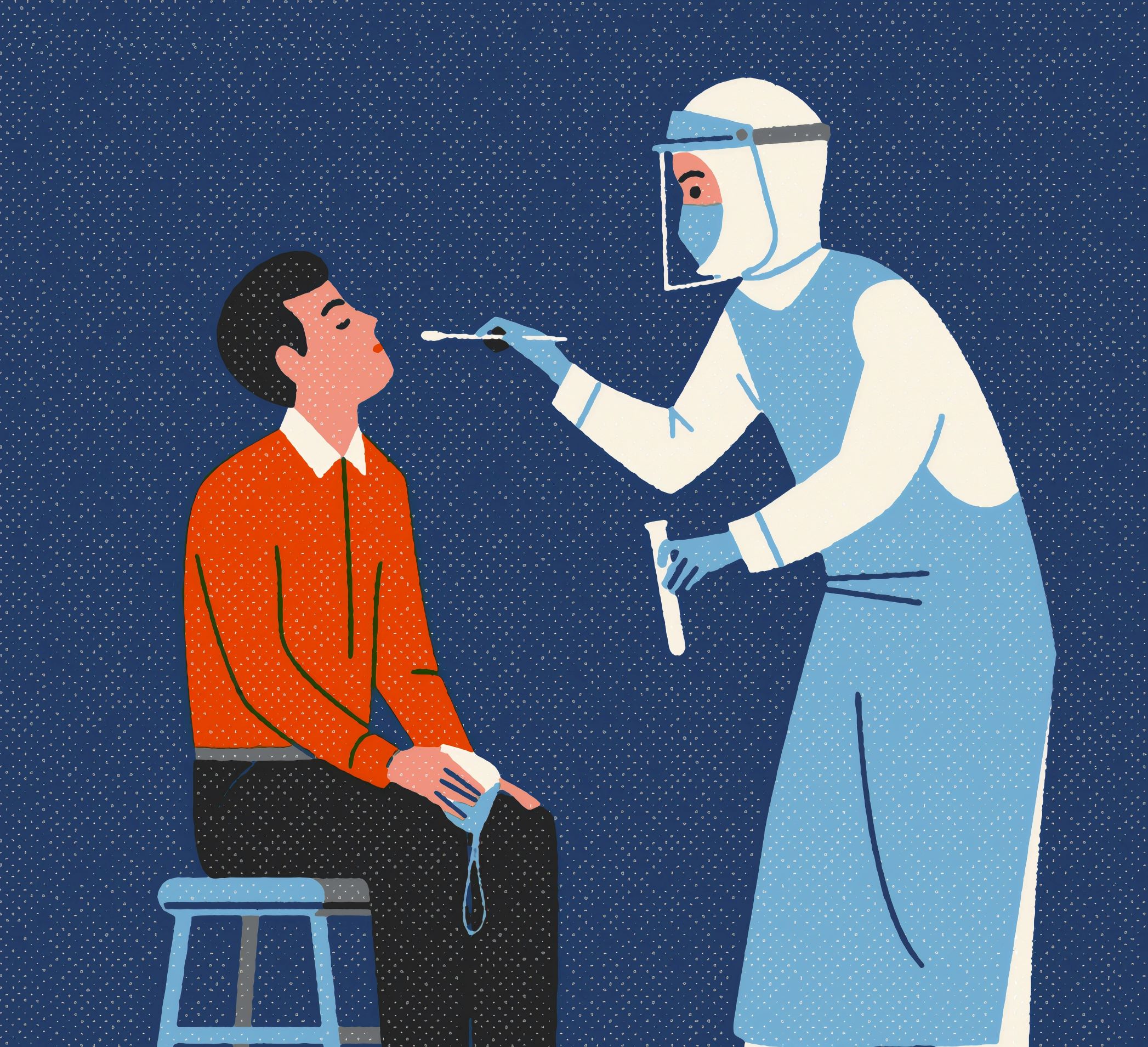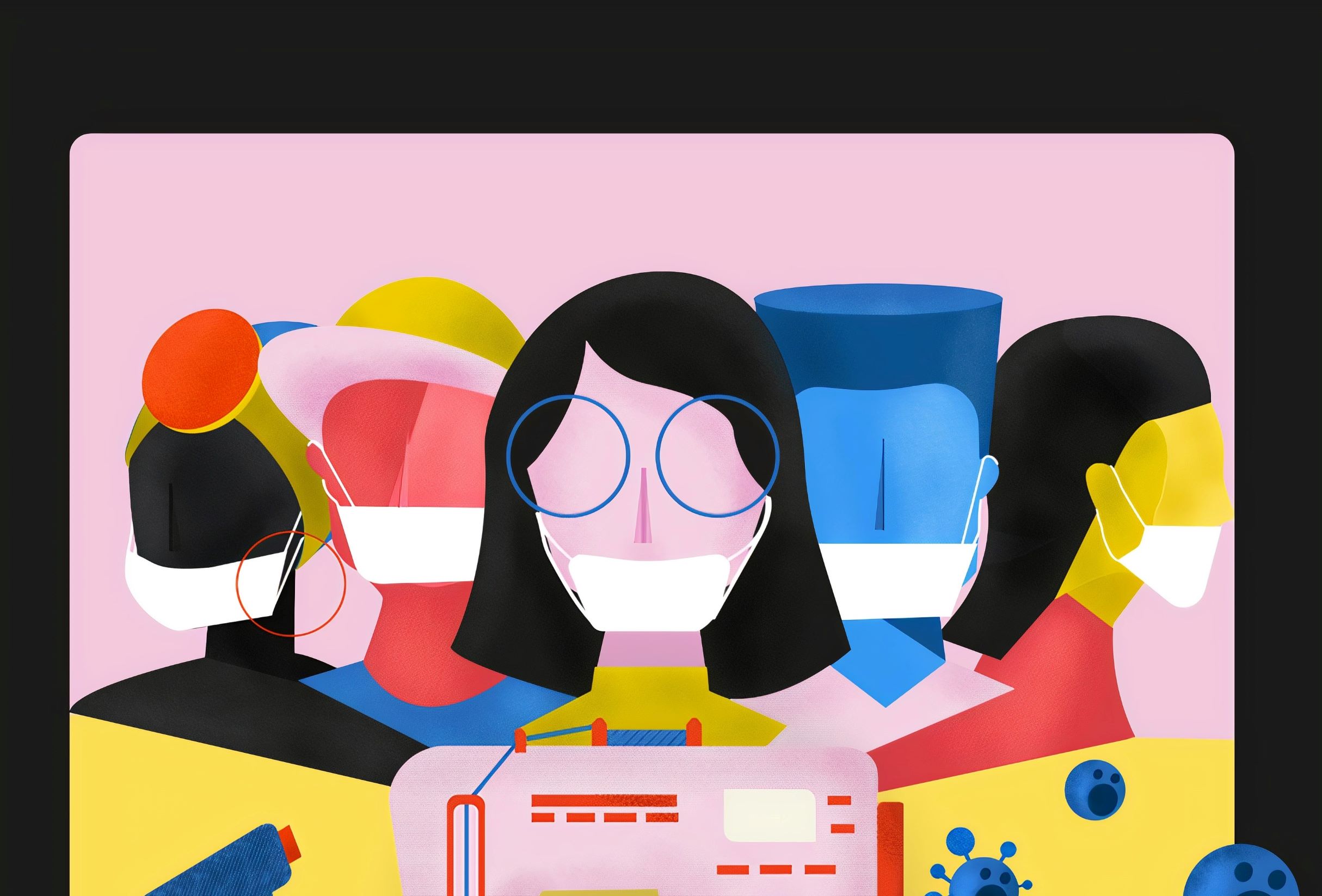Par Paul Touboul.
Pourquoi aujourd’hui tester nos concitoyens de manière intensive alors que l’épidémie de Covid-19 est à son terme comme l’attestent une mortalité au plus bas et des services de réanimation revenus à leur régime normal ? C’est bien là la question que chacun devrait se poser en cette phase de l’épidémie censée en marquer l’extinction, donnée que les indicateurs habituels, nous l’avons vu, accréditent. Pourquoi tester de manière intensive maintenant ?
Alors que se passe-t-il qui justifie que nous restions sur le pied de guerre, ferraillant sans discontinuer contre une prétendue hydre à la tête sans cesse renaissante ? L’ambiance reste lourde, de cette crise on ne voit décidément pas la fin. Le fantôme du virus est pendu à nos basques, plus que jamais vivace et capable de tout : c’est du moins le récit qui court, alimentant une peur qui frise la panique.
Peur de quoi ? d’un retour de flamme de l’épidémie, auquel, entre parenthèses, nous avions été préparés dès la phase d’invasion comme si ce virus pas comme les autres se devait de nous réserver un parcours inédit et redoutable.
Certes, le choc a été rude, en atteste une mortalité dont l’évocation aujourd’hui encore reste douloureuse. Puis l’épidémie a suivi un cours normal amorçant en avril une décroissance qui en annonçait le terme. Courbe en cloche classique qui ne dérogeait pas aux standards en la matière. Nous pouvions voir venir la suite plus sereinement. Et pourtant rien n’a eu lieu comme le schéma classique le laissait supposer. La lutte continue. Le pays demeure sur un pied de guerre. Ce virus est-il si particulier, si distinct de ses prédécesseurs ?
C’est après tout un coronavirus comme il y en a déjà eu tant d’autres dans le passé. Son identité génétique a certes des particularités mais rien qui en fasse un organisme tout à fait à part dans sa catégorie. Comme les virus de son espèce, il a déjà été l’objet de mutations diverses qui en ont diversifié l’identité. C’est pourquoi il est vraisemblable que ce n’est plus le même virus qui continue de circuler aujourd’hui, rendant compte de nouvelles caractéristiques épidémiologiques, semble-t-il plus bénignes.
L’expérience tirée des semaines de pandémie, si elle a pris acte de la contagiosité élevée du virus, a par contre finalement rassuré sur sa létalité, du même ordre grosso modo que celle des grippes saisonnières, soit un taux de décès de l’ordre de 0,3 % mais susceptible d’atteindre 8 % après 80 ans.
Toute stratégie à l’encontre de la virose se devait donc de cibler avant tout la protection des sujets âgés. Nous en étions là fin avril au seuil d’une fin de crise. Les semaines qui ont suivi ont conservé une tonalité inquiète. La peur n’a fait que grandir face à un mal toujours vivant et dont la dynamique a semblé reprendre du poil de la bête. « Faites-vous tester ! »
Que s’est-il passé en fait ? Les tests de dépistage, devenus entretemps disponibles, ont été largement diffusés. Un message fort a été lancé à l’adresse de la population : faites-vous tester. Et ce pour de multiples raisons.
Individuellement, il est important que chacun se sache ou non porteur du virus et donc en capacité éventuelle de le transmettre à des sujets, âgés notamment, chez qui la contamination peut être mortelle. À l’échelon du pays, a été entamé un suivi de l’épidémie en quête d’éventuels gîtes de renaissance ici ou là, germes éventuels d’une nouvelle vague généralisée.
À ce stade la question est : pourquoi n’être pas resté simplement vigilant, attentif à l’émergence éventuelle de cas déclarés, et toujours soucieux de la protection des plus vulnérables à l’aide de mesures ciblant entre autres les EHPAD.
Les viroses du passé, en particulier l’épidémie de grippe de 2017 dans notre pays qui s’est soldée par 20 000 morts au bas mot, n’ont pas donné lieu au déploiement d’un tel arsenal inquisiteur, et se sont éteintes en silence. Pourtant qui sait si un dépistage intensif des contaminés en phase tardive n’aurait pas identifié comme maintenant des foyers potentiels de résurgence épidémique ? Alors, à quoi assistons-nous aujourd’hui ?
L’offre en matière de dépistage a été démultipliée. Aux laboratoires se sont ajoutées des formations mobiles temporaires capables de prendre pied un peu partout et apportant l’outil technique au plus près des populations. Ainsi les uns et les autres partent en quête du graal : le label covid-free.
Bien des choses peuvent en dépendre : arrêt temporaire d’emploi, activité commerciale suspendue, fermeture momentanée d’école, tests étendus aux proches. Cette activité n’a fait que croître et embellir d’autant que les tests sont devenus gratuits. Au total 7 à 800 000 tests par semaine qui déversent quotidiennement leur lot d’informations sur l’ampleur des contaminations. La barre des 9000 cas quotidiens vient récemment d’être franchie, à l’origine de réactions alarmistes quant à la capacité de propagation du virus. Que signifie un tel chiffre ?
Existe-t-il des valeurs de référence servant d’étalon et permettant de le situer sur une échelle de gravité ? Pas à ma connaissance. Alors est-ce la progression des chiffres qui incite à sonner l’alarme ? Là encore nous sommes en plein arbitraire. S’agit-il même d’une vraie quantification du phénomène ?
Il faudrait pour cela que les tests soient effectués chaque jour sur des échantillons représentatifs de la population générale. Ce qui n’est pas le cas. À l’évidence nombre de ceux qui se font tester ont diverses raisons de le faire : des symptômes qui les inquiètent, une injonction d’ordre professionnel, la proximité de sujets contaminés, le souci de protéger leurs vieux parents, voire pour les jeunes, volontiers désignés comme porteurs sains, le désir d’en avoir le cœur net.
Est donc en cause un ensemble particulier, qui a toute chance de différer d’un jour à l’autre, ne reflète en rien l’image de notre pays dans sa diversité et d’une certaine manière, a un lien plus étroit avec la circulation du virus.
Il faut adjoindre à ces réserves que les tests eux-mêmes ne sont pas exempts de critiques. Des faux positifs seraient incriminés dans au moins 20 % des cas. Et pour certains la marge d’erreur est encore plus grande. Ce qui conduirait à revoir les chiffres officiels de contaminés à la baisse.
De plus, ces tests n’ont pas la capacité de discriminer entre virus morts et vivants et donc d’estimer au plus près l’ancienneté de la contamination. C’est pourquoi parler dans tous les cas de nouveaux contaminés est un abus de langage qui fait fi de la réalité. Encore une fois tout semble fait pour orienter les données dans le sens de la dramatisation.
Alors plutôt que naviguer à vue sur la foi d’informations qui sont matière à conjecture, autant s’appuyer sur celles qui, de tout temps, ont été des marqueurs de gravité. La mortalité est de ce point de vue l’item de référence. Avons-nous observé dernièrement une inflexion des courbes�? Absolument pas. Les chiffres de fin d’épidémie sont inchangés et au plus bas.
Quant au nombre de nouvelles hospitalisations alléguées voire d’admissions en réanimation, elles n’ont semble-t-il pas eu d’influence sur les indicateurs d’activité hospitalière. D’ailleurs une majorité des cas dépistés est asymptomatique et porte donc le virus sans en avoir conscience, ce qui irait dans le sens de germes mutants d’agressivité atténuée.
Nous nous trouvons en somme confrontés à un situation inédite, n’ayant pas de précédents et générée, disons-le, artificiellement par une politique agressive de dépistage dans les suites de l’épidémie dont elle explore des soubassements jusqu’alors négligés. Mais se pose alors la question suivante : faut-il appliquer à cet inventaire la même grille de lecture que celle utilisée en pleine phase d’invasion épidémique ? Entretemps bien des paramètres ont changé.
À commencer par la dynamique de l’épidémie qui, après le pic, a amorcé puis achevé sa décroissance, dessinant un processus mené apparemment à son terme. Il y a ensuite les germes qui circulent actuellement, fruits de dégradations subies par l’agent de départ. À l’évidence l’expression des troubles s’est édulcorée. Il faut en outre prendre en compte la part jouée par l’immunité acquise dans la population. Alors découvrir que des mois après la fin apparente de l’épidémie circulent encore des virus, pourquoi pas ?
Le fait doit rester un sujet d’étude quant à la dynamique virale et ses ressorts. Il importe de rester vigilant face à une situation que notre politique est allée débusquer et dont l’analyse est matière à conjecture. Surveiller donc et non pas agir comme si était en cause une vague épidémique déferlante.
En fin de compte, répétons-le, nous subissons les retombées d’un dépistage appliqué avec une rare intensité. Dépistage, il faut bien le dire, à contre-courant, puisqu’il se déploie dans l’arrière-cour de l’épidémie alors qu’il a fait cruellement défaut au printemps dernier en pleine pandémie. Comprenne qui pourra. Les autorités cherchent-elles ainsi à se dédouaner des insuffisances de départ ? Écartons pour l’heure cette pensée qui ressortit au soupçon.
Vraisemblablement l’influence des experts commis auprès du pouvoir est en cause. Et c’est leur approche de l’épidémie qui irrigue la politique sanitaire en cours. On ne peut s’empêcher quand même d’y voir une expression de cette peur, trait frappant de notre humanité chamboulée par un simple virus et qui a perdu dans ce combat toute mesure. Ces articles pourraient vous intéresser: Covid : pourquoi une telle soumission ? Vous avez tout faux ! Risque zéro et amélioration de la sécurité Covid-19 : l’État discute des masques, une startup développe un vaccin Ségur de la Santé : la réforme passe par la dé-bureaucratisation
http://dlvr.it/RgdCMq
mardi 15 septembre 2020
Des Gilets jaunes aux Gilets rouges : le mouvement anti-taxes est devenu pro-dépenses
Par Jonathan Frickert.
« Les déficits d’aujourd’hui sont les impôts de demain », nous dit le fameux effet ricardien. L’économiste britannique avait en son temps compris mieux que personne qu’en situation d’endettement public, les acteurs épargnaient davantage par anticipation d’une future hausse des impôts.
C’est sans doute ce qui attendent nos compatriotes alors que le budget 2020 sera annoncé en fin de semaine. Un budget qui semble laisser courir les déficits à hauteur de 2,2 % via des baisses de prélèvements et des suppressions de niches largement salutaires, mais cachant l’incapacité de la machine étatique à s’autoréformer.
Ce budget sous forme de cadeau au contribuable ressemblant fort à une arrière-pensée politique à six mois des élections municipales, mais également avant le premier anniversaire du mouvement des Gilets jaunes, dont la base s’est largement érodée en dix mois.
Ces derniers ont été vu ce samedi participer à la manifestation pour le climat. D’autres en viennent à parler de convergence des luttes en vue des manifestations contre la réforme des retraites.
Comment ce mouvement antifiscal de la France périphérique, que certains voyaient comme une authentique révolution de droite, est-il finalement devenu un énième mouvement de contestation à la gauche de l’échiquier, réclamant toujours davantage d’argent public ? Gilets jaunes : un mouvement périphérique et antifiscal
La France reste le pays de la voiture. C’est ce qu’annonçait en juillet dernier une étude de la société de marketing Kantar. Ce n’est donc pas pour rien qu’a émergé il y a maintenant 10 mois le mouvement des Gilets jaunes. Un mouvement initialement catégoriel et concernant une des catégories sociales les plus nombreuses du pays : les automobilistes.
Aux origines du mouvement se trouvait en effet le refus de l’augmentation des prix des carburants issue de la hausse de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. La fameuse TICPE représente entre 40 et 70 centimes d’euros en plus sur un litre de carburant qui inclut, depuis 2014, une composante carbone devant s’élever à une centaine d’euros par tonne d’émission d’ici 2030.
Cette taxe représente entre 300 à 600 euros par an en moyenne et impacte d’autant plus les automobilistes qu’ils sont déjà la cible de politiques particulièrement répressives en matière de sécurité routière. Une situation qui a amené le mouvement à demander l’arrêt du matraquage des automobilistes, également touchés par la hausse du prix du contrôle technique de mai 2018.
Outre ces revendications catégorielles s’ajoutait une demande de démocratie directe et de débat sur l’immigration, plaçant le mouvement à la droite de l’échiquier idéologique.
Sociologiquement, la France des Gilets jaunes est la France périphérique. Celle contrainte d’utiliser la voiture pour aller travailler, par opposition aux citadins bénéficiant de systèmes de transports en commun performants. Guère étonnant donc de trouver ici une sur–représentation des électeurs lepenistes et de personnes déçues par les corps intermédiaires, pourtant régulateurs de la société, mais en perte de légitimité comme en atteste le faible taux de syndicalisation que connaît le pays. L’absence d’organisation structurée derrière la contestation aura fait des Gilets jaunes une forme d’uberisation de la contestation politique. Une situation qui explique l’absence de contagion en Allemagne ou en Suisse, pays où la fracture territoriale et démocratique est moins présente qu’en France.
Tous ces éléments ont rapidement permis de comprendre que les Gilets jaunes incarnaient la fameuse fracture française dont le dernier théoricien notable est sans doute Christophe Guilluy.
Une constitution qui faisait espérer une révolution de droite pour Charles Gave voire un anti-Mai 1968 pour l’avocat et historien Philippe Fabry. Là où il avait atomisé l’échiquier politique en tuant toute opposition horizontale, Emmanuel Macron se trouvait face à une opposition verticale, provinciale, populaire et anti-fiscalité.
Une sensation renforcée par la couleur du mouvement, le jaune. Si ce choix est évidement issu du gilet de signalisation éponyme, l’utilisation du jaune, couleur de nombreux mouvements libéraux et libertariens, synonyme d’activité chez le philosophe allemand Goethe et surtout symbole, dans le milieu syndicaliste, des organisations non marxistes, a achevé de donner de nombreux espoirs.
Pourtant, à l’érosion du mouvement s’est ajoutée une gauchisation dont la dernière manifestation est sans doute l’appel à une convergence et une coagulation des luttes sociales, le tout sur fond d’écologie et de rejet de la réforme des retraites. Arroser d’argent public pour mieux noyer le poisson politique
Ce 24 septembre, plusieurs Gilets jaunes se sont joints aux CGT lors des manifestations contre la réforme des retraites.
Rien d’étonnant quand on sait que dès le 2 décembre de l’année dernière, le journal Le Monde a évoqué des revendications proches de l’extrême gauche. La question du retour de l’ISF, l’entrisme de soraliens, de complotistes et antisémites divers, permettent alors de conforter l’idée que le mouvement naviguerait entre extrême gauche et extrême droite. On voit alors émerger des figures comme Maxime Nicolle, dont certains médias iront chercher les prises de position les plus controversées.
La composante anti-taxe est ainsi redevenue secondaire dès le second samedi de mobilisation, étouffée par le moratoire sur la hausse des taxes annoncée par Matignon le 4 décembre et surtout par l’annonce par Emmanuel Macron de mesures sociales, essentiellement destinées à renforcer la trappe à SMIC en avantageant les petits salaires, avec des effets pervers bien connus, ainsi que des défiscalisations ciblées.
Face à l’évolution et à la radicalisation du mouvement, l’exécutif lance un Grand débat national. Hasard ou machiavélisme politique, les sujets sociétaux, qualifiants pour l’opinion tels que l’immigration sont d’emblée exclus de l’opération, privilégiant de facto les sujets économiques. Selon une note ministérielle, l’immigration, pourtant exclue du débat, comme les avantages dont bénéficient les élus restent tout de même bien présents dans les différentes doléances, inscrits dans des cahiers éponymes. Une dénomination loin d’être neutre et permettant au chef de l’État de se parer des habits de monarque médiateur et bienveillant qui, à l’inverse de Louis XVI, sauvera sa tête.
Ce décalage entre la tentative de reprise en main par le chef de l’État et les attentes des populations renforcé par une conférence de presse de clôture limitée à des mesures de pouvoir d’achat.
En résumé, l’exécutif, voyant émerger une opposition davantage identitaire et démocratique que sociale, a joué le jeu de l’extrême gauche en limitant la discussion à des sujets sociaux, bien plus simples à gérer sur le plan politique. La réponse la plus simple est de repousser le problème à plus tard en arrosant les factieux d’argent public. Un argent public qu’il faudra bien compenser un jour par de nouvelles taxes, annoncées par un autre gouvernement, et ainsi de suite.
Une logique qui rejoint le matérialisme historique marxiste limité aux seuls enjeux matériels mettant de côté les questions politiques, spirituelles, voire identitaires, pourtant fondamentalement clivants aujourd’hui et qui, un jour où l’autre, exploseront. L’apparence de la réforme, la réalité de la conservation
Une logique qui sert aussi bien Emmanuel Macron que l’extrême gauche. Plus encore qu’une stratégie permettant de masquer l’immobilisme, cette logique révèle la nature profonde du clivage politique français, entre social-démocratie et social-populisme tous deux différant non par leur nature, mais par leur degré de soutien à l’État-providence.
Invitons les plus sceptiques à regarder – pour ne pas dire subir – le débat organisé à la fête de l’Humanité entre le haut-commissaire à la réforme des retraites Jean-Paul Delevoye et le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez, disponible en quelques clics sur YouTube, et portant sur la réforme de notre système d’assurance vieillesse. Entre l’ex-RPR et le leader maximo du 9-2, on ne trouvera qu’une feuille de papier à cigarette, le premier défendant une réforme destinée à parachever les objectifs du système d’après-guerre lorsque son opposant ne pouvait cacher son obsession pour les actionnaires. Les plus dubitatifs argueront du sens de la communication du gouvernement. Les plus perspicaces mettront ces paroles en parallèle à l’attaque menée par l’exécutif contre les caisses autonomes, privées et bien mieux gérées que leurs homologues publiques.
Une nouvelle preuve de la réalité du macronisme consistant en une communication séduisante, mais une pratique conformiste. Derrière la salutaire convergence des régimes du secteur public avec celui du secteur privé se trouve une tentative d’égalisation permanente. Une pratique consistant, comme toujours, à pénaliser ce qui fonctionne pour compenser la gestion calamiteuse de certains. Une prime à l’incompétence tristement française, mais drapée sous les oripeaux de la sacro-sainte égalité.
�
Un article initialement publié en septembre 2019. Ces articles pourraient vous intéresser: Un an de Gilets jaunes : mais que sont les élans de liberté devenus ? Sondage : 74 % des Français favorables à la baisse des dépenses de l’État Que financent 1000 euros de dépenses publiques ? Macron : Bye bye « en même temps », bonjour bon vieux socialisme !
http://dlvr.it/RgdCMc
http://dlvr.it/RgdCMc
« Art contemporain » : le marché résistera-t-il à la crise du covid-19 ?
Par Aude de Kerros.
Le haut marché de l’Art contemporain est global tout comme le Covid-19 est pandémique. Le premier virus à contamination instantanément planétaire aura-t-il des conséquences sur un marché dont la valeur de ses produits se crée grâce à leur circulation internationale ? État des lieux en septembre 2020. Bilans du marché de l’AC1 avant le Covid-19
En mars 2020, au moment où les frontières se ferment, les bilans de l’année 2019 paraissent dans la presse. Thierry Ehrmann, président d’Art Price déclare que « l’Art contemporain est l’une des plus sérieuses alternatives aux placements financiers traditionnels » même si son rendement annuel a légèrement baissé par rapport aux années précédentes. Il qualifie le marché comme « stable et arrivé à maturité ».
La nouvelle qui fait sensation, partout proclamée, est que le chiffre des ventes de l’AC des USA et de la Grande-Bretagne passe devant celui de la Chine, ce qui ne s’était pas produit depuis une décennie !
On peut lire aussi beaucoup de commentaires sur l’état du marché, son dynamisme mais aussi ses fragilités.
Les discussions de 2019 des plus hauts acteurs et influenceurs du marché de l’Art lors de leur rencontre annuelle à Berlin sont instructives à cet égard2. Ainsi le directeur de la Foire de Bâle, Marc Spiegler, voit essentiellement deux faiblesses :
— la prospérité du marché a multiplié les hyper-galeries, foires et maisons de vente alors que le nombre de collectionneurs, de nouveaux entrants sur le marché n’augmente pas en proportion. La concurrence intérieure devient dangereuse et même mortelle.
— les galeries de moyenne envergure ne peuvent assumer les frais pour être présentes sur les grandes foires internationales. Ainsi est compromis l’apport indispensable de nouveaux artistes et de collectionneurs. C’est un réel danger car le fonctionnement en pyramide de Ponzi de ce marché très singulier exige une entrée perpétuelle de nouveaux produits pour de nouveaux entrants, provenant du monde entier.
Seul ce flux permanent garantit dans le temps la valeur arbitraire des œuvres établie au sommet. Celles-ci ne se fabriquent et conservent qu’en réseau fermé. Ceux qui créent leur valeur forment une chaîne de production solidaire : collectionneurs, médias, galeries méga ou moyennes, foires, salle des ventes, ports francs, institutions, musées. La cote s’établit grâce au parcours de toute la chaîne.
La pandémie aura l’effet bénéfique de résoudre dans l’immédiat le problème de la concurrence interne en éliminant les concurrents en surnombre, mais elle aggravera sans nul doute le sort des galeries moyennes, mais le dommage sera plus lent à se manifester. Confinement et créativité stratégique
Tout le long du confinement on a pu observer une créativité stratégique immédiate et efficace des acteurs du marché. Leur présence médiatique et numérique a été intense. Leur priorité a été de combler leur retard numérique. Ils l’ont fait en battant tous les records de vitesse : grandes rencontres, foires, ventes et évènements ont eu lieu quoique dématérialisés et ils ont été très visibles.
Christie’s et Sotheby’s ont raffiné ce qu’ils pratiquaient déjà, les « ventes nomades » allant de gisement en gisement de millionnaires, offrant un spectacle à la fois à New York, à Londres, Paris et Hong Kong.
De même ils ont multiplié les « ventes multi-thématiques » ou « trans-départementales » et mélangent art ancien, moderne et contemporain, mode, montres et voitures3, sans oublier les « ventes de gré à gré » mais passant, c’est nouveau, par une exposition du produit sur Internet4. Enfin une alliance vient d’être conclue entre salles des ventes et galeries de prestige : seront affichées, pour la vente, sur le site de Sotheby’s5 des œuvres exposées en galerie.
Une victoire, un trophée est déjà apparu dès ce 18 juin sur le haut marché. En pleine Foire de Bâle dématérialisée, la galerie David Zwirner a exposé et vendu en ligne un Balloon Vénus de Jeff Koons, 8 millions de dollars, ainsi que trois autres œuvres, au-dessus du million. Bâle-Hong Kong, avait déjà en mars inauguré l’exercice de la Foire virtuelle avec un nombre record de visites et semble-t-il des ventes au-dessus du million. Entre fin juin et fin juillet, New York a fait ses très mondaines « ventes du soir », mais en ligne, diffusées dans le monde entier, avec autant de retard que de succès. Leurs chiffres d’affaires ont atteint des records.
De même jamais jusqu’ici les ventes en ligne n’ont atteint un tel niveau ! Les opérations habituelles dépassant rarement le plafond de 50 000 euros, dépassent aujourd’hui le million !
En très peu de temps les galeries jouissant d’une grande visibilité ont été en mesure de faire leur ouverture virtuelle et les ventes n’ont semble-t-il pas cessé. Les plus multinationales ont réduit leur voilure, en licenciant. Ainsi David Zwirmer s’est très vite allégé de 20 % de son personnel en particulier aux USA.
En France, les solutions sont différentes, exception française exige ! Le ministère de la Culture a prévu pour 600 000 d’achats exceptionnels effectués par le CNAP aux galeries conformes aux choix officiels, dont les plus importantes et internationales que compte la France.
Le problème en ce début d’automne ne concerne d’évidence pas, à ce stade de la crise, le très haut marché. Il répond efficacement à la demande, qui ne faiblit pas, de produits « Art contemporain », financièrement fluides et transfrontières. Le choc du Covid-19 révèle d’autres réalités
L’incertitude qui plane sur ce marché d’essence globale qu’est celui de l’Art contemporain est ailleurs et rarement évoqué. Depuis une dizaine d’années le contenu idéologique et propagandiste de l’AC connaît une visible remise en cause.
Sa formule sophistiquée alliant transgression institutionnelle, discours moralisant, critique de la société, déconstruction civilisationnelle, produit financier haut de gamme, est perçue avant tout comme un moyen de contrôle. C’est le cas de nombreux intellectuels et artistes en Occident mais aussi de pays non-occidentaux qui ne veulent pas renoncer à leur culture et expriment une défiance vis à vis de l’Occident.
Il y a aussi les pays qui ont connu un totalitarisme sanglant et l’utopie d’un art également unique, final, indépassable et global et s’en méfient. Certains États dont la Chine, développent dans ce domaine un double jeu : ils accueillent les produits artistiques new-yorkais pour participer à la vie sociale et d’affaires internationales, et par ailleurs cultivent un retour à un art esthétique, porteur de leur civilisation et de sens.
Les effets de la pandémie risquent d’accentuer cette tendance en rendant moins fluides, aisées, arty, fun et rentables les relations d’affaires et la grande circulation des Boeing privés à l’occasion des foires, ventes, évènements de l’Art contemporain. Le global pour exister a aussi besoin d’être incarné, tangible.
Lors du confinement, une autre métamorphose est devenue très observable due à la circulation non contrôlée des images du monde entier grâce au numérique. Ce qui prédomine est l’attractivité des images, l’affinité naturelle que chacun développe avec elles. Le Net est devenu une source de visibilité en matière d’art qui supprime silencieusement les intermédiaires jusqu’ici dominants.
L’amateur devenu solitaire et confiné, procède par analogie, recherche, poursuit un désir, contemple les images, les compare, s’interroge, adhère ou rejette, sans mentir. Finie la sidération ! L’intimidation, jusque-là efficace, imposant des cotes sans aucun critère de valeur compréhensible, a fait son temps.
Si la pandémie a donné le temps nécessaire aux acteurs du marché de l’AC de se dématérialiser, elle les a rendus aussi plus fantomatiques. L’amateur d’art a pris dès lors son indépendance, il vadrouille, explore, va à la découverte sur Internet d’une création infiniment variée, surprenante, hors des normes et labels. Il se prend à jouir du privilège d’aimer.
* AC, acronyme de « Art contemporain ». Il ne désigne pas tout l’art d’aujourd’hui mais l’Art, généralement conceptuel, produit par les acteurs et institutions du haut marché international. ↩
* « Art Leaders Network » sous l’égide du New York Times réunit annuellement les personnalités décisionnaires du monde de l’Art (galeries, experts, foires, maisons de vente, galeries, ports francs, musées). Ce réseau permet collaborations et stratégies. Une partie des échanges est rendue publique. ↩
* 28 juillet Sotheby’s vente d’un portrait de Rembrandt avec de l’art moderne et contemporain. ↩
* L’ « @bay de luxe » de Sotheby’s. ↩
* Sotheby’s Gallery net work. ↩
Ces articles pourraient vous intéresser: Covid : pourquoi une telle soumission ? Covid-19 : et si les consignes devenaient enfin simples et souples ? Raoult, The Lancet, l’État : des questions d’éthique… et de politique Bilan du Covid : l’Homme, un « virus pour la planète » ?
http://dlvr.it/RgdCKq
http://dlvr.it/RgdCKq