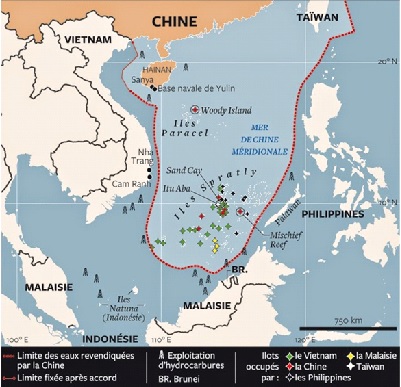1. Importance de la Mer de Chine méridionale Étant l'une des mers les plus importantes du monde, reliant deux grands océans Indien et Pacifique, ainsi que deux continents d'Asie et d'Océanie, la Mer de Chine méridionale abrite un grand nombre des routes maritimes les plus importantes et animées du monde, avec un passage annuel d'une valeur des marchandises de plus de 5000 milliards USD, ce qui représente 50% du volume de transport maritime et un tiers du volume du transport commercial du monde. Elle (...) Nos lecteurs proposent / Droit international , Vietnam , Chine
http://dlvr.it/RdcpHL
vendredi 14 août 2020
Kamala Harris, la gauche… en pire !
Par Ryan McMaken, depuis les États-Unis.
Un article du Mises Institute
Le candidat à la présidence et ancien vice-président Joseph Biden a annoncé le 11 août que Kamala Harris serait sa co-listière. Harris est sénatrice de Californie et ancien procureur général de l’État.
Le choix de Biden la ramène sur le devant de la scène dans la course à l’élection présidentielle de 2020, après qu’elle a renoncé à sa candidature début décembre.
Harris a abandonné car elle avait du mal à se démarquer des autres candidats comme Biden, qui représente le courant dominant du Parti démocrate. Alors qu’Elizabeth Warren et Bernie Sanders représentaient l’extrême gauche de la coalition démocrate, Harris n’était que l’une des nombreuses démocrates de l’establishment dans la course, et elle s’est disputée une grande partie des mêmes fonds que Biden et Amy Klobuchar.
En choisissant Harris, Joe Biden – ou quiconque prenant ces décisions – apaisera probablement les conseillers du parti Obama-Clinton qui s’opposent en privé aux législateurs comme Warren et Alexandria Ocasio-Cortez, considérés par les démocrates établis comme des candidats qui sont souvent coupés des électeurs de la classe moyenne américaine.
Dans le même temps, Harris devrait satisfaire – ou du moins faire taire – les critiques de l’aile gauche du parti, qui réclament depuis longtemps une femme noire sur la liste présidentielle.
En 2020, le choix d’un candidat à la vice-présidence est particulièrement important, car nombreux sont ceux qui pensent que Biden ne voudra ou ne pourra pas se présenter à la présidence en 2024.
Cela fait de Harris l’héritière du parti. Comme Biden sera le plus vieil homme à avoir jamais accédé à la présidence et qu’il n’est manifestement pas en excellente santé, on sait que Harris a de bonnes chances de lui succéder directement au cas où il mourrait ou tomberait gravement malade.
Mais bien que Harris soit «�démographiquement correcte » pour l’aile gauche du parti, elle reste fondamentalement une arriviste très bien installée dans le courant dominant du parti – bien que celui-ci se soit considérablement déplacé vers la gauche ces dernières années.
En matière de politique étrangère, par exemple, elle n’est pas très différente de Hillary Clinton, Barack Obama, Susan Rice, Joseph Biden ou d’autres hauts fonctionnaires américains qui ont été heureux de perpétuer des guerres sans fin dans le monde entier au cours des dernières décennies.
Selon son site officiel de campagne, aucune région du globe n’est à l’abri d’une intervention américaine tant que les États-Unis interviennent de manière multilatérale. Il s’agit encore une fois de la politique Clinton-Obama.
Dans son double langage habituel, elle se dit favorable à la fin de la guerre en Afghanistan mais insiste sur le fait que les États-Unis doivent maintenir une présence sur place pour soutenir le régime afghan. Elle a préconisé la poursuite de l’intervention militaire en Syrie.
Harris défend de manière fervente la théorie de la conspiration selon laquelle les Russes ont piraté les élections de 2016 et demeurent une menace majeure pour la sécurité des États-Unis.
En matière d’environnement, elle soutient un Green New Deal, ce que l’on attendrait aujourd’hui de tout démocrate se présentant à la Maison Blanche.
Cela signifie d’énormes quantités de nouvelles subventions en faveur de l’énergie verte, financées par de nouvelles taxes et une quantité de nouvelles réglementations à destination des entreprises privées, une gestion globale des émissions de carbone en cohérence avec les accords internationaux comme les accords de Paris.
En matière de politique économique, c’est la liste habituelle des politiques interventionnistes. Elle veut « responsabiliser » les syndicats, réglementer plus sévèrement les employeurs et poursuivre agressivement les entreprises pour toute une série de « crimes » définis dans le labyrinthe complexe des lois fédérales régissant le secteur financier. La politique budgétaire est incontestablement ce que nous attendons des républicains et des démocrates : des dépenses sans fin en déficit.
Harris a salué les mesures imposées par le gouvernement fédéral comme le forced busing, par lequel les tribunaux fédéraux dictent les politiques d’inscription des écoles publiques au nom de la déségrégation raciale des écoles.
Dans tout cela, nous ne trouvons pas grand-chose qui diffère des huit années de l’administration Obama. C’est le programme politique habituel de centre-gauche que nous avons vu depuis au moins l’élection de 2008.
Mais ce qui est particulièrement dangereux aujourd’hui, c’est que le contexte politique a considérablement changé. Les deux principaux partis américains ont adopté des positions beaucoup plus interventionnistes en termes de politique budgétaire, de politique monétaire et de pouvoir de police intérieure.
De plus, et depuis des décennies, la présidence a lentement évolué vers un système de règles par décret : le président gouverne essentiellement par cette voie, le Congrès n’intervenant qu’à la marge. L’administration Trump n’a fait qu’accélérer cette tendance.
C’est probablement une douce musique aux oreilles de Kamala Harris. Après tout, en tant qu’ancien procureur et candidate à la présidence, elle n’a jamais hésité à utiliser le pouvoir exécutif de manière agressive.
Comme l’a fait remarquer Tyler Curtis :
Au cours de sa campagne, elle a promis à plusieurs reprises de contourner le Congrès et de prendre des mesures unilatérales sur toute une série de questions très conflictuelles.
En matière d’immigration, elle s’est engagée à publier un décret accordant la citoyenneté aux dreamers (migrants amenés illégalement en Amérique par leurs parents).
En matière d’environnement, elle a déclaré l’état d’urgence et forcé le pays à adhérer de nouveau à l’accord de Paris sur le climat. Elle veut également interdire l’utilisation du fracturage.
De nombreux observateurs ont relevé le caractère dictatorial de ces déclarations, et ce à juste titre. Donner suite à l’une de ces propositions serait profondément suspect, mais leur nombre même, associé à l’attitude effrontément péremptoire de Harris, ne doit laisser aucun doute quant à ses ambitions autoritaires.
Pour Harris, le Congrès n’est au mieux qu’un organe consultatif. Par courtoisie, le président peut demander au Congrès l’autorisation de faire quelque chose, mais il n’a pas vraiment besoin de son assentiment.
Harris a même déclaré qu’elle ferait un dernier essai au Congrès à propos du contrôle des armes à feu :
Une fois élue, je donnerai 100 jours au Congrès américain pour qu’il se ressaisisse et ait le courage d’adopter des lois sur la sécurité des armes à feu. Et s’il ne le fait pas, alors je prendrais des mesures exécutives. Je vais notamment imposer à toute personne vendant plus de cinq armes par an l’obligation de se soumettre à une procédure de vérification de ses antécédents lorsqu’elle vend ces armes.
Ce sont les mots d’une femme politique qui considère le rôle du président comme celui d’un dictateur élu. De nombreux présidents, dont Donald Trump, ont aussi vu les choses de cette façon ; mais il est maintenant plus facile que jamais pour un président de mettre en œuvre ces promesses de ne pas attendre que le Congrès adopte des lois dûment promulguées. C’est faire les choses à l’ancienne.
La nouvelle manière est de suivre la stratégie de Barack Obama qui consiste à utiliser un stylo et un téléphone pour émettre des diktats sans avoir à faire appel à une assemblée législative élue.
Il ne fait aucun doute que de nombreux détracteurs de Harris la qualifieront de radicale ou d’instrument de l’extrême gauche. La réalité est en fait beaucoup plus alarmante. Les radicaux ont tendance à perdre des batailles politiques, car ils se basent souvent sur des principes.
Il est peu probable que Harris ait ce problème. C’est une joueuse avisée qui s’intègre bien dans le courant dominant du parti et qui poursuivra le programme politique de centre-gauche tel que nous l’attendons de la part de personnalités comme Hillary Clinton ou Barack Obama. Il n’y a pas grand- chose de nouveau ici.
Ce qui a changé, cependant, c’est que nous vivons dans un pays où les présidents sont de plus en plus prompts à prendre des mesures unilatérales pour faire ce qu’ils veulent.
Dans le passé, il aurait pu être raisonnable de penser que le Congrès pouvait intervenir efficacement pour restreindre les propositions moins populaires et plus radicales d’un président. Cette vision du régime américain semble plus éloignée que jamais de la réalité.
—
Traduction par Contrepoints de Kamala Harris Is Basically Obama-Clinton 2.0, but Worse Ces articles pourraient vous intéresser: Le mouvement #MeToo devient le cauchemar de Joe Biden Présidentielle US : Bernie Sanders déclare forfait, Joe Biden revient dans la course Démocratie américaine en danger : la polarisation politique remplace le consensus Nancy Pelosi lance une procédure de destitution contre Donald Trump
http://dlvr.it/RdcpHB
http://dlvr.it/RdcpHB
Batteries à charge rapide : les limites de la physique
Par Pierre Allemand.
On ne compte plus les annonces triomphales proclamant que la nouvelle batterie XZZ Plus (ou autre) va enfin résoudre le problème de la capacité et de la recharge rapide qui va rendre la voiture électrique aussi performante que le véhicule thermique classique avec un temps de recharge de moins de 5 minutes et une capacité kilométrique égale ou supérieure aux 800 km d’autonomie de la plupart des véhicules diesel d’aujourd’hui.
Et nos journalistes spécialistes de la question, voyant que les voitures électriques qui demandaient 24 heures de charge au début de l’époque moderne, ont vu leur temps de charge possible passer rapidement à 12 heures, puis 6 heures, et sembler se réduire rapidement au fil du temps, affirment, sûrs d’eux : les 5 minutes sont pour bientôt !
Eh bien non, répond le physicien. Il existe une barrière, invisible mais bien présente. La recherche sur les batteries
La recherche tous azimuts sur les batteries est très probablement le sujet qui a déjà mobilisé le plus de ressources de recherche dans le monde depuis plusieurs dizaines d’années. Et cela sans résultat vraiment probant : le saut technologique déterminant n’a jamais eu lieu (on pourrait s’étonner de cet acharnement, mais cela sort du sujet d’aujourd’hui).
On dit aussi que les nouvelles batteries sont le projet dont la période initiale de développement a duré le plus longtemps (150 ans ?). La raison en étant que la physique s’oppose obstinément à la découverte de batteries électriques douées de performances comparables à celles d’un modeste carburant issu de fossile.
Le défi est simple à énoncer, mais difficile à atteindre.� Il s’agit de créer une batterie possédant les caractéristiques suivantes :
* Capable de stocker autant d’énergie que celle contenue dans le réservoir d’un véhicule diesel classique, soit 60 litres de fuel, ou 48 kg.
* Rechargeable en moins de 5 minutes (temps d’un plein moyen).
* Ces deux premières performances ne diminuant pas pendant toute la durée de vie du véhicule.
* Restant entière (solidité) pendant toute la durée de vie du véhicule.
Malgré la formidable masse des recherches, les batteries actuelles (2020) sont encore éloignées de ces performances. Ajoutons qui plus est que la physique limite clairement les possibilités d’innovation dans ce domaine.
Le problème essentiel, jamais d’ailleurs évoqué clairement par les constructeurs, vient de la caractéristique numéro 2. Pour le comprendre, il faut examiner ce qui se passe dans le tuyau d’une pompe lorsqu’on fait le plein de carburant.
Je veux parler du débit énergétique, c’est-à -dire de la quantité d’énergie qui doit transiter, pendant le temps du plein ou de la charge, soit dans le tuyau, sous forme de carburant, soit dans le câble de recharge sous forme d’électricité.
Pour satisfaire à la condition numéro 2, il faut pouvoir faire passer dans le câble de recharge du véhicule électrique, une quantité d’énergie équivalente à celle qui transite par le tuyau, et c’est là que le bât blesse. Un des objectifs est impossible à atteindre
Voici pourquoi :
Le carburant diesel classique contient une énergie libérable par combustion de 44 mégajoules soit 12,2 kWh par kilo (référence).
Le plein (60 litres, soit 48 kilos) d’un réservoir de véhicule diesel contient donc une énergie libérable totale de :
12,2 x 64 = 585,6 kWh
Notons que la capacité1 des batteries équipant les voitures électriques actuelles est d’environ 50 kWh, soit de l’ordre de 10 fois moins que la valeur à atteindre ci-dessus et que la Tesla modèle 3 pourrait être équipée d’une batterie de 100 kWh, soit de l’ordre de 5 fois moins que cette valeur.
Cependant, il faut aussi tenir compte du rendement des opérations. D’après Wikipédia, le rendement global d’un véhicule thermique sur autoroute serait seulement de 20 % du carburant aux roues. L’énergie réellement utilisable à partir du plein est donc seulement de :
585,6 x 0,2 =117,1 kWh
Le rendement d’un véhicule électrique sur autoroute, toujours selon Wikipédia, est nettement meilleur : il serait de 74 % de la batterie aux roues, rendement qu’il faut encore multiplier par le rendement de la recharge de la batterie qui serait de 85 %.
Pour une comparaison équitable avec un véhicule électrique, il faut donc diviser les 117,1 kWh ci-dessus par le produit des rendement VE (moteur et recharge), et l’énergie devient :
117,1 / (0,74 x 0,85) = 186,2 kWh
L’énergie calculée ci-dessus doit être transférée par la pompe dans le réservoir en 5 minutes. La pseudo-puissance2 correspondant au transport dans ce temps de la même quantité d’énergie dans une hypothétique batterie à rechargement rapide (5 minutes, soit 1/12ème d’heure) sera donc de 585,6 x 12 = 2 234 kilowatts, soit environ 2,2 MW3
Cette valeur est plus proche de la puissance d’un transformateur de moyenne puissance alimentant plusieurs centaines de foyers, que de celle d’une installation domestique (environ 12 kW pour un grand logement).
Notons que comme il s’agit de transférer une quantité d’énergie électrique d’un générateur à une batterie, et cela dans un temps donné, le résultat de la division de la quantité d’énergie par le temps correspond bien, dans ce cas, à la puissance électrique du générateur de recharge.
C’est une quantité d’énergie électrique importante qui doit être transférée dans un temps relativement court. Pour fixer les idées, sous une tension de 500 volts continus4, le câble de liaison entre la station et la batterie devrait supporter une intensité de 2800 ampères, ce qui apparait assez irréaliste.
En effet, même en admettant que la batterie soit modifiée pour pouvoir recevoir une charge sous 500 volts continus et 2800 ampères et que l’on puisse installer une borne de recharge fournissant ces caractéristiques, la puissance demandée (plus de 2 mégawatts) est telle que cette borne ne pourrait être installée que dans certains sites précis et peu nombreux et qu’il ne serait pas question d’installer deux bornes au même endroit, ce qui correspondrait à une puissance de 4,4 MW.
Le câble capable de supporter les 2800 ampères demandés devrait, d’après les données de l’abaque p 14 (référence) être une barre de cuivre de 200 x 12,5 mm pour pouvoir supporter l’intensité avec un échauffement limité à 30°C au-dessus de la température ambiante. Ce genre de dispositif poserait des problèmes quasi insolubles quant à la connexion proprement dite (qualité des contacts) ainsi qu’au positionnement précis du véhicule par rapport à la barre d’alimentation.
Reconnaissons que ces contraintes sont telles qu’elles éliminent à la fois l’existence possible de stations de recharge régulièrement réparties le long des routes, mais également celle d’une configuration des batteries et des systèmes de liaison capables de supporter ces contraintes. Batteries : les solutions envisageables
Remplacer le cuivre par de l’argent.
L’argent étant le plus conducteur de tous les métaux, on peut espérer diminuer la contrainte dimension du conducteur en remplaçant le cuivre par de l’argent. Hélas, les différences de résistivité entre les deux métaux sont faibles (cuivre : 1,72 µohm.centimètre, argent : 1,59 µΩ.cm. (référence : CRC Handbook of Chemistry and Physics 46th edition).
Ce remplacement peut modifier au mieux de quelques pourcents les dimensions des conducteurs, sans amélioration fondamentale.
Utiliser la supraconductivité.
Il est possible de transporter un courant de 2800 ampères dans un matériau supraconducteur maintenu à une température inférieure à sa température critique par une circulation d’azote liquide = -195 °C. Comme la résistance d’un tel conducteur est nulle, ses dimensions peuvent être telles que le conducteur soit souple.
L’inconvénient majeur du système est l’obligation de maintenir le conducteur à sa température de fonctionnement, ce qui impose une lourde station de réfrigération à très basse température.
De plus, cette solution ne peut pas être étendue facilement aux conducteurs internes du véhicule, ce qui restreint l’avantage de la supraconductivité.
Se contenter d’approcher, sans les atteindre les objectifs critiques.
* La charge totale de la batterie est beaucoup plus difficile a atteindre qu’une charge partielle à 75 % ou même 50 %. En effet, dans ces cas, la valeur de l’énergie à transporter est multipliée par 0,75 ou 0,50, ce qui permet de réduire l’intensité dans les mêmes proportions : on passe à 2100 ampères (75 %) ou 1400 ampères (50 %).
* On peut se contenter de 10 minutes de temps de recharge, au lieu de cinq. L’intensité passe alors à 1050 A pour 75 % de charge et 700 A pour 50 % de charge.
* On peut accepter une capacité de la batterie divisée par deux (292,8 au lieu de 585,6 kWh, ce qui correspond encore à trois fois la capacité de la batterie de la Tesla 3. On arrive alors à 350 ampères, valeur qui devient réaliste avec les moyens actuels.
* Cette valeur peut encore être divisée par deux pour arriver finalement à 175 ampères, si on accepte de monter la tension de recharge à 1000 volts.
Il est probable que c’est vers cette troisième solution que les constructeurs vont se tourner, en oubliant les objectifs initiaux et en acceptant une autonomie réelle réduite (300 ou 400 km ?) et un temps de recharge de 10 minutes qui devient réaliste si le nombre des stations de recharge est important, et qu’on les trouve partout, ce qui est rendu possible par l’abaissement des contraintes. Conclusion
Ces petits calculs de coin de table montrent que les batteries des voitures électriques sont assez loin des performances d’un simple réservoir de carburant diesel.
Par ailleurs, il faut se résigner au fait qu’elles ne pourront tout simplement pas les atteindre, non pas pour des raisons liées aux batteries elles-mêmes, mais pour des raisons de puissance de distribution. Il faudra réduire nos ambitions. Et le véhicule électrique pour tous n’est probablement pas pour demain, ni même pour après-demain.
* La capacité d’une batterie est la quantité d’énergie électrique qu’elle est capable de restituer après avoir reçu une charge complète, pour un régime de courant de décharge donné, une tension d’arrêt et une température, définies. Elle est souvent mesurée (incorrectement) en ampèreheure, unité qui n’est pas une unité d’énergie. ↩
* Transférer (et non pas consommer) une certaine quantité d‘énergie en un certain temps t peut se noter E/t et a donc la dimension d’une puissance. On peut appeler pseudo-puissance le résultat de cette opération. ↩
* Attention, il ne s’agit pas d’une vraie puissance, mais du résultat de la division d’une énergie exprimée en kWh par un temps exprimé en heures. Le résultat s’exprime donc en kW et possède la dimension d’une puissance, mais il exprime une vitesse de transfert d’une énergie, et non une puissance. ↩
* Tesla et Porsche envisagent des bornes de recharge capables de recharger un véhicule en « une poignée de minutes » ce qui nécessiterait, d’après l’article en référence, une puissance d’alimentation de 600 kW. ↩
Ces articles pourraient vous intéresser: Le constructeur automobile européen, une espèce menacée (par l’écologie) L’essor de la voiture électrique tient en un chiffre : combien de dollars/kWh ? L’interdiction du véhicule thermique en 2040, une bien mauvaise loi (3) L’interdiction du véhicule thermique en 2040, une bien mauvaise loi (2)
http://dlvr.it/RdcpFX
http://dlvr.it/RdcpFX