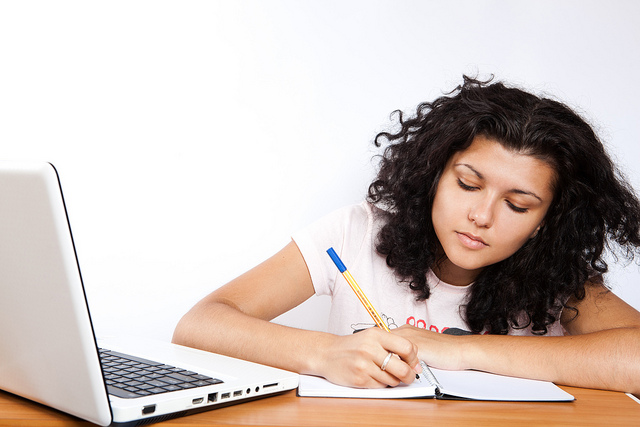Par Roland Verney.
Que ce soit à la suite de dénonciations ou en raison de la baisse brutale d’activités de livraison de repas, une fois levées les restrictions de circulation imposées par les autorités, il est à parier que les sociétés de préparation de plats à livrer vont se séparer d’une bonne partie de leurs livreurs.
Ceux-ci sont majoritairement des immigrés en situation irrégulière, donc aisément licenciables par les employeurs, ou des demandeurs d’asile en attente du statut de réfugié, ayant obtenu le statut d’auto-entrepreneur d’une façon ou d’une autre. Étrangers n’ayant ni contrat de travail ni promesse d’embauche, ils pourront solliciter une admission exceptionnelle au séjour et au travail, grâce à la circulaire Valls, assortie de diverses conditions.
Sauf que cette circulaire n’est pas un règlement de droit, mais une recommandation adressée à l’administration elle-même. Son application n’est donc pas automatique, mais dépend de l’interprétation des fonctionnaires.
Compte tenu de la longueur et de l’incertitude des démarches pour obtenir les droits au séjour et au travail, très variables selon la situation personnelle des sans-papiers, il est prévisible que nombre des ex-livreurs vont se retrouver sans emploi et sans rémunération. La voie légale vers le séjour en France
Il faut savoir que 125 000 demandes d’asile ont été enregistrées en 2019 en France. Les délais de démarches et attentes diverses peuvent être estimés à six mois minimum et s’étendre jusqu’à une année et plus, avant de se voir accepter ou refuser le statut officiel de demandeur d’asile ou de réfugié.
Pendant ce temps, où se loger ? Les CADA (Centres d’accueil des demandeurs d’asile) sont réservés aux immigrés ayant obtenu de l’OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) le statut officiel.
Les autres, en attente de décision, n’ont d’autre recours qu’un accueil chez des amis, la famille déjà en France ou bien un hébergement aléatoire et toujours provisoire proposé par des associations dédiées (Cimade, Forum Réfugiés, etc.).
Comment subvenir à ses besoins ? L’OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration) accorde aux demandeurs d’asile et réfugiés statutaires une allocation de 6,80 euros par jour et de 7,40 euros en cas de non-hébergement.
Les autres ne disposent de rien, sauf évidemment s’ils ont pu emporter et garder un pécule pendant leur périple jusqu’en France, ou si une association dédiée a la possibilité de leur offrir repas et argent de poche.
Alors, comment obtenir un emploi rémunéré pour commencer à gagner sa vie en France ? Si un étranger immigré trouve un entrepreneur qui accepte de l’embaucher comme salarié, encore faut-il qu’il ait franchi toutes les étapes de demande d’asile :
* élection d’un domicile même provisoire, rendez-vous à la SPADA (Structure du premier accueil des demandeurs d’asile), puis à l’OFII et à la préfecture, constitution d’un dossier complet de demandeur, convocation à l’OFPRA à Fontenay-sous-Bois, notification de décision ;
* admission au statut de demandeur d’asile ou de réfugié par l’OPFRA (droit au séjour, droit au travail) ;
* obtention d’une autorisation de travail salarié, que la préfecture peut toujours lui refuser, le plus souvent en raison de la concurrence réelle ou supposée de candidats français sur ce type de poste.
Quelques grandes entreprises peuvent-elles réagir plus vite que l’État ?
L’économie capitaliste libérale, qui actuellement gouverne la société, ne peut se permettre de subventionner les pauvres, ce n’est pas dans son ADN. Seule l’intégration rapide dans le marché du travail est une solution rentable à ses yeux.
En effet, le développement perpétuel de la consommation de masse permet la rentabilité et la pérennité du système libéral. Davantage de travailleurs rémunérés, plus de consommateurs réguliers.
Combien de livreurs de repas sans-papiers en France ? Il n’existe pas de statistiques aisément disponibles sur ce point. On le comprend, mais une évaluation fondée sur le chiffre d’affaires des trois plus importants employeurs du secteur (Deliveroo, Just Eat, Uber Eats) et un taux d’illégalité de 50 % fournit un nombre très approximatif minimum de 40 000 livreurs de repas sans-papiers.
En effet, on ne voit pas très bien comment cette charge supplémentaire de 30 % de dossiers de demande d’asile, actuellement de l’ordre de 130 000, pourrait être absorbée par l’OFPRA dans un délai de quelques semaines.
Or il faut faire vite.
Comme le capitalisme libéral n’est pas près de laisser 40 000 consommateurs sur le carreau, les ténors de l’industrie et du commerce (PSA, Total, Airbus, SFR, Leroy Merlin, BNP Paribas, etc.), doivent donc se mobiliser rapidement, malgré les déboires momentanés qu’ils subissent du fait de la crise.
Ils ont, en particulier, les moyens financiers, humains et juridiques d’inciter leurs fournisseurs éparpillés sur le territoire à proposer des emplois aux livreurs sans-papiers, éparpillés eux aussi à l’instar des plateformes de préparations de repas.
Pour les fournisseurs volontaires, il s’agira aussi d’échapper aux sanctions pouvant frapper les employeurs qui ont recours au travail illégal : c’est là que doit intervenir la force de frappe des grandes entreprises françaises.
L’image de l’immigré doit enfin changer, une fois pour toutes, chez nos concitoyens. Il faut savoir que chaque immigré a son histoire et que 30 % d’entre eux ont une formation allant des études secondaires à l’enseignement universitaire. Pour quitter son pays et sa famille, en courant souvent les plus grands dangers, il faut avoir du courage, une volonté inébranlable et un projet de vie sérieux. Il est stupide d’associer systématiquement immigré à manœuvre ou à plongeur.
Dans une opération de recrutement de style libéral, il est donc primordial de diriger les livreurs sans-papiers vers des entreprises et des emplois adaptés aux capacités de ceux-ci.
Aux Directions des Ressources humaines, des Affaires juridiques et de la Communication de nos grandes entreprises libérales de montrer tout leur savoir-faire ! Ces articles pourraient vous intéresser: Quotas d’immigration : l’État est-il le mieux placé pour décider ? Le monde occidental se retranche dans un bunker qu’il a lui-même construit Milton Friedman condamnerait la politique anti-immigration de Donald Trump Ce n’est pas l’immigration qui menace l’identité française
http://dlvr.it/RdTKrY
mercredi 12 août 2020
Délinquance des mineurs : préserver l’équilibre de la réponse pénale
Par Jean-Michel Arnaud.
« Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l’enfance, et, parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l’enfance traduite en justice. La France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. »
Ces mots issus de l’exposé des motifs de l’Ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, illustrent bien le principe qui constitue le fondement de la justice des mineurs : le primat de l’éducatif sur le répressif.
Ce principe cardinal est aujourd’hui mis à mal par des réformes successives qui ont à la fois durci et obscurci le traitement de la délinquance juvénile. Justice des mineurs devenue illisible
Contrairement à ce que les tenants d’un certain populisme sécuritaire mettent en avant, il n’y a guère d’ « ensauvagement » de la jeunesse française qui nécessiterait un durcissement de la réponse judiciaire, par exemple en abaissant la majorité pénale à 16 ans.
La litanie des faits divers, aussi choquants soient-ils, ne peut faire oublier la réalité des chiffres : la délinquance juvénile est stable, voire en baisse, alors même que la judiciarisation de la société s’accroît. Les trois-quarts des infractions commises par des mineurs restent non violentes.
L’enjeu n’est pas de durcir la justice des mineurs, mais de l’améliorer pour que les jeunes concernés puissent être remis dans le droit chemin et réintégrés à la société.
Cette justice est aujourd’hui devenue illisible : l’ordonnance de 1945 a été modifiée à trente-neuf reprises. Un nouveau Code pénal des mineurs devrait entrer en vigueur le 1er octobre 2020, une réforme qui vise à modifier et à simplifier la procédure pour répondre à la délinquance juvénile de manière plus adaptée et plus rapide.
Tout mineur sera jugé dans les trois mois et, si déclaré coupable, sera alors suivi pendant 6 à 9 mois par un éducateur avant qu’une sanction ne soit décidée. Une présomption d’irresponsabilité pénale fixée à treize ans est introduite, contre ce qui n’était autrefois que l’âge du « discernement », et les spécificités de la justice des mineurs sont réaffirmées. Prévention et réparation
L’enjeu n’est peut-être pas tant dans le contenu des textes que dans la réalité des moyens attribués. L’individualisation des peines et du suivi, les mesures éducatives et les placements ne peuvent s’effectuer dans de bonnes conditions dans le contexte d’étouffement budgétaire qui frappe le système judiciaire français depuis des années.
La prise en charge en milieu ouvert, qui est selon les professionnels et les chercheurs le meilleur moyen d’accompagner les jeunes délinquants, pâtit cruellement du manque de moyens de l’institution. La baisse des moyens alloués par l’État met également sous pression les budgets des départements, garants de la protection de l’enfance.
La réparation est aussi une réponse qui doit être développée.�Intégrée en 1993 dans l’ordonnance de 1945, cette mesure donne l’occasion au jeune de remédier au trouble causé en réparant directement les conséquences de son acte auprès de la victime ou en participant à une activité d’intérêt général.
Cette sanction éducative doit lui permettre de prendre conscience du tort causé tout en favorisant sa réinsertion. Mais là aussi, rien ne peut se faire sans moyens pour organiser les activités et le suivi de ces jeunes.
L’accent doit enfin être mis sur la prévention, alors même que la majorité des mineurs délinquants se trouvent dans une situation de fragilité : précarité, rupture des liens familiaux, difficultés d’insertion sur le marché du travail.
Le Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR) vient de présenter sa nouvelle stratégie, marquée par la volonté de commencer la prévention au plus tôt, de favoriser la réinsertion sociale afin d’éviter la récidive, de développer la concertation avec les collectivités locales et d’impliquer davantage les familles. La prison n’est pas la solution
Il ne s’agit pas d’être angélique et de dépeindre une jeunesse qui ne serait que victime. De nombreux mineurs ont conscience de la gravité de leurs actes et certains peuvent représenter un danger pour la société. Pour ces derniers, la possibilité d’écarter l’excuse de minorité et d’envisager l’emprisonnement doivent demeurer des soupapes disponibles.
Malheureusement, l’incarcération est devenue bien trop commune : au 1er octobre 2019, 801 mineurs étaient détenus en France.
déOr, de nombreux jeunes ne sont pas détenus dans l’un des six établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs mais dans des quartiers pour mineurs de prisons pour adultes où un véritable suivi socio-éducatif n’est pas garanti, sans parler de l’état de vétusté et de surpeuplement du système pénitentiaire français.
Il est fondamental de conserver l’équilibre qui a fondé la justice des mineurs. Protéger la société nécessite de traiter à la racine les causes de la délinquance juvénile et de permettre aux jeunes en rupture de reprendre pied, pas de les condamner dès le plus jeune âge à un parcours carcéral dont la conclusion est bien souvent la récidive. Ces articles pourraient vous intéresser: Délinquance des mineurs : préserver l’équilibre de la réponse pénale Nouvelle réforme inutile : la justice pénale des mineurs Éco-délégués : les nouveaux petits soldats verts Le débat sur la majorité pénale n’est pas un débat mineur
http://dlvr.it/RdTKqj
http://dlvr.it/RdTKqj
Résidences étudiantes privées : l’alternative pour la rentrée ?
Par Léonard Bordais.
C’est la rentrée�! Et comme chaque année, de nombreux étudiants rencontrent le même problème : trouver un logement. Face à la pénurie de place en résidence Crous, beaucoup se tournent vers l’alternative de la résidence privée. Résidences étudiantes : une offre toujours insuffisante
La question du logement étudiant ne date pas d’hier. Non réglée, elle revient sur la table à chaque rentrée universitaire. Il faut dire que le problème est de taille. Selon une étude de l’Afev (Association de la fondation étudiante pour la ville) réalisée en 2015, 68 % des 18-30 ans rencontrent des difficultés pour trouver un logement. Une offre insuffisante, des loyers souvent trop élevés, etc.
Autant d’éléments rendant la recherche d’un appartement difficile. De plus, la question de l’emménagement soulève de nouvelles difficultés pour beaucoup d’étudiants. Effectuer un déménagement à moindres frais quand on arrive seul dans une ville n’est pas une mince affaire.
Certes, l’État propose la location de studios en résidences Crous. Ne dépassant généralement pas les 20 m², ils disposent d’un mobilier sommaire mais suffisant. Mais le nombre de logements se révèle trop insuffisant. On compte 169 000 places contre un effectif de près de 2,5 millions d’étudiants séjournant en France. La solution des résidences privées ?
De plus en plus d’étudiants se tournent alors vers l’alternative des résidences privées. Celles-ci proposent des appartements entièrement meublés. Dans plusieurs d’entre elles, les abonnements comme l’eau ou l’électricité s’avèrent déjà inclus dans l’offre.
À cela s’ajoutent divers services complémentaires comme la location d’une place de parking ou la présence d’une laverie. Ces résidences font donc directement concurrence à l’offre étatique. Leur nombre ne cesse d’ailleurs d’augmenter. Elles sont présentes dans de grandes villes étudiantes (Lyon, Montpellier, Marseille, etc.) et des villes plus petites comme Angers ou Mulhouse. L’État pousse à cette alternative privée
Constatant son incapacité à régler le problème du logement étudiant, l’État laisse la place au marché. Comment ? En poussant les particuliers au financement de résidences étudiantes privées ! Investir dans un logement en résidence services donne en effet la possibilité de réduire ses impôts.
Ce type d’investissement bien spécifique permet de bénéficier des avantages du statut LMNP (Loueur Meublé Non Professionnel). Il offre par exemple une déduction fiscale de 11 % étalée sur neuf ans.
L’avenir du logement étudiant se trouverait-il donc dans le secteur privé ? C’est en tout cas ce que laisse penser la conjoncture actuelle. Certes, de nouvelles places en résidences Crous se créent. Le gouvernement souhaite d’ailleurs la construction de 40 000 nouveaux logements d’ici 2017.
Mais cette incitation à l’investissement ainsi que l’augmentation importante du nombre de résidences privées semblent confirmer cette tendance. Étonnant ? Pas vraiment… Comme dans beaucoup de domaines, l’initiative privée et le marché apportent une réponse bien plus réactive que les pouvoirs publics.
Article initialement publié en août 2016. Ces articles pourraient vous intéresser: Précarité étudiante : le gel des loyers des résidences n’est pas la solution miracle Location saisonnière : 6 conseils pour plaire aux familles nombreuses Bail Mobilité : la guerre contre le marché du logement continue Location meublée : une optimisation fiscale qui va disparaître ?
http://dlvr.it/RdTKqJ
http://dlvr.it/RdTKqJ