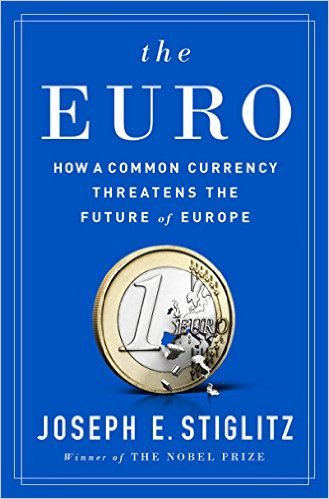| Source : Russeurope, Jacques Sapir, 30-06-2016 Le « Brexit » jette une lumière particulièrement crue sur la stratégie de « fédéralisme furtif » adoptée par les dirigeants européens depuis le traité de Maastricht et en conséquence sur l'idéologie européiste qui sous-tend cette stratégie. C'est en réalité cette stratégie, et son instrument privilégié, l'Euro, qui ont provoqué cette réaction des électeurs britanniques, les poussant à quitter non pas « l'Europe » comme certains le prétendent mais une institution particulière, l'Union européenne. Les choix des électeurs britanniques a été largement expliqué[1]. Le fait que des personnalités du gouvernement britannique, comme le ministre de la justice Michael Gove, aient appelé à voter pour la sortie de l'UE est significatif. Le Brexit remet donc en cause ce qui constitue aujourd'hui la colonne vertébrale de la politique qualifiée d'européiste, que ce soit celle de François Hollande ou celle d'Angela Merkel. Le choc va donc bien plus loin que celui de la sortie de l'UE d'un pays, la Grande-Bretagne, dont l'appartenance à cette dite UE était en fait des plus lâches. Cette crise de la stratégie européiste est un point de rupture. Ce n'est qu'en nous débarrassant de l'aporie européiste que nous pourrons réellement penser la construction de l'Europe. Les bases idéologiques du fédéralisme furtif Il convient en premier lieu de comprendre la démarche dite de « fédéralisme furtif » qui a été adoptée à partir du traité de Maastricht et qui s'incarne dans l'Euro. Cette stratégie se fonde sur un rejet des Nations, que ce rejet soit lié à une méfiance ou qu'il soit lié à une véritable haine des dites Nations. C'est pourquoi ont communié dans cette démarche à la fois des libéraux conservateurs, qui considèrent que la Nation moderne implique la Démocratie et qui restent fidèles à cette méfiance profonde envers le peuple de la pensée conservatrice, des anciens « gauchistes » (et Cohn-Bendit en est l'un des exemples) qui haïssent en la Nation cette accumulation de médiations ancrées dans l'Histoire qu'ils perçoivent comme un obstacle à leur vision millénariste et apocalyptique d'une « fin » de l'Histoire[2], ou que ce soit des sociaux-démocrates qui cherchent à transposer vers un niveau étatique supérieur ce que la mollesse de leurs politiques les empêchent de réussir dans le cadre national. Ces différents rejets de la nation s'articulent eux-mêmes de manières spécifiques compte tenu de la culture politique de chaque pays. En France, c'est la combinaison de la démission d'une grande partie de l'élite politique en 1940 qui vient s'associer à un sentiment issu du traumatisme des guerres coloniales. En Allemagne, c'est le poids de la culpabilité collective issue du Nazisme, aggravée par le traumatisme de la division en deux de 1945 à 1990 qui explique cette montée de l'européisme dans les élites. L'Allemagne, pays objectivement dominant de l'UE ne s'autorise pas à penser sa propre souveraineté et ne peut la vivre qu'en contrebande, dans la mesure où elle prend la forme d'une souveraineté « européenne ». On ne peut comprendre autrement les fautes politiques commises tant vis-à-vis de la Grèce que sur la question des réfugiés, fautes qui aujourd'hui viennent hanter Angela Merkel. En Italie, c'est là encore la combinaison de l'épisode Mussolinien et des « années de plomb » qui ont convaincu une grande partie de la classe politique que l'Union européenne était la seule issue à la Nation italienne. Et l'on peut multiplier les exemples, en y incluant des pays qui s'aiment mal (Espagne, Portugal) ou qui se savent irrémédiablement divisés (la Belgique). Mais, et c'est une évidence, un projet politique issu d'une haine de soi ou d'un mal-être ne peut avoir d'avenir. Telle était la première faille de l'européisme et du fédéralisme furtif. Car, engendré par une vision essentiellement négative, il ne peut être porteur d'avenir. Le rôle politique de l'Euro Ce projet s'est incarné essentiellement dans l'Euro. La précipitation qui vit les politiques accepter l'idée de monnaie unique, alors que les conditions nécessaires à sa réussite n'étaient nullement réunies, et qu'il eut été bien plus logique de s'en tenir à une monnaie commune, soit une monnaie venant coiffer mais non remplacer les monnaies nationales, ne peut s'expliquer que par des motifs politiques et psychologiques impérieux[3]. Ici encore, ils furent différents suivant les pays, mais ils ont tous convergé dans cette idée qu'une fois la monnaie unique réalisée, les pays de la zone Euro n'auraient d'autres choix que le fédéralisme. Ce qui avait été négligé cependant dans ce processus c'était le fait que le fédéralisme n'est pas un objectif unifiant. Il peut y avoir diverses formes de fédéralisme. Or, faute d'un débat public, débat contradictoire avec une stratégie imposant la furtivité et la dissimulation, il ne pouvait y avoir d'instance à même de trancher entre ces différentes formes de fédéralisme. Ainsi l'Allemagne conçoit le fédéralisme comme un système qui lui donne un droit de regard sur la politique des autres pays mais sans devoir en payer le prix budgétaire. C'est le fédéralisme mesquin. La France, elle, voit dans les structures fédérales la poursuite de l'histoire de sa propre construction étatique et entend imposer un fédéralisme donnant naissance à un nouvel Etat-Nation. Mais, c'est faire fi justement des spécificités de l'Histoire, et du fait que la Nation et le Peuple se sont construits en parallèle (et avec de multiples interactions) sur près de 8 siècles. De ce point de vue, seule l'Histoire de la Grande-Bretagne est pleinement comparable. L'idée implicite était de réaliser par la ruse ce que l'Empire napoléonien n'avait pu par la force. Cette idée se fondait sur les illusions de l'universalisme français qui confond des valeurs avec des principes. C'est cette énorme erreur, qui a engagé les dirigeants français, de gauche comme de droite, dans une voie sans issue. Car, ce qui bloque dans l'option fédéraliste est à la fois une notion politique, quel serait donc le « souverain » et une question économique, celle des transferts. On sait, et on l'a dit à de nombreuses reprises, que ces transferts exigeraient le versement d'environ 10% (entre 8% et 12% selon les études) du PIB allemand au « budget fédéral »[4]. Il n'est donc pas surprenant que les Allemands ne veuillent pas car, en réalité, ils ne peuvent pas. Le refus de l'Allemagne de réviser les règles pour permettre à l'Italie de faire face à se crise bancaire montre toutes les limites de la notion de solidarité qui est essentielle dans une fédération. Or, si cette solidarité n'est pas réalisée, comment convaincre les peuples de se fondre démocratiquement dans un grand ensemble ? Et l'on retrouve ici la question politique du souverain[5]. Le « fédéralisme » est donc condamné soit à ne pas être soit à n'exister que sous la forme du fédéralisme mesquin soit un droit de regard asymétrique de l'Allemagne sur la politique des autres pays. C'est le constat que tire Joseph Stiglitz dans son dernier livre[6], dont une traduction française sortira cet été. Soit nous mettons fin à l'Euro, soit nous avançons vers un fédéralisme inclusif dont ni les Allemands ni les Néerlandais ne veulent, soit l'Euro sera la mort de l'UE mais aussi et c'est bien plu grave de l'idée de coopération en Europe. 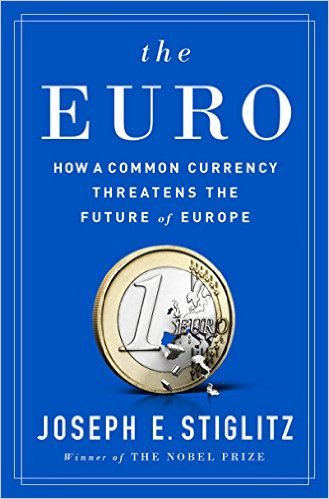
La responsabilité des européistes D'ores et déjà, les dégâts provoqués par l'Euro sont importants. Conçu pour rapprocher et unir l'Europe, l'Euro a fait effectivement le contraire: après une décennie sans croissance, l'unité a été remplacée par la dissidence et l'agrandissement par le risque de sorties. La stagnation de l'économie européenne et les sombres perspectives actuelles sont donc le résultat direct des défauts fondamentaux inhérents au projet de l'Euro – l'intégration économique prenant le pas sur l'intégration politique avec une structure qui favorise activement la divergence plutôt que convergence. Mais, le plus important ont été ses conséquences politiques[7]. L'UE (et non la seule zone Euro) s'est engagée dans un processus politique où la démocratie a été progressivement retirée aux peuples. Le cas du traité « Merkozy », ou TSCG, voté par la France en septembre 2012, a été exemplaire à cet égard. Et le soulèvement démocratique de la Grande-Bretagne peut être lu comme une réaction à ce fédéralisme mesquin qui se met peu à peu en place, sous la volonté du gouvernement allemand et avec la passivité du gouvernement français. Il est donc clair aujourd'hui qu'il faut liquider l'européisme et ses instruments si nous ne voulons pas nous retrouver d'ici quelques années, voire quelques mois, dans une situation où les conflits entre Nations, parce qu'ils auront été trop longtemps niés, ne trouveront plus d'espace où un compromis sera possible entre des intérêts divergents. Il convient donc de dire ici quelle est la responsabilité historique des européistes, de leur idéologie de haine des Nations, et de leur instrument, l'Euro. Dans la crise que nous traversons aujourd'hui, et dont la sortie de l'UE par le Royaume-Uni n'est qu'un aspect, la crise bancaire italienne qui vient en constituant un autre, la responsabilité des européistes, et de tous ceux qui les ont laissé faire, est centrale ; elle est fondamentale. La rupture avec l'idéologie européiste est donc un acte de salubrité public. Non qu'il soit en lui-même suffisant. Rejeter cette idéologie, tourner le dos au fédéralisme furtif, reconnaître le cadre de la Nation comme étant celui au sein duquel vit et se nourrit la démocratie, ne produira pas immédiatement de solution. Mais, cela rendra possible la recherche d'une solution, tant au niveau de la France qu'à celui de l'Europe. C'est donc une condition certes non suffisante mais absolument nécessaire. Cette solution, on l'a déjà évoquée avec cette idée de Communautés des Nations Européennes. Elle devra être certainement précisée et peut-être amendée, mais du moins est-ce dans cette direction qu'il nous faut aller. Notes [1] Sapir J., Brexit (et champagne), https://russeurope.hypotheses.org/5052 [2] Voir https://russeurope.hypotheses.org/5059 [3] Sapir J., Faut-il sortir de l'euro ?, Le Seuil, Paris, 2012. [4] Sapir J., Macron et le fantôme du fédéralisme en zone Euro http://russeurope.hypotheses.org/4291 et Fédéralisme?https://russeurope.hypotheses.org/4347 [5] Sapir J., Souveraineté, Démocratie, Laïcité, Paris, Michalon, 2016. [6] Stiglitz J., The Euro – How a common currncy threatens the future of Europe, Pinguin, Londres, mai 2016 [7] http://www.bloomberg.com/news/features/2016-06-30/after-brexit-here-s-what-s-next-for-europe Source : Russeurope, Jacques Sapir, 30-06-2016 ======================================= De la haine de la démocratie dans l'UE Source : Russeurope, Jacques Sapir, 01-07-2016 Les principaux responsables de l'Union européenne se déchaînent contre la pratique des référenda, considérée comme non démocratique. Ceci peut se comprendre à la suite du référendum britannique, mais ne constitue en réalité qu'une argutie qui vise à renforcer la déclaration de Jean-Claude Juncker de janvier 2015 où il déclarait « qu'il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens ». En fait, si l'on regarde l'histoire des référenda depuis le traité de Maastricht, elle est effectivement édifiante : 
On constate que sur 8 référenda, seuls 2 ont été respectés. La pratique de l'Union européenne, et des gouvernements dans le cadre de cette Union européenne, se révèle donc largement anti-démocratique puisque remettant en cause dans 75% des cas un vote démocratiquement exprimé. De la pratique à la théorie… Cette position n'est pas seulement une pratique. Elle a été théorisée dans une critique qui s'avère parfaitement convergente avec le discours tenu par l'Union Européenne. Il convient de s'y arrêter un instant pour chercher à comprendre de quoi il retourne en la matière. Jakab, après une analyse comparée des diverses interprétations de la souveraineté, avance pour le cas français que : « La souveraineté populaire pure fut compromise par un abus extensif de referenda sous le règne de Napoléon Ier et de Napoléon III, la souveraineté nationale pure ayant été perçue comme insuffisante du point de vue de sa légitimation[1] » C'est soutenir qu'un abus pervertirait le principe ainsi abusé. Mais il ne peut en être ainsi que si l'abus démontre une incomplétude du principe et non de sa mise en œuvre. Viendrait-il à l'esprit des contemporains de détruire les chemins de fer au nom de leur utilisation par le Nazis dans la destruction génocidaire des Juifs et des Tziganes ? Or, ceci est bien le fond du raisonnement tenu par Jakab. Pourtant, il est loin d'être évident dans l'usage politique fait du plébiscite que cet usage soit le seul possible. Si un plébiscite est bien un instrument non-démocratique, tout référendum n'est pas à l'évidence un plébiscite. La confusion établie par l'auteur entre les deux notions est très dangereuse et pour tout dire malhonnête. La pratique qui consiste à assimiler référendum et plébiscite, car c'est de cela dont il est question dans le texte, est une erreur logique. La discussion se poursuit sur la portée qu'il faut attribuer à la décision du Conseil Constitutionnel concernant la Nouvelle Calédonie où il est dit que « la loi votée… n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution »[2]. Ici encore, on pratique de manière volontaire la stratégie de la confusion. Ce que reconnaît le Conseil Constitutionnel, en l'occurrence, c'est la supériorité logique de la Constitution sur la Loi. Ce n'est nullement, comme le prétend à tort Jakab l'enchaînement de la souveraineté. En fait, dire que le processus législatif doit être encadré par une Constitution ne fait que répéter le Contrat Social de Rousseau[3]. Ce qui est en cause est bien le parti pris de cet auteur est de refuser ou de chercher à limiter le concept de Souveraineté. Le positivisme juridique Pour pouvoir ainsi limiter le principe de souveraineté, il est fait appel aux travaux de Hans Kelsen[4]. On sait que, pour ce dernier, le droit d'un État est subordonné au droit international, ce dernier existant de manière implicite à travers un système de « lois naturelles » qui seraient propre à la condition humaine, servant alors de normes pour le droit des États. C'est le principe de la norme hypothétique fondamentale, dite aussi la Grundnorm (Grund désignant le fondement). On est ici en présence d'une norme de nature logico-transcendantale[5]. Kelsen est fortement influencé par la logique du néo-Kantisme et la Grundnorm apparaît au sommet de la pyramide des différents niveaux de lois. Mais, les thèses de Kelsen sont loin de faire l'unanimité. Il lui est reproché, et non sans raison, un positivisme juridique[6] qui aboutit à un aplatissement des principes du droit. Les études de cas proposées dans l'ouvrage de David Dyzenhaus, The Constitution of Law, aboutissent à mettre en évidence une critique de ce positivisme. Elle permet de comprendre comment l'obsession pour la rule by law (i.e. la légalité formelle) et la fidélité au texte tourne bien souvent à l'avantage des politiques gouvernementales quelles qu'elles soient. À quelques reprises, l'auteur évoque ses propres analyses des perversions du système légal de l'Apartheid[7] en rappelant que cette jurisprudence avilissante tenait moins aux convictions racistes des juges sud-africains qu'à leur « positivisme»[8]. Dans son principe, ce positivisme représente une tentative pour dépasser le dualisme de la norme et de l'exception. Mais on voit bien que c'est une tentative insuffisante et superficielle. En tant que via del mezzo, le positivisme échoue car il ne prend pas l'exception assez au sérieux. Quelle norme ? Néanmoins, on peut aussi soutenir que la Grundnorm est une norme hypothétique, un choix épistémologique qui permet de comprendre la juridicité de la Constitution et donc de l'ensemble de l'ordre juridique. En tant que norme supposée, elle ne disposerait d'aucun contenu. La démarche kelsénienne se situerait donc, en réalité, aux antipodes de la recherche jusnaturaliste des fondements d'un droit basé sur des normes morales[9]. Mais, sur ce point, il est difficile de distinguer les différentes étapes de l'évolution de Kelsen, mais surtout de distinguer entre Kelsen et ses épigones et ses héritiers. La critique en jusnaturalisme semble ici bien pertinente à propos de l'héritage de Kelsen. À l'inverse, on peut considérer que le Droit International découle au contraire du Droit de chaque État, qu'il est un Droit de coordination[10]. C'est la logique développée par Simone Goyard-Fabre[11]. De plus, la notion de « loi naturelle » pose un vrai problème en ceci qu'elle prétend établir une spécificité radicale de l'action humaine, un schéma dans lequel il n'est que trop facile de voir une représentation chrétienne (la « créature » à l'image de son « créateur »). Accepter ceci sans discussion reviendrait à établir le Christianisme comme norme supérieure pour la totalité des hommes, et par là même à nier l'hétérogénéité religieuse avec toutes les conséquences dramatiques que cela impliquerait. Centralité de la souveraineté Andras Jakab se voit alors obligé de reconnaître que : « malheureusement, du point de vue de la définition de la notion, la souveraineté comme telle n'est définie dans aucun traité international (peut-être parce qu'un accord sur cette question serait impossible »[12]. Il ajoute quelques lignes plus loin : « Mais l'acceptation totale du premier droit du souverain, c'est-à-dire l'exclusivité, n'est pas satisfaisante vu les défis nouveaux, notamment la mondialisation »[13]. Ce faisant il glisse, dans le même mouvement, d'une position de principe à une position déterminée par l'interprétation qu'il fait – et que l'on peut réfuter – d'un contexte. Cette démarche a été critiquée en son temps par Simone Goyard-Fabre : « Que l'exercice de la souveraineté ne puisse se faire qu'au moyen d'organes différenciés, aux compétences spécifiques et travaillant indépendamment les uns des autres, n'implique rien quant à la nature de la puissance souveraine de l'État. Le pluralisme organique (…) ne divise pas l'essence ou la forme de l'État; la souveraineté est une et indivisible« [14]. L'argument prétendant fonder sur la limitation pratique de la souveraineté une limitation du principe de celle-ci est, quant au fond, d'une grande faiblesse. Les États n'ont pas prétendu pouvoir tout contrôler matériellement, même et y compris sur le territoire qui est le leur. Le despote le plus puissant et le plus absolu était sans effet devant l'orage ou la sécheresse. Il ne faut pas confondre les limites liées au domaine de la nature et la question des limites de la compétence du Souverain. La démarche de Jakab a pour objet, consciemment ou inconsciemment, de nous présenter le contexte comme déterminant par rapport aux principes. La confusion entre les niveaux d'analyse atteint alors son comble. Cette confusion a naturellement pour objet de faire passer pour logique ce qui ne l'est pas : la subordination de la Souveraineté. Or, cette subordination est contraire aux principes du droit. Il n'est guère étonnant, dans ces conditions, que l'article de Jakab ait reçu tant de distinctions des institutions de l'Union Européennes. On comprend mieux aussi pourquoi il va, dans une autre partie de son article parler de « l'ignorance [des Etats membres] par rapport au défi constitutionnel de l'appartenance à l'UE ». Cela revient à dire que la Souveraineté pourrait être mise à mal par l'existence de liens contractuels entre les États. On retrouve ici l'idée que les traités doivent s'imposer sur les choix démocratiques, autrement dit que le suffrage universel n'est plus l'expression de la souveraineté. Nous en sommes là dans la dérive que connaît aujourd'hui l'Union européenne et ses thuriféraires. Notes [1] Jakab A., « La neutralisation de la question de la souveraineté. Stratégies de compromis dans l'argumentation constitutionnelle sur le concept de souveraineté pour l'intégration européenne », in Jus Politicum, n°1, p.4, URL : http://www.juspoliticum.com/La-neutralisation-de-la-question,28.html [2] Décision 85-197 DC 23 Août 1985, Voir : Jacques Ziller, « Sovereignty in France: Getting Rid of the Mal de Bodin », in Sovereignty in Transition. éd. Neil Walker, Oxford, Hart, 2003. [3] Rousseau J-J., Du Contrat Social, Flammarion, Paris, 2001. [4] Kelsen H., «La méthode et la notion fondamentale de la théorie pure du droit »Revue de Métaphysique et de Morale, T. 41, No. 2 (Avril 1934), pp. 183-204. [5] Kelsen H., Théorie générale des normes, (traduction d'Olivier Beaud) PUF, 1996, Paris. [6] A. Hold-Ferneck, H. Kelsen, Lo Stato come Superuomo, un dibattito a Vienna, édité par A. Scalone, Il Mulino, Turin, 2002 [7] Dyzenhaus D, Hard Cases in Wicked Legal Systems. South African Law in the Perspective of Legal Philosophy, Oxford, Clarendon Press, 1991. [8] Dyzenhaus D., The Constitution of Law. Legality In a Time of Emergency, op.cit., p. 22. [9] Troper M., La philosophie du droit, Paris, PUF, 2003, [10] Dupuy R.J., Le Droit International, PUF, Paris, 1963 [11] Goyard-Fabre S., « Y-a-t-il une crise de la souveraineté? », in Revue Internationale de Philosophie, Vol. 45, n°4/1991, pp. 459-498. [12] Jakab A., « La neutralisation de la question de la souveraineté. Stratégies de compromis dans l'argumentation constitutionnelle sur le concept de souveraineté pour l'intégration européenne », op.cit., p. 11. [13] Jakab A., « La neutralisation de la question de la souveraineté. Stratégies de compromis dans l'argumentation constitutionnelle sur le concept de souveraineté pour l'intégration européenne », op.cit., p. 12. [14] S. Goyard-Fabre, « Y-a-t-il une crise de la souveraineté? », op.cit., p. 480-1. Source : Russeurope, Jacques Sapir, 01-07-2016 ======================================= La gauche, le Brexit et la souveraineté Source : Russeurope, Jacques Sapir, 04-07-2016 Le « Brexit » relance question de savoir s'il y aurait une « souveraineté » de gauche et une de droite, et plus généralement montre l'extrême difficulté qu'ont nombre de militants de gauche avec la notion même de souveraineté. Pourtant, une étude réalisée par un politologue en Grande-Bretagne montre que près de 70% des circonscriptions ayant élu un député travailliste ont voté « leave »[1]et ce alors que le parti travailliste faisait quant à lui campagne pour le « remain ». Cela illustre bien la contradiction qui existe entre l'opinion défendue par les cadres d'un parti et le ressenti du militant ou du sympathisant de base. La contradiction est d'autant plus forte que l'on pouvait penser que le meurtre de la député travailliste, Jo Cox, une semaine avant l'élection, allait provoquer un mouvement de sympathie pour le « remain ». Or, si ce sentiment a pu exister, il faut insuffisant pour inverser la tendance des opinions. Ceci nous renvoie aux termes comme « Brexit de gauche » ou de « Lexit », qui est utilisé pour décrire ce que serait une sortie « de gauche » de l'Euro. En réalité, ces différents termes ne font que traduire la confusion qui s'est emparée des esprits dès lors que domine l'esprit sectaire, ou « esprit de parti » sur la question du « bien commun ». 
Origines de la souveraineté De fait, la souveraineté doit être dégagée des débats actuels – débats qui ont bien entendu leur importance mais qui ne situent pas au même niveau. La souveraineté n'est assurément pas un concept de droite car il y a souveraineté dès qu'il y a société. En réalité, la notion de souveraineté renvoie au plus ancien des êtres pensants. L'analyse des primates évolués, nos proches cousins comme les Chimpanzés et les Bonobos montre que la société, avec ses hiérarchies, ses procédures d'inclusions et d'exclusions, de conflit mais aussi de réconciliation, précède l'humanité au lieu d'en découler[2]. L'homme s'est ainsi humanisé de par sa vie en société[3]. Dans toute société, se pose alors la question de savoir qui commande, que ce soit à l'instant donné ou de manière permanente, et au nom de quoi commande-t-il: le pouvoir de celui qui l'exerce est-il seulement lié à la personnalité de celui qui l'exerce ? Cela s'observe dans des microsociétés, qui se défont d'ailleurs lorsque le détenteur du pouvoir disparaît. D'où la nécessité de détacher le pouvoir de celui qui l'exerce. La dépersonnalisation du pouvoir est une nécessité de son plein exercice. Mais, dans le même temps, les hommes ont toujours eu besoin d'identifier le détenteur du pouvoir. D'où cette contradiction qui fait qu'une excessive personnalisation tout comme une dépersonnalisation absolue rendent impossible le plein exercice du pouvoir. Il faut donc réconcilier ces deux pôles ce qui conduit à la solution où le pouvoir d'un (ou d'une) ne devient possible que par la délégation par tous de cette faculté à exercer le pouvoir et dans cette délégation nous avons la légitimité. Mais, le fait que « tous », et que ce tous ne concerne que quelques dizaines ou des millions d'individus implique que ce tous est souverain, détient la souveraineté. Il y a cependant une autre manière de comprendre ce problème : à partir du moment où le pouvoir peut aller jusqu'à la mise à mort d'autrui, jusqu'à exiger le sacrifice d'autrui dans le cas d'un conflit de territoire, qu'est-ce qui donne le droit d'exiger d'un homme qu'il mette à mort un ennemi au péril de sa propre vie ? On comprend qu'il y ait eu dès lors le besoin, à un moment donné, de faire référence à une dimension surnaturelle. Mais une autre lecture est possible et même nécessaire, qui consiste à dire ceci : le pouvoir distinct de celui qui l'exerce, le pouvoir d'exiger des êtres humains des actes qui ne sont pas naturels comme la mise à mort, trouve son fondement dans le bien commun – autrement dit, la survie du groupe. Cela nécessite une construction longue et pénible de cette notion de bien commun. Pendant cette construction, le surnaturel a offert un raccourci pour définir ce bien commun. Il est donc nécessaire à la fois de comprendre les raisons d'être de ce raccourci, de les admettre comme des contraintes matérielles, et de ne pas en être dupe, de ne pas les fétichiser. Souveraineté, société et altérité Deux problèmes se posent. Le premier : est-ce que l'individu peut exister sans liens avec d'autres individus ? C'est cela une des définitions les plus communes de l'état de nature, qui peut cependant être aussi pris comme une métaphore comme nous le verrons tout à l'heure, mais qui n'existe pas réellement. Les premiers grands primates pré-humains fonctionnaient déjà en société parce que l'une des caractéristiques des grands primates – et de l'homme – c'est qu'ils sont facilement adaptables mais qu'ils ne sont supérieurs en rien, sauf l'intellect. Les grands primates et les humains n'auraient donc pas pu survivre s'ils avaient été isolés[4]. On ne peut donc pas penser l'individu puis la société, sur le modèle des briques et du mur, comme le font certains économistes, ou sociologues : l'individu fait d'emblée partie de la société. Il faut donc faire une critique radicale des « Robinsonnades » qui posent toutes un homme isolé. Il est stupéfiant que Böhm-Bawerk, et avec lui l'école marginaliste en économie, ait usé de cette métaphore. Et l'on a tendance à oublier un peu trop souvent que Robinson Crusoë n'est pas une œuvre scientifique mais un « roman d'éducation » écrit par un des grands pamphlétaires religieux anglais, Daniel Defoe. L'idée religieuse est d'ailleurs très présente dans l'ouvrage. Si Robinson est devenu le paradigme de départ de la littérature économique marginaliste comme de certains théoriciens du politique[5], cela pose en vérité un véritable problème de logique. Si Robinson ne retourne pas à l'animalité, c'est qu'il envisage toujours sa position dans la perspective de son intégration à une collectivité, que ce soit son retour possible à la civilisation ou sa position vis-à-vis de la communauté des croyants à laquelle il appartient et qu'il espère rejoindre après son trépas. Robinson, bien avant que Vendredi ne fasse son apparition, n'est jamais seul, et l'importance de sa Bible le montre bien. C'est d'ailleurs, symboliquement, la première chose qu'il sauve du naufrage. On a là un bel exemple d'une aporie religieuse dans les sciences sociales. Or, la souveraineté doit se penser dans les termes des sciences sociales. Se pose alors le second problème : que se passe-t-il quand deux sociétés de pré-humains ou d'humains se rencontrent ? Si nous avons une seule société existant sur un espace donné, cette société n'a pas à se poser le problème de sa souveraineté parce que, d'une certaine manière, ce groupe ne possède rien et possède tout. Mais quand ce groupe rentre en contact avec d'autres groupes, le problème va se poser. Or nous savons que ces contacts apparaissent immédiatement, sans pour autant être permanents. Nous savons aussi que tout groupe procède à des expulsions d'individus comme forme de punition – ce qui veut bien dire l'importance du groupe pour la survie. Et nous avons enfin que dans le contact entre les clans, les tribus, il s'agit de savoir ce qui est aux uns et ce qui est aux autres. Il y a de la souveraineté quand il y a de l'altérité et nous voyons apparaître un principe de communauté et un principe de distinction entre différentes communautés. On peut même dire que la souveraineté découle de l'altérité. De ce point de vue, quand j'entends des collègues qui veulent me faire une critique de la souveraineté en me disant que celle-ci implique l'homogénéité, j'avoue que je suis sidéré par ce contre-sens. Si il y a ce besoin de souveraineté, c'est justement parce que nous devons vivre avec nos différences. Si nous étions une communauté d'individus entièrement homogènes, la souveraineté ne serait pas nécessaire car nous penserions spontanément les mêmes solutions aux problèmes que nous rencontrons. Dès lors, l'action de chaque individu serait la même que l'action collective, et le conflit aurait disparu. La nécessité de trouver une solution, ne serait-ce que provisoire, au conflit n'existerait plus. Il n'y aurait donc plus ni institution ni formes de médiation. Dans cet univers on peut effectivement se défaire du concept de souveraineté. Nécessaires médiations et souveraineté Il faut donc revenir sur la médiation des intérêts divergents au sein d'une société, d'un Etat, d'une nation. Une manière de voir les choses consiste à dire que c'est le marché qui fait cette médiation entre les intérêts. Mais, l'affirmation de la traduction socialement harmonieuse des désirs privés n'est en réalité rien d'autre chez Adam Smith qu'un postulat métaphysique qui n'ose pas dire son nom. Il reprend, en en modifiant le sens, les thèses des jansénistes dont il tire, par un long cheminement des sources que décrypte admirablement Jean-Claude Perrot[6], une métaphysique de l'ordre harmonieux. Ainsi, l'image de Dieu perdure pour hanter certains hommes. L'économie politique classique se révèle comme une construction profondément métaphysique à la fois quant à la nature humaine et quant aux modes d'interaction. Cette image de Dieu prend alors deux formes distinctes dans la pensée économique : elle induit le modèle déterministe et mécaniste de l'École de Lausanne (Walras et Pareto) et sa forme moderne du modèle Arrow-Debreu. Les édits divins nous sont ainsi proclamés lisibles par les succès ou les échecs des acteurs. Cette lisibilité justifie alors l'hypothèse d'information parfaite et complète. On mesure les fondements métaphysiques de la pensée libérale, ou du moins néo-classique, fondement d'autant plus redoutables qu'ils ne se donnent pas comme tels et qu'il prétendent se présenter comme autant de vérités « objectives ». Au contraire, nous devons penser non pas la traduction harmonieuse de ces intérêts mais le conflit, la revendication, la lutte gréviste, qui conduisent à des formes particulières de médiation. Il faut donc reprendre la question de la construction des institutions, et l'on va y retrouver la souveraineté. En effet, l'extension des domaines de souveraineté a été la forme prise par les luttes sociales qui, au fil du temps, ont construit les institutions. Telle est la leçon qu'il faut tirer de l'ouvrage classique de François Guizot sur la « civilisation européenne »[7]. Ses implications n'en n'ont pas été d'ailleurs pas toujours pleinement comprises. Ce que Guizot affirme, c'est non seulement la nécessité de la lutte comme principe d'engendrement des institutions, mais aussi un lien circulaire, ou plus précisément en spirale, où l'on repasse régulièrement au même point mais pas à la même hauteur, entre une institution de souveraineté, la commune bourgeoise par exemple, et le principe de la lutte des classes. En d'autres termes, il n'est de possibilité d'expression de ses intérêts quepar la conquête d'espaces de souveraineté. Mais, celle-ci implique alors l'action collective. C'est pourquoi les différentes formes d'organisations, ligues, associations, syndicats, sont non seulement légitimes mais encore absolument nécessaires au fonctionnement d'une société hétérogène. L'existence d'un intérêt commun n'efface pas ces conflits, mais doit s'enraciner dans la compatibilité de leurs modes de gestion. Cependant, une fois ces espaces acquis, ils ont tendance à influencer largement sur les représentations de ceux qui y vivent. La « gauche » et la souveraineté On constate ainsi que la notion se souveraineté ne se laisse pas enfermer dans les catégories de « gauche » ou de « droite ». Non que ces catégories ne soient nécessaires au débat. Mais elles recouvrent justement des appréciations divergentes sur ce qu'est le « bien commun », appréciations qui ne sont possibles que dans une société, une Nation, un Etat, souverain. Dès lors, on comprend pourquoi l'idée d'une souveraineté « de gauche » ou d'une sortie « de gauche » de l'Euro sont de dangereuses fadaises. Une porte est ouverte ou fermée et, en un sens, peu importe quelle main se pose sur la porte pour l'ouvrir ou la fermer. Par contre, une fois la porte ouverte, la question de la direction que l'on prendra se pose, et c'est là que les différences entre « gauche » et « droite » reprendront tout leur sens. Cela a déjà été dit : s'enfermer au nom d'une pureté imaginaire dans un discours sur un éventuel « Brexit de gauche » ou une « sortie de l'Euro de gauche » n'a de sens que si, en réalité, on se refuse à l'un ou à l'autre. C'est un choix que l'on peut faire, mais il implique alors d'avoir la cohérence d'en accepter les conséquences. C'est ce que j'ai dit en 2013 dans une interview au « Canard Forgeron »[8]. L'incohérence se paye toujours au prix fort. Le dirigeant du Parti travailliste, Jeremy Corbyn, est en train d'en faire l'amère expérience. [1] Chris Hanretty, Most Labour MPs represent a constituency that voted Leave https://medium.com/@chrishanretty/most-labour-mps-represent-a-constituency-that-voted-leave-36f13210f5c6#.c4e2o8bnl [2] Godelier, M., « Quelles cultures pour quels primates, définition faible ou définition forte de la culture ? », in Ducros A., Ducros J. & F. Joulian, La culture est-elle naturelle ? Histoire, épistémologie etapplications récentes du concept de culture, Paris, Errance, 1998, p. 217-222. [3] Picq P., « L'humain à l'aube de l'humanité » in Serres, M. P. Picq, J-D. Vincent, Qu'est-ce que l'Humain, op.cit., p. 64. [4] M. Godelier, Métamorphoses de la Parenté, Paris, Fayard, 2004. [5] Grapard U. et Hewitson G., Robinson Crusoe's Economic Man: A Construction and Deconstruction , Londres, Routledge, 2012. [6] J-C Perrot, « La Main invisible et le Dieu caché » in J-C Galley, ed., Différences, valeurs, hiérachie. Textes offerts à Louis Dumont, Éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, 1984, pp. 157-181. [7] F. Guizot, Histoire de la civilisation en Europe, rééd. du texte de 1828 avec une présentation de P. Rosanvallon, Paris, Hachette, coll. « Pluriel », 1985, p. 182-184. [8] On trouvera la vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=mMD5CZSE6JA Source : Russeurope, Jacques Sapir, 04-07-2016 |