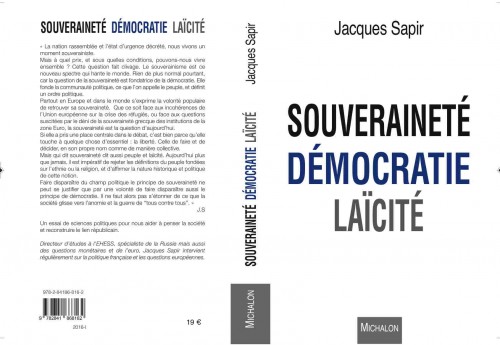Le 8 juin 2016, la Présidente du Brésil Dilma Rousseff s'est entretenue avec les journalistes Leonardo Attuch, Tereza Cruvinel et Paulo Moreira Leite, du site Brasil 24s7.
247 – Quand on arrive à l'Alvorada (Palais de la Présidence à Brasilia NdT), il faut passer par un barrage de police. Sommes-nous en train de rendre visite à une Présidente de la République ou à une personne prisonnière d'une prison de luxe ?
Dilma Rousseff – Je ne me sens pas retenue prisonnière. Je maintiens mes droits d'aller et venir. Mais ce barrage de police est extrêmement gênant et ridicule.
247 – Quel est son but ?
Dilma Rousseff – J'en suis très curieuse. C'est d'une telle stupidité que la réponse en serait qu'ils sont devenus fous. Mais comme ils ne sont pas devenus fous, je présume qu'ils veulent savoir qui vient me visiter. Qui me visite, politiquement. Pourquoi ? Pour savoir sur qui ils doivent faire pression.
247 – Une enquête d'opinion divulguée aujourd'hui par l'Institut CNT/MDA révèle que l'indice d'approbation du président intérimaire Michel Temer est très bas. Devant ce fait, quelle a été votre articulation politique, même en sachant que vous êtes surveillée par cette barrière policière ?
Dilma Rousseff – Mon articulation est basée sur l'exercice d'une chose très simple : le dialogue, le dialogue, le dialogue. Il n'y a aucun autre exercice à faire, à part de persuader qu'un coup d'État est en cours. Il ne s'agit pas seulement d'un coup d'État contre mon mandat. C'est un coup d'État qui pose de sérieux problèmes par rapport à l'institution brésilienne, On ne fait pas un coup d'État contre un président de la République qui représente un contrat et qui a eu 54 millions de votes, sans la tentation de rompre d'autres contrats.
247 – Vous pouvez nous citer des exemples ?
Dilma Rousseff – Licencier le président de l'EBC (Entreprise Brésilienne de Communication. (entre temps, la Cour Suprême a remis le Président à son poste NdT) a été une rupture de contrat. Suspendre des contrats de publicité (envers les blogs et sites progressistes NdT) a aussi été une rupture de contrat. La première tentation de tous les coups d'État, qu'ils soient militaires ou parlementaires, et de faire taire. Faire taire la divergence. Ils essayent même d'interdire l'expression coup d'État. La simple expression coup d'État les incommode. Ce n'est pas pour rien qu'un groupe de parlementaires nous a envoyé une notification afin que nous expliquions la raison pour laquelle nous appelons coup d'État ce coup d'État.
247 – Et vous l'avez fait ? Leur avez-vous envoyé l'éditorial du New York Times qui dénonce le coup d'État au Brésil ?
Dilma Rousseff – Non, je n'ai pas envoyé le New York Times. J'ai été plus classique. J'ai envoyé une phrase de Beaumarchais dans les Noces de Figaro. Elle dit ceci : « Quand on cède à la peur du mal, on ressent déjà le mal de la peur ». C'est la phrase la plus synthétique. Ils veulent faire taire parce qu'ils ont peur. Ils ont peur du contradictoire. Ils ont peur des manifestations politiques. Ils ont été jusqu'à fermer l'accès à l'Alvorada ! J'ai passé ici cinq ans et il n'y a jamais eu de barrage. Tout d'un coup il apparaît et nous ne savons pas pourquoi.
247 – Vous avez parlé de la tentative de faire taire la divergence. Y-a-t-il un risque que ce gouvernement provisoire se transforme en un régime autoritaire ?
Dilma Rousseff – Il y a ce risque, oui. Les gouvernements illégitimes n'aiment pas, par exemple, la culture. Supprimer le Ministère de la Culture, comme ils l'ont fait, c'est atteindre le symbolique, dans un pays qui a besoin d'affirmer sa diversité nationale (le Ministère de la Culture a été rétabli depuis NdT). Nous avons aujourd'hui un président intérimaire qui n'a pas une once de légitimité et qui n'est pas encore sorti dans la rue (après avoir évité plusieurs engagements, Temer est finalement sorti depuis NdT) Le recours à la force peut, oui, être le prochain pas.
247 – Le présidence est intérimaire mais, en théorie, est légitimé par un procès d'impeachment.
Dilma Rousseff – Ce procès d'impeachment traite de six décrets de crédit supplémentaire et du Plano Safra (Plan Récolte), à l'élaboration duquel je n'ai même pas participé. Comme il n'y pas le moindre indice de crime de responsabilité, il s'agit, bien évidemment, d'un coup d'État. Le fait est qu'au Brésil s'est créée une situation absurde, avec cet impeachment fait sur la base d'une loi de 1950, dont des pans immenses ne sont pas régulés. Nous avons un président intérimaire qui a démonté toute une structure de gouvernement. Il démonte des programmes et des politiques publiques, sans aucune légalité, et a du mal, ainsi, à mettre un pied dans la rue. Il n'a aucune légitimité. Vous savez ce qui surprend le plus les correspondants internationaux et les émissaires des gouvernements étrangers qui nous rendent visite ?
247 – Quoi ?
Dilma Rousseff – Le fait que nous soyons en train de vivre une situation unique. Je suis la présidente élue. Je n'ai pas quitté ma charge. Ils sont intérimaires et ils pensent qu'ils peuvent tout démonter. Une chose dont je suis certaine, c'est qu'à mon retour il y aura une modification de cette loi. Sinon, le présidentialisme au Brésil sera une farce. Beaucoup parlent aujourd'hui de parlementarisme. Quelques-uns de semi-parlementarisme. D'autres, de semi-présidentialisme. Mais il est important de dire que le parlementarisme au Brésil signifie l'hégémonie conservatrice.
247 – Cette loi de 1950 a été faite par un politicien gaucho (du sud), Raul Pila, qui était un doctrinaire du parlementarisme. Ensuite cette loi fut réglementée par un autre politicien gaucho, Paulo Brossard, qui était aussi parlementariste. D'une certaine façon, le parlementarisme essaie de s'imposer au présidentialisme, sans que le peuple ne soit consulté ?
Dilma Rousseff – Très bien observé. Vous savez qui était Raul Pila ? Un représentant du Parti Libéral. Paulo Brossard aussi. Cette loi de 1950 exprime une vision parlementaire du pouvoir. Dans le parlementarisme, le président peut être retiré par un vote de méfiance. Le président peut aussi convoquer de nouvelles élections générales et dissoudre le parlement. Dans notre présidentialisme, il devrait y avoir un équilibre. Je dis ceci parce que ce qui est arrivé au Brésil a été une élection indirecte travestie d'impeachment, et donc, putschiste, par une manœuvre où tout le pouvoir retombe sur le gouvernement provisoire, et aucun pouvoir ne reste à celui qui a été légitimement élu. Il y a donc quelque chose qui ne va pas.
247 – Ce parlementarisme imposé de force est-elle la principale expression du coup d'État ?
Dilma Rousseff – Il y a de nombreuses strates au coup d'État. L'une d'entre elles, la plus évidente, est le procès pour impeachment, sans crime de responsabilité, qui a culminé par cette élection indirecte. Ensuite, cette situation de nouveau régime, qui a permis à un gouvernement intérimaire de changer les politiques publiques sans aucune légitimité. Il faudra discuter, dans le futur, des limites de l'intérimaire.
247 – Vous allez rétablir tout ce que le président intérimaire a fait, ou y-a-t-il des choses qui peuvent servir ?
Dilma Rousseff – Nous devrons tout rétablir, sans le moindre doute. Il n'y a aucune hypothèse de laisser voir disparaître le Ministère de la Science et de la Technologie (incorporés au Ministère des Communications NdT) Les autres modifications qu'ils ont faites n'ont que sens que pour leur stratégie, mais elles ne correspondant pas au désir de la population. Par exemple : quand ils retirent le S de la Previdência Social(Assurance Sociale) et mettent le Ministère sous la tutelle du Ministère des Finances, cela exprime une certaine vision du monde. Laquelle ? Retirer des droits aux retraités et aux travailleurs. Quand ils mettent l'Incra (Institut National de Colonisation et de Réforme Agraire) sous la tutelle du Ministère de l'Intérieur (Casa Civil), ils visent à retirer des droits aux travailleurs ruraux ou d'agréer à des intérêts physiologiques. Rien de tout cela ne peut continuer, sans parler de ce qu'ils ont fait avec les femmes, les noirs, les homosexuels, les handicapés et toutes les minorités.
247 – Ce gouvernement provisoire a rendu les minorités invisibles ?
Dilma Rousseff – Une invisibilité totale. Et rendre invisible, dans ce gouvernement d'hommes blancs, est une manière de faire taire. En plus, cette femme qui a assumé le Secrétariat d'État aux Femmes [Fatima Pelaes] a dit une chose très grave.
247 – Vous parlez de quoi en particulier ?
Dilma Rousseff – Elle a dit, puis s'est dédit. Mais ce qu'ils pensent, c'est ce qu'ils disent la première fois. Elle a affirmé que l'avortement doit être interdit même en cas de viol. La loi brésilienne a été perfectionnée et modifiée peu à peu. L'avortement est permis en cas de viol, des grossesse à haut risque et d'anencéphalie. Le fonctionnaire public n'a pas à aimer ou pas. Il doit obéir et c'est tout. Mais elle est seulement un exemple.
247 – Quels seraient les autres ?.
Dilma Rousseff – Ensuite est arrivé le ministre de la santé qui a dit que le SUS (Sistema Unico de Saude – équivalent de la couverture universelle NdT) ne tenait pas dans le budget. L'autre a parlé de faire des coupes dans le Bolsa Familia (Bourse Famille), qui coûte 0,5% du PIB. Ensuite, on a parlé de désindexer le revenu des retraités du salaire minimum. C'est très grave. Cela atteint 70% des retraités, 23 millions de personnes. S'ils font ça, la retraite ne sera plus jamais un salaire minimum. On va revenir où nous en étions au temps de Fernando Henrique Cardoso (président du PSDB de 1995 à 2003 NdT).
247 – Ce gouvernement intérimaire n'aurait-il pas au moins le mérite de révéler au peuple brésilien le vrai visage de la droite brésilienne ?
Dilma Rousseff – Hier, j'ai reçu ici un groupe d'historiens qui étudient l'esclavage. Ils ont dit une chose très vraie. La logique du privilège est encore très forte au Brésil. Elle s'exprime dans ce manque de respect envers les plus pauvres. Ils m'ont parlé d'un club à Rio de Janeiro où les bonnes d'enfants ne peuvent s'asseoir ni aller aux toilettes. Malheureusement, il existe encore ce sentiment au Brésil. Quand le pauvre s'élève, la maison des maîtres (Casa Grande) devient folle.
247 – Le gouvernement intérimaire parle de retirer les étrangers du programme Mais Médicos (Plus de Médecins, auquel participent beaucoup de médecins cubains NdT). Quelles en seraient les conséquences ?
Dilma Rousseff – C'est simple. S'ils enlèvent les médecins étrangers, le Mais Médicos s'arrête. Parce que les étrangers, et spécialement les cubains, sont la grande majorité des professionnels qui participent au programme. Pourquoi avons-nous fait le Mais Médicos ? Parce que notre quantité de médecin per capita est encore très faible. Bien plus bas que dans des pays voisins comme l'Argentine et l'Uruguay. N'en parlons pas quand on compare à un pays comme l'Angleterre. Un des objectifs du gouvernement est d'amplifier les écoles de médecine et pas seulement dans les capitales. Mais former un médecin est très long.
247 – N'est-il pas possible de continuer le programme avec uniquement des médecins brésiliens ?
Dilma Rousseff – Non. Avant le Mais Médicos, nous avions plus de 700 municipalités (qui peuvent être gigantesques NdT) sans aucun médecin. Le médecin formé au Brésil, la plupart du temps, n'allait pas vers les périphéries des grandes villes. D'ailleurs, l'État de São Paulo, le plus riche du Brésil, est celui qui a demandé le plus de professionnels du programme. Nous avions plus de 20 millions d'habitants sans attention médicale. Nous ne sommes pas en train de parler du fin fond de la campagne, mais de São Paulo.
247 – Beaucoup de cabinets médicaux ont été des départements de propagande de l'impeachment, vous le savez ?
Dilma Rousseff – Eh, mais là…. Comme l'offre de médecins est faible, les médecins n'allaient pas vers la périphérie des grandes villes, l'Amazonie, les départements de santé indigène. Nous avons fait des enquêtes. Plus de 90% des personnes bénéficiaires approuvent le programme. Et plus de 60 millions de personnes reçoivent des soins du Mais Médicos. 63 millions de personnes.
247 – Mais ce gouvernement prend beaucoup de décisions de nature idéologique. N'ont-ils pas fait ça pour faire partir les cubains ?
Dilma Rousseff – Je n'y crois pas, spécialement depuis que les États-Unis se sont rapprochés de Cuba. Cette idée perd de sa force, ce n'est plus à la mode. Mais je dois dire une chose. Vive le médecin cubain ! Vive le médecin cubain ! Le médecin cubain rassure le patient, il vous regarde, il vous touche, il regarde ton histoire, il va chez toi si c'est nécessaire. Ils ont une vision de la médecine qui est très importante pour les médecins brésiliens. D'un autre côté, ils font aussi l'éloge du médecin brésilien, qui est très bien préparé et très bien formé. Je crois qu'il y a une complémentarité. Un autre point intéressant est que les médecins cubains font l'éloge de nos infirmières.
247 – Dans une des villes où est passée la torche olympique, un médecin cubain a été choisi pour la porter. Est-ce un signal de reconnaissance ?
Dilma Rousseff – Certainement. Il y a une identification très grande entre le médecin cubain et le peuple brésilien. Il ressemble au peuple brésilien, il a l'allure du brésilien. Il est important de dire que l'accord n'a pas été conclu avec le gouvernement cubain, mais avec l'OPAS, l'Organisation Panaméricaine de Santé. S'ils veulent retirer les cubains du programme, ils vont avoir un gros problème avec l'OPAS, avec l'OMS, avec l'OCDE. Ce sera une autre rupture unilatéral de contrat. Un contrat international. Le port de Mariel (à Cuba NdT), que j'ai dû beaucoup expliquer pendant ma campagne électorale, est une autre raison d'oublier ce préjugé idéologique.
247 – Pourquoi ?
Dilma Rousseff – Aujourd'hui, il y a 30 entrepreneurs américains qui s'y installent. Parce que c'est le port le plus important des Caraïbes, et qui sera administré par les hollandais, qui ont une grande expérience dans ce domaine.
247 – En parlant d'économie, le gouvernement intérimaire rejette sur vous la responsabilité d'un déficit de 170 milliards de reals.
Dilma Rousseff – Ils sont absolument responsables de cela. Je ne suis pas en train de créer 14.000 postes de fonctionnaires (que la Chambre a approuvé et que le Sénat doit voter NdT). J'étais contre cette proposition bombastique. J'ai apposé mon véto aux augmentations. Nous avons envoyé au Congrès un déficit de 96 milliards de reals, parce qu'il y a une chute constante des recettes fiscales. Ils ont augmenté le déficit à 170 milliards pour avoir de la marge pour les dépenses, et pour créer les conditions de l'impeachment.
247 – Veulent-ils acheter les consciences pour approuver l'impeachment au cours du second vote au Sénat ?
Dilma Rousseff – Cela me paraît clair. Ils veulent contrôler leur base, et garantir les votes, par le moyens des dépenses publiques. Pour cela, ils ont augmenté le déficit. Un autre motif est qu'ils souhaitent échapper au contrôle du TCU (Tribunal des Comptes de l'Union). Parce que la situation que le TCU a créé au cours de ce procès d'impeachment rend in-viable toute politique fiscale. Le Brésil vit aujourd'hui une crise qui réduit les recettes fiscales. Selon la logique du TCU, il y aurait un risque de « shutdown » (arrêt des activités gouvernementales fédérales, comme c'est arrivé aux États-Unis NdT), à chaque fois que les dépenses atteindraient le plafond, paralysant toutes les activités de l'État. Ils nous mettent le couteau sous la gorge.
247 – Quel est le poids de la crise politique dans cette chute des recettes fiscales ?
Dilma Rousseff – Joseph Stiglitz (prix Nobel d'Économie) et venu ici et a dit une chose intéressante. La crise économique, avec la chute des commodities et la récession internationale, était inexorable. Mais il a dit aussi : ce que vous ne pouvez expliquer est la crise politique.
247 – Voyez-vous un signe de reprise économique ?
Dilma Rousseff – Il y a beaucoup de choses qui se passent que nous avions déjà préparées. Par exemple, la chute de l'inflation. Il y a eu une dévalorisation du change, un changement de prix relatifs et l'impact inflationniste a déjà été contenu. Ils disent que maintenant il va y avoir un superavit externe. Nous sommes sortis d'un déficit de 4 milliards de dollars, nous sommes passés par un superavit externe de 20 milliards de dollars l'année passée, et cette année le superavit sera entre 40 et 50 milliards de dollars. Ce qui est très bien, dans un moment où le monde entier marche à petite vitesse. Maintenant, dans des moments d'expansion, quand tout va bien, il n'y a pas de conflit de distribution. Ces conflits surgissent dans les moments de récession.
247 – Comme évaluez-vous la question fiscale et la nécessité d'augmenter les impôts ?
Dilma Rousseff – Quand l'économie se développe, il n'y a pas de conflit de distribution. Tout le monde y gagne. Le conflit distributif surgit dans les périodes de récession, comme aujourd'hui. Ici, au Brésil, il y a une chose symptomatique. Ils disent que l'on ne peut pas augmenter les impôts. Pourquoi ne peut-on pas payer d'impôts ?
247 – Et la question de payer pour les autres ?
Dilma Rousseff – Ici, c'est le pauvre, le retraité qui doit payer pour les autres. En tout cas selon la vision de ce gouvernement intérimaire. Je vous demande le suivant : pourquoi ne mettent-ils pas la CPMF ? (taxe sur les transactions financières NdT) La CPMF atteint proportionnellement celui qui fait des transactions financières. Elle n'atteint pas les comptes des salariés. Elles n'atteint pas les comptes de retraite. Ceux-ci en sont exempts. En plus, la CPMF permet le contrôle des transactions financières et empêche ainsi un niveau de fraude. Ils ne permettent pas non plus les intérêts sur le capital propre, ni les impôts sur les profits et dividendes. C'est une autre des particularités brésiliennes. Des pays qui pourraient entrer à l'OCDE, nous sommes le seul qui n'impose ni les profits, ni les dividendes.
247 – Le Brésil est un pays d'entreprises pauvres et d'entrepreneurs riches ?
Dilma Rousseff – Exactement. À l'étranger, l'entreprise est riche et le patron entre dans un patron normal de richesse. Comme on le dit au Minas (État du Minas Gerais, d'où Dilma Roussef est originaire NdT), quand quelqu'un passe de canard à oie, si c'était à l'étranger, ça ne changerait pas beaucoup. Ça pourrait même être difficile.
247 – Et la politique extérieure ? Le président intérimaire n'a reçu aucun coup de téléphone et le chancelier n'a été reçu pratiquement par personne. Le Brésil sera-t-il un paria international ?
Dilma Rousseff – Il arrivera probablement avec le Brésil ce qui est arrivé avec le Paraguay. La relation sera froide et distante. Le jour où sera faite une élection nationale, les choses changeront. Je ne suis pas en train de parler de président « élu » par un impeachment ou par une élection indirecte. Il doit être élu par le peuple. Au Paraguay, même après les élections, la relation est restée froide pendant un moment. Tant qu'il n'y aura pas de gouvernement légitime, le monde gardera ses distances avec le Brésil. C'est comme ça que cela fonctionne.
247 – Cela signifie-t-il que vous défendez déjà de nouvelles élections ?
Dilma Rousseff – J'ai toujours été en faveur des élections. Sinon, on aurait dit que j'étais en faveur de la dictature et non des élections. La solution démocratique passe par mon retour. Mais dans un second temps, nous allons devoir discuter : que s'est-il rompu au Brésil ? Nous avons rompu le pacte politique qui a soutenu le Brésil depuis la Constitution de 1988. Les forces politiques qui se sont unis à ce moment se sont rompues. Ce 17 avril (jour du vote à la chambre des députés NdT) a été un moment de rupture. Qu'est-ce que cela signifie ? Ce sera très difficile de refaire un pacte après cela. Il faut un nouveau pacte, par des élections directes, par le vote.
247 – Le dialogue n'est pas possible ?
Dilma Rousseff – C'est très difficile de s'asseoir à une table et de dialoguer de la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Vous croyez que le président intérimaire et ses alliés qui ont usurpé le pouvoir partiront par eux-mêmes ? Le fait est que leur sortie passe par mon retour. Après, c'est une autre histoire.
247 – Avant de nouvelles élections, ne doit-il pas y avoir une autre discussion sur un nouveau modèle de gouvernance ? Parce que telle qu'elle est, avec le présidentialisme de coalition ou, comme le pense beaucoup, cette extorsion de l'Exécutif par le Législatif, ça ne marche pas.
Dilma Rousseff – Je vais vous raconter une question qu'ils m'ont posée : est-ce que ça n'aurait pas été mieux d'appuyer Eduardo Cunha (ex-président de la Chambre des Députés, principal artisan de l'impeachment NdT) ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe ceci : comment était le pacte auparavant ? Fernando Henrique (Cardoso), avec son alliance, ou bien nous-même, avec notre alliance avec le centre politique, nous parvenions à garantir une stabilité au pays. Mais récemment a surgi à l'intérieur du PMDB (principale base alliée du PT au pouvoir NdT) une force avec des convictions propres, ultralibérales en économie, conservatrice dans ses coutumes et avec un plan propre. Quel est ce plan du gouvernement Temer ?
247 – Vous parliez de Cunha ou de Temer ? Les deux sont-ils la même chose ?
Dilma Rousseff – Dans les enregistrements de Romero Jucá, outre le fait qu'il fallait, selon lui, arrêter l'hémorragie (selon cette conversation, enlever Dilma Rousseff du pouvoir pouvait freiner l'Opération Lava Jato, qui se rapprochait du PMDB NdT), il dit aussi une chose importante : « Temer est Cunha ». Jucá le dit et le répète. Eduardo Cunha contrôle 55% des votes de la Chambre. Et ses plans sont exprimés dans le conservatisme de tout le gouvernement Temer. Et il n'y a pas de négociation. La majorité du gouvernement Temer est de Cunha. Le fait d'être président provisoire donne quelques pouvoirs à Temer. Mais les lignes générales appartiennent à Cunha. Dans mon cas, un accord avec lui aurait été de me rendre. Il n'y a que ceux qui ont jeté aux orties leur convictions qui font des accords avec Cunha. Regarde le cas des États-Unis. Obama n'a la majorité ni à la Chambre no au Sénat. Et affronte la bande vraiment dure du Tea Party. Mais personne ne lui demande d'abandonner ses convictions et son ordre du jour.
247 – Quelle est votre position sur le parlementarisme ?
Dilma Rousseff – Au Brésil, la politique la plus progressiste s'est faite dans les relations avec le gouvernement fédéral. Après la Republica Velha, avec l'arrivée de notre cher Getúlio Vargas, toutes les modifications progressistes, jusqu'à la structuration de l'État national, se sont faites par des politiques de régimes de présidentialisme. Mais, d'un autre côté, quand on regarde la question du parlement, sans nommer quiconque, les filtres économiques, oligarchiques ou liés à des intérêts construisent un profil plus conservateur que celui des forces qui arrivent à la présidence.
247 – Il suffit de dire que Fernando Henrique Cardoso a été président avec l'appui de 20% du parlement. Lula 18%. Et vous 16%. Vous avez tous dépendu de ce centre.
Dilma Rousseff – Je dirais que la grande régression qui peut sortir de ce procès d'impeachment, si ils poursuivent et que je ne reviens pas, est un renforcement de la tendance au parlementarisme. Quand je dis qu'il est fondamental pour la démocratie que je revienne, l'un des motifs est que je me refuse à approuver le parlementarisme ou le semi-parlementarisme.
247 – D'accord, mais comment un président va former une majorité après qu'un phénomène comme l'Opération Lava Jato ait implosé les relations entre le législatif et l'exécutif ? Parce que maintenir le présidentialisme et le rendre sujet aux extorsions parlementaires n'a pas beaucoup de sens.
Dilma Rousseff – Qui sait si nous n'aurons pas un meilleur Congrès après une réforme politique ? Je le dis et je le répète. Nous ne sortirons pas de cette crise si nous ne faisons pas de réforme politique.
247 – Vous parlez de revenir. Mais quelle force auriez-vous pour gouverner ?
Dilma Rousseff – La force du retour. Je suis en train de tenter de gagner des votes (au Sénat pour le prochain vote de l'impeachment NdT) avec le dialogue et la persuasion sur la nature du coup d'État. Mais chaque chose en son temps.
247 – Considérez-vous avoir bien fait de convier l'ex-président Lula à devenir ministre de la Casa Civil (sorte de premier ministre, qui fait le lien avec les institutions, et particulièrement avec le Congrès NdT) un jour après les manifestations du 13 mars ?
Dilma Rousseff – C'est une décision que je ne regrette absolument pas. L'erreur a été qu'ils ne le laissent pas assumer ce poste dans notre gouvernement. Aujourd'hui, il y a plusieurs ministres mis en examen dans ce gouvernement intérimaire et personne ne dit rien. Penser que cette invitation à Lula a contribué à mon écartement de la présidence est une erreur. Ainsi que de croire que ce coup d'État a été tramé par les États-Unis, comme on me le demande souvent.
247 – Il n'y a vraiment pas la main des États-Unis dans l'impeachment ?
Dilma Rousseff – La main des États-Unis n'est pas nécessaire. La société brésilienne a été capable de commettre cette folie, qui a été ce coup d'État. Maintenant, il est vrai que ce coup d'État affecte notre souveraineté. Que les États-Unis s'en réjouissent ou non, c'est une autre histoire.
247 – Parlons du pré-sal. Dans son discours d'arrivée à la présidence de la Petrobras, le nouveau président, Pedro Parente, a déclaré que l'entreprise est à présent favorable à l'ouverture du pré-sal. Comment voyez-vous ce nouveau positionnement ?
Dilma Rousseff – Il parle pour les intérêts qu'il représente. Les intérêts qu'ils représente ne sont pas les intérêts nationaux. Celui qui dit que la Petrobras n'a pas d'intérêt dans le pré-sal ment, ou bien est en train de donner une richesse pétrolifère gigantesque. Ils disaient auparavant que nous serions incapables d'extraire le pétrole et nous en sommes déjà à un million de barils en moins de huit ans. Maintenant, dire ceci dès le premier jour est une irresponsabilité et un manque des respect pour la Petrobras. Ce n'est pas correct.
247 – C'est un crime de lèse-patrie ?
Dilma Rousseff – C'est plus que lèse-patrie. Ça entre déjà dans la catégorie de la stupidité nationale. Nous savons où est le pétrole. Nous savons comment l'extraire et nous savons quelle est sa qualité. Quel est le sens d'abandonner cette richesse ?
247 – Mais ils ne sont pas idiots.
Dilma Rousseff – Je n'ai pas parlé d'idiotie individuelle, mais en idiotie nationale. Celui qui défend des intérêts qui ne sont pas des intérêts nationaux peut être très intelligent.
247 – Ils vont tenter de changer la loi du pré-sal au mois de juillet. Ils vont réussir ?
Dilma Rousseff – Ce sera extrêmement dangereux pour eux de le tenter. Il existe deux modèles : celui de concession et celui de partage. La concession se justifie quand il existe un risque de ne pas trouver de pétrole. Dans ce cas, il est juste que celui qui assume le risque reste avec la part du lion. Le partage est justifié dans le cas du pré-sal parce que nous savons où est le pétrole. Il n'y a pas de risque. Ceci ne signifie pas que nous ne voulons pas faire de partenariat. Dans le champ de Libra, par exemple, la Petrobras est partenaire de la Shell, de Total et de deux entreprises chinoises, la CNOOC et la CNPC. Nous pouvons faire des partenariats, mais non abandonner le pré-sal à d'autres. Nous irions le donner entièrement à une entreprise contre quoi ? Ah, ils vont dire que la Pétrobras est endettée. C'est du grand n'importe quoi. Un projet de pré-sal est extrêmement attirant pour le financement de n'importe quelle banque nationale ou internationale. Et la Petrobras doit avoir la préférence.
247 – Mais Parente va dire que cela importe peu.
Dilma Rousseff – C'est là qu'est le danger. C'est pour cela que la limite minimum de 30% de participation de la Petrobras doit être maintenue.
247 – Parlons des Jeux Olympiques. Il y a quelques jours, le maire de Rio, Eduardo Paes, a affirmé qu'il se sent frustré parce que nous ne saurons pas qui sera le président à la Cérémonie d'ouverture. Avec cette confusion politique, le Brésil peut-il laisser de côté ce grand événement ?
Dilma Rousseff – Je vais vous dire une chose. Ce Rio 2016 est surtout le fruit de la détermination de Lula, qui a été voir chacun des membres du Comité Olympique, ainsi que de la politique étrangère extrêmement accommodante et généreuse du Brésil ces dernières années. C'est pourquoi, si il y a une personne qui mérite de recevoir un hommage à cette cérémonie d'ouverture, c'est bien Lula. En outre, en tant que ministre puis comme présidente, j'ai assumé et respecté littéralement tous les engagements avec la construction de la meilleure infrastructure possible à Rio de Janeiro. Cela comprend le Parc Olympique à Deodoro, et une amélioration significative de tout Rio, avec des travaux comme celui du VLT (tramway). En plus, nous avons acqui beaucoup de savoir-faire en matière de sécurité. Nous avons fait la Coupe Pan-America, les Jeux Militaires, la Coupe du Monde et maintenant c'est le tour des Rio 2016.
247 – Vous irez à la cérémonie d'ouverture ?
Dilma Rousseff – Bien sûr, je serai là. Et ce sera la plus belle cérémonie d'ouverture de tous les temps. Le COI a engagé Abel, l'un des meilleurs artistes de ce pays pour les grands événements.
247 – On peut voir que vous êtes émue quand vous parlez des Jeux Olympiques.
Dilma Rousseff – Bien sûr. C'est mon travail. J'ai mis ma vie dans ce travail. Quand vous posez votre travail, cela fait mal. Je n'ai peut-être pas encore été jugée. Mais qui devraient être là, c'est nous, moi la présidente, et Lula, le président qui a obtenu les Jeux. L'usurpateur peut faire ce qu'il veut pour être à la cérémonie, mais dans ces Jeux Olympiques, il sera toujours un usurpateur. Son gouvernement, uniquement d'hommes blancs et riches, ne représente pas le Brésil. Malgré eux, nous serons fiers de ces Olympiades.
Traduction Si le Brésil m'était traduit…