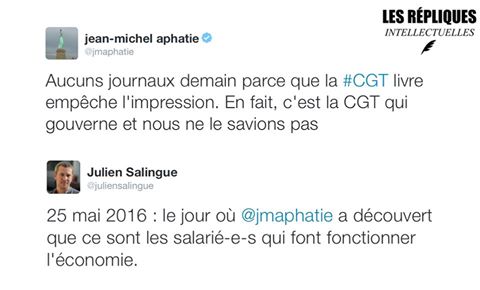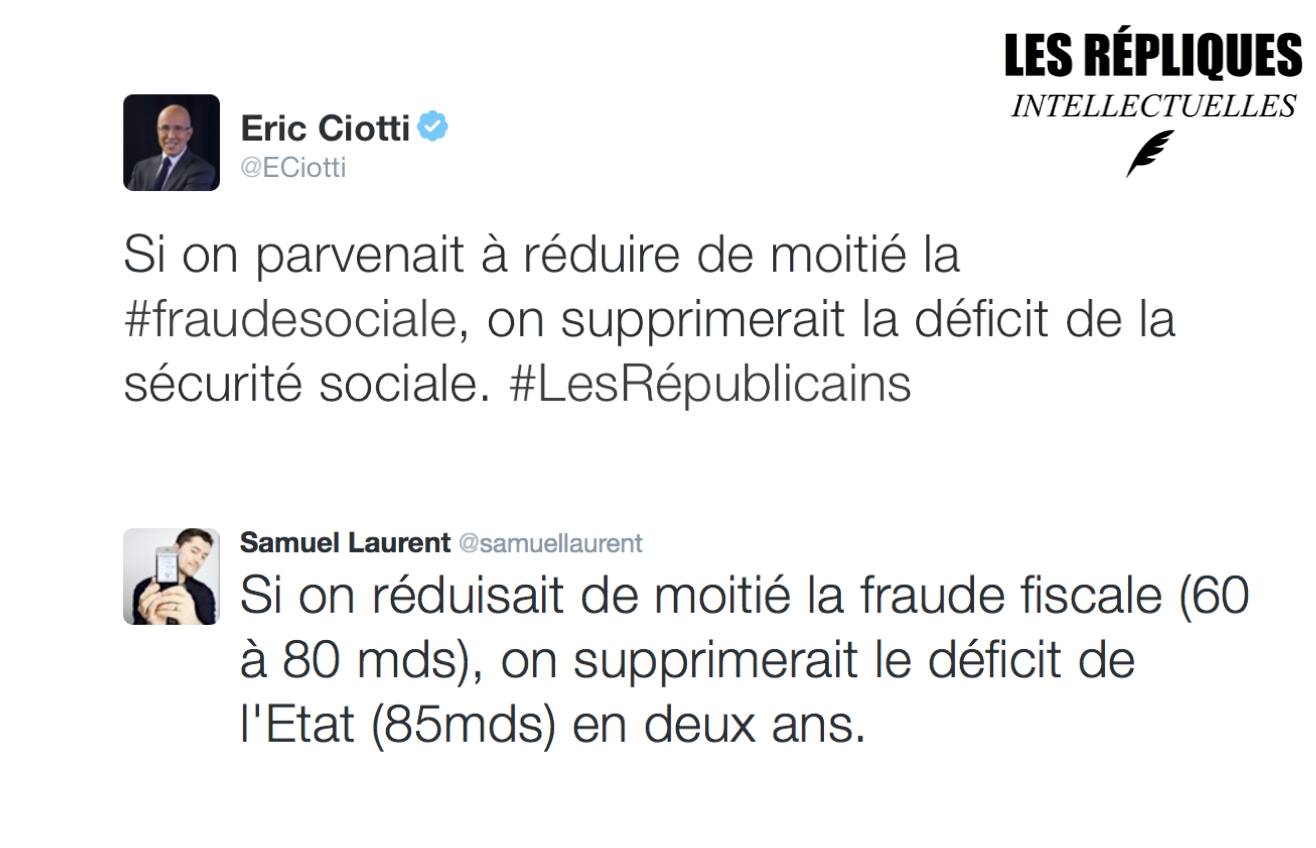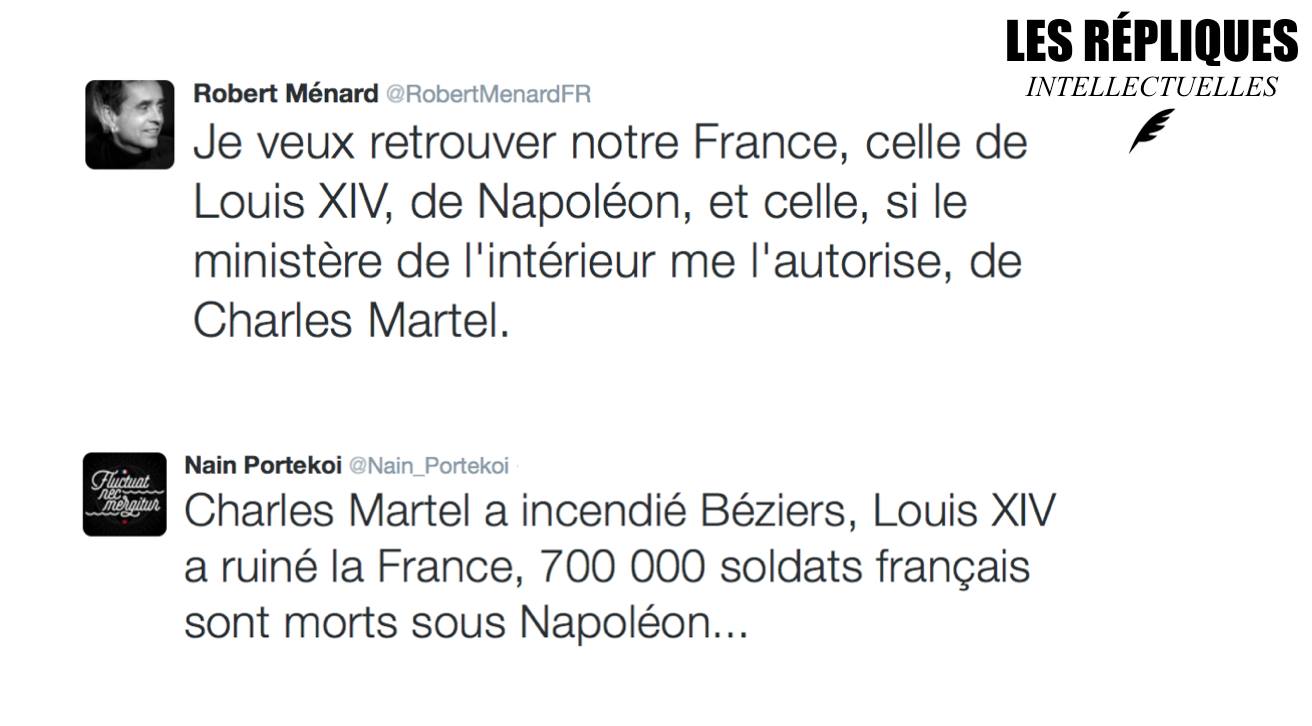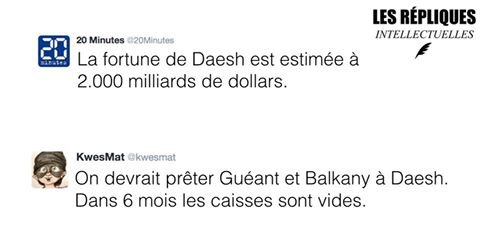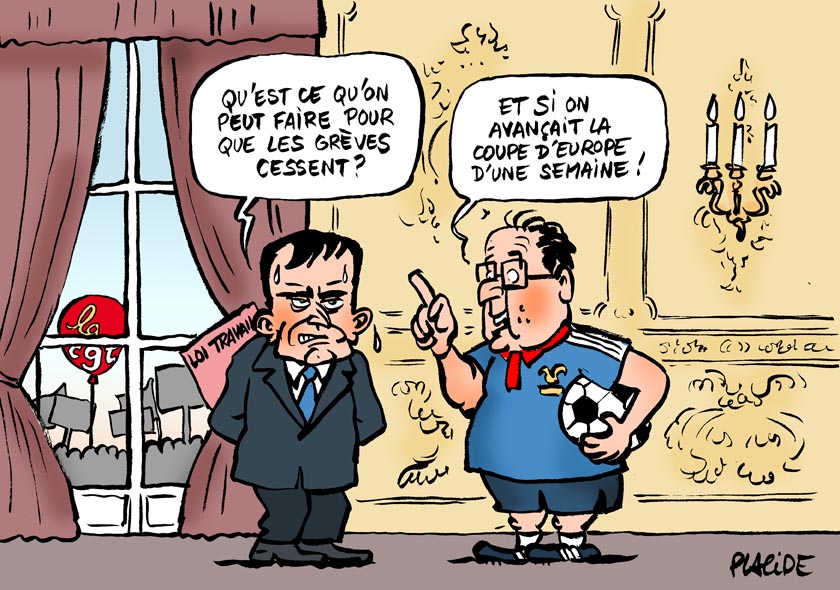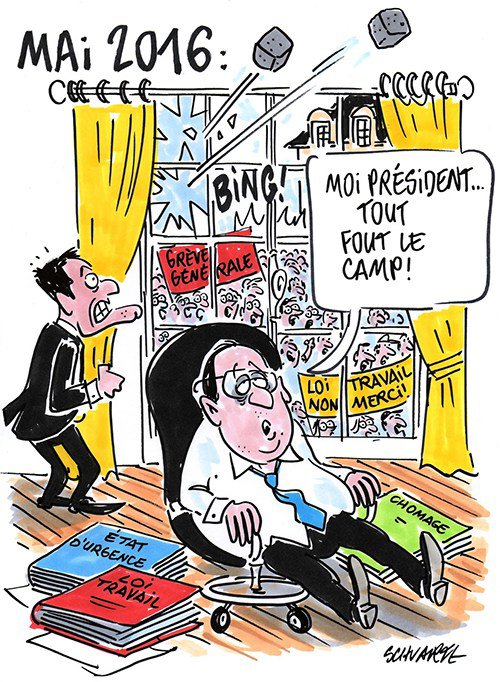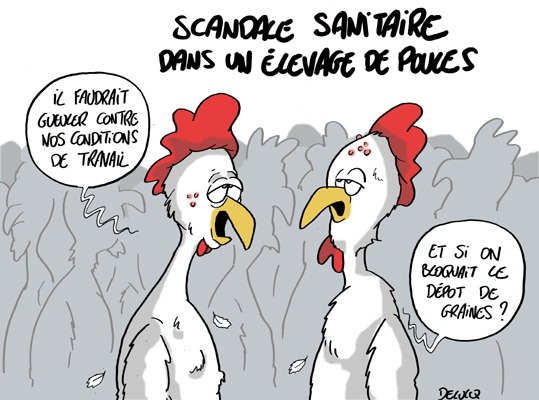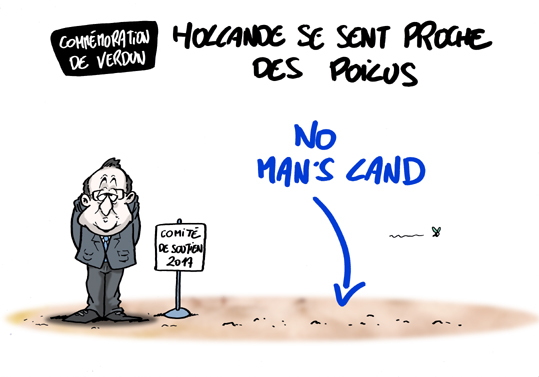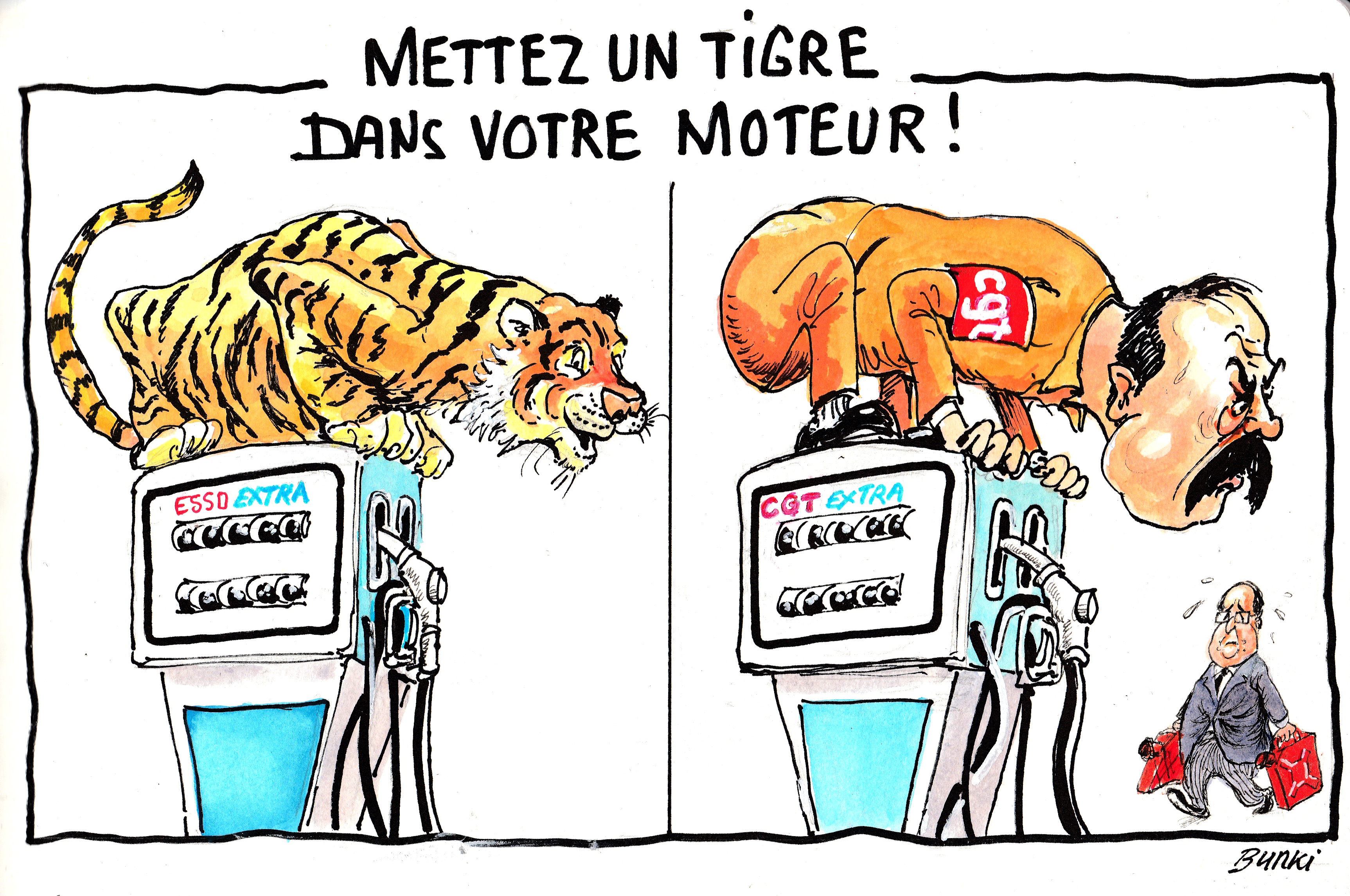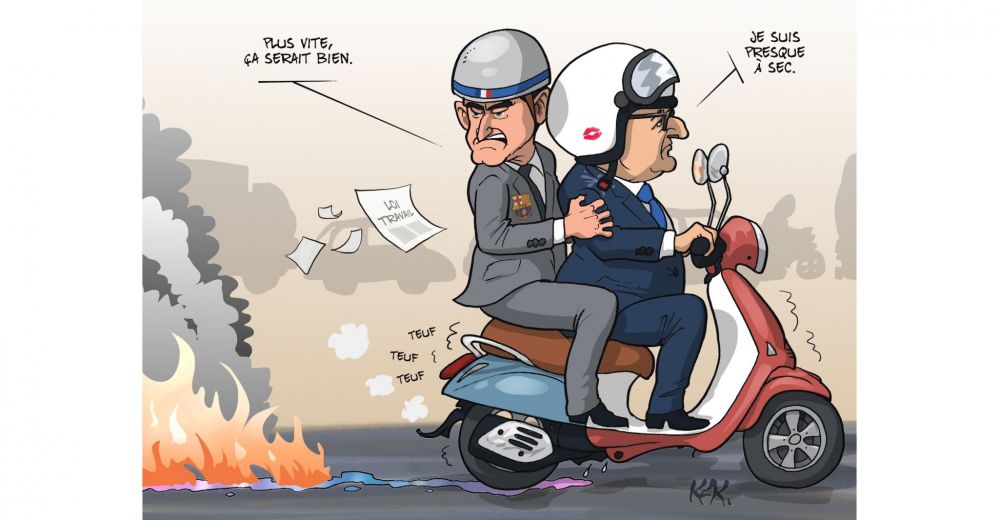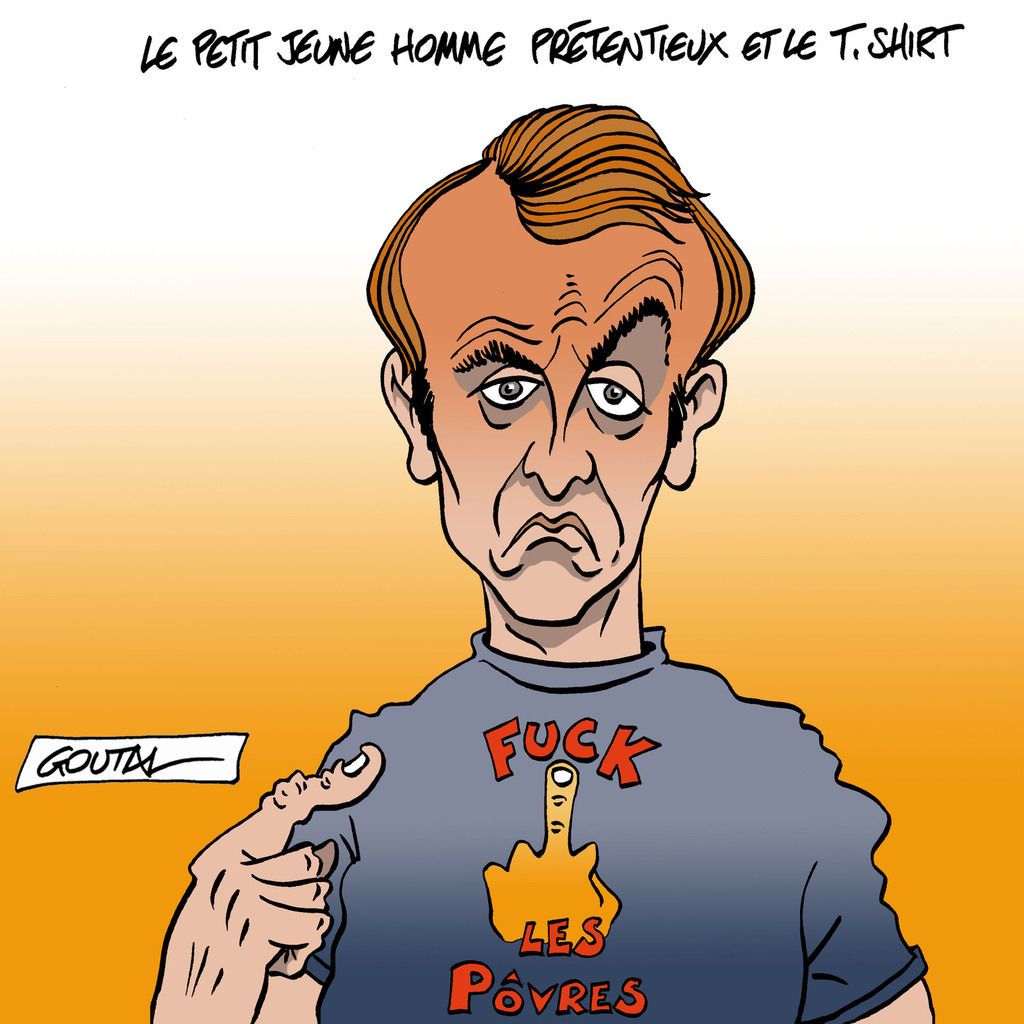| Source : The Atlantic, le 19/10/2015 George W. Bush n’a pas fait tout ce qu’il pouvait pour empêcher l’attaque – et il est temps que les Républicains affrontent ce fait.  Donald Trump dévoile une proposition de reconstruction des tours jumelles en 2005 PETER BEINART | le 19 octobre 2015 Donald Trump énonce beaucoup de mensonges choquants : les Mexicains sans papiers sont des « violeurs », les réfugiés syriens se livrent à « des agressions de toutes sortes » et sont « le cheval de Troie » de l’EI. Il dit aussi cependant des vérités choquantes : « Si vous donnez [de l’argent aux politiciens], ils feront tout ce que vous voulez qu’ils fassent. » Et « le Moyen-Orient serait un endroit plus sûr » si Saddam Hussein et Mouammar Khadafi étaient toujours au pouvoir. La dernière vérité choquante en date, il l’a proférée lors d’une interview vendredi dernier sur Bloomberg TV, quand il a dit que George W. Bush mérite d’être tenu responsable de l’effondrement des tours du World Trade Center pendant son mandat. Les hommes politiques et les journalistes se sont étranglés d’indignation. Jeb Bush a qualifié les propos de Trump de « pitoyables » et Ben Carson les a jugés « ridicules ». L’ancien attaché de presse de Bush, Ari Fleischer, a traité Trump de « conspirationniste » du 11-Septembre. Même Stephanie Ruhle, la présentatrice de Bloomberg qui avait posé la question, s’est écriée : « Enfin, vous ne pouvez pas reprocher ça à George Bush. » Mais si, on peut. Il n’est pas possible de savoir avec certitude si Bush aurait pu empêcher les attentats du 11-Septembre. Mais ce n’est pas la bonne question, qui devrait être : « Est-ce que Bush a fait tout ce qu’il pouvait raisonnablement faire pour les empêcher, vu ce qu’il savait à l’époque ? » Et il ne l’a pas fait. Loin s’en faut. Quand l’administration Bush est entrée en fonctions, en janvier 2001, George Tenet, le directeur de la CIA, et Richard Clarke, le “manitou” de la branche antiterrorisme du Conseil national de sécurité, ont tous les deux averti les nouveaux responsables de la grave menace représentée par al-Qaïda. Lors d’une réunion d’information de transition, à Blair House, plus tôt dans le mois, selon le Bush en Guerre de Bob Woodward, Tenet et son adjoint, James Pavitt, ont indiqué qu’Oussama ben Laden constituait l’un des trois dangers les plus sérieux pour la sécurité nationale. Ce même mois, Clarke a présenté à Condoleezza Rice, conseillère à la sécurité nationale, un plan auquel il travaillait depuis l’attentat d’al-Qaïda contre le destroyer USS Cole en octobre 2000. Il y demandait le gel des avoirs du réseau, la fermeture des associations caritatives qui lui étaient rattachées, l’envoi de fonds aux gouvernements d’Ouzbékistan, des Philippines et du Yémen pour qu’ils luttent contre les cellules d’al-Qaïda dans leur pays, le début de frappes aériennes et d’opérations secrètes contre les sites d’al-Qaïda en Afghanistan, et un accroissement considérable de l’aide à l’Alliance du Nord, qui luttait contre al-Qaïda et les talibans. Mais Clarke et Tenet ont été profondément frustrés par la façon dont les hauts fonctionnaires de Bush ont répondu. Clarke raconte que quand il a informé Rice à propos d’al-Qaïda, “l’expression de son visage m’a donné l’impression qu’elle n’avait jamais entendu le terme avant.” Le 25 Janvier, Clarke a envoyé une note à Rice déclarant que, « nous avons besoin de toute urgence … d’un examen au niveau du Cabinet sur le [sic] réseau al-Qaïda. » Au lieu de cela, Clarke a obtenu une réunion d’un sous-cabinet, au niveau des Délégués, en Avril, deux mois après celui sur l’Irak. Quand cette réunion d’avril eut enfin lieu, selon le livre de Clarke, Contre tous les ennemis, Paul Wolfowitz, le secrétaire d’État à la Défense, manifesta son opposition : « Je ne comprends pas pourquoi on commence par parler de ce seul homme, ben Laden. » Clarke répondit : « On parle d’un réseau d’organisations terroristes appelé al-Qaïda, qui se trouve avoir pour chef ben Laden, et on parle de ce réseau parce que lui et lui seul représente une menace immédiate et sérieuse pour les États-Unis. » Ce à quoi Wolfowitz rétorqua : « Mais il y en a d’autres aussi, au moins aussi dangereux, comme les terroristes irakiens, par exemple. » Au début de l’été, Clarke était si découragé qu’il demanda une réaffectation. « Cette administration, témoigna-t-il plus tard, ne croyait pas qu’il y avait un problème urgent ou n’était pas préparée à agir comme s’il y avait un problème urgent. Et j’ai pensé, si l’administration ne croit pas son coordinateur pour le terrorisme quand il dit qu’il y a un problème urgent, et n’est pas préparée à agir comme on le fait devant un problème urgent, eh bien je dois probablement trouver un autre boulot. » En juillet, le Comité interministériel a fini par donner son accord à la programmation d’une réunion au niveau supérieur à propos du plan de Clarke. Le calendrier, toutefois, était déjà plein et, en août, beaucoup de membres du cabinet étaient en vacances, la réunion fut donc fixée au mois de septembre. Pendant cette même période, la CIA donnait l’alerte elle aussi. Selon Kurt Eichenwald, un ancien journaliste du New York Times qui a pu lire les notes d’information quotidiennes préparées par les agences de renseignement pour le président Bush au printemps et à l’été 2001, la CIA informa la Maison-Blanche dès le premier mai qu’« un groupe actuellement aux États-Unis » projetait un attentat terroriste. La note quotidienne du 22 juin avertissait que l’attentat d’al-Qaïda pouvait avoir lieu « d’un jour à l’autre ». Cependant les mêmes responsables du département de la Défense qui avaient fait peu de cas des avertissements de Clarke ignorèrent ceux de la CIA. Selon les sources d’Eichenwald, « les dirigeants néoconservateurs qui venaient de prendre le pouvoir au Pentagone prévenaient la Maison-Blanche que la CIA avait été trompée. Selon cette théorie, ben Laden faisait simplement semblant de planifier un attentat pour détourner l’attention de l’administration de Saddam Hussein, que les néoconservateurs considéraient comme une menace plus grave. » La CIA riposta : « Les États-Unis ne sont pas la cible d’une campagne de désinformation menée par Oussama ben Laden, » lit-on dans la note quotidienne du 29 juin, où il est dit que le dirigeant d’al-Qaïda avait déclaré récemment à un journaliste du Moyen-Orient qu’il fallait s’attendre à un attentat. Le jour suivant, la CIA inclut dans sa note un article intitulé « Les menaces de ben Laden sont réelles. » Le 1er juillet, on prévoyait dans la note qu’un attentat « allait avoir lieu sous peu. » Puis, le 10 juillet, Tenet et Cofer Black, le chef de la branche antiterroriste de la CIA, rencontrèrent d’urgence Condoleezza Rice pour demander qu’on agisse contre ben Laden. Mais, selon Mensonges d’État : Comment Bush a perdu la guerre [State of Denial], de Woodward, « ils avaient, tous les deux, l’impression que Rice ne les entendait pas. » Elle « avait l’air d’être polarisée sur d’autres priorités de l’administration, surtout sur le système de défense antimissile balistique auquel Bush était attaché » et « Tenet quitta la réunion, se sentant condamné à l’impuissance. » À ce moment, les membres du personnel du quartier général de la branche antiterroriste de la CIA étaient tellement déprimés qu’ils se demandaient s’ils n’allaient pas demander leur transfert. Les avertissements continuèrent. Le 11 juillet, la CIA prévint la Maison-Blanche qu’un tchétchène lié à al-Qaïda avait averti que quelque chose d’énorme allait se passer. Le 24 juillet, la note quotidienne disait que l’attentat d’al-Qaïda attendu avait été reporté, mais pas annulé. Enfin, le 6 août, la CIA intitula sa note « Ben Laden est décidé à frapper les E-U. » La note ne mentionnait ni une date ni une cible spécifique, mais on y faisait état de la possibilité d’un attentat à New York et de détournements d’avion par des terroristes. Dans Angler, Barton Gellman remarque que c’était la trente-sixième fois que la CIA avait évoqué al-Qaïda avec le président Bush depuis l’entrée en fonctions de ce dernier. Le 4 septembre, le Cabinet se réunit et, malgré l’insistance du secrétaire d’État à la Défense pour qui l’Irak représentait la plus grande menace terroriste, il approuva le plan de Clarke de lutte contre al-Qaïda. Le 9 septembre, le Comité des services armés du sénat conseilla d’enlever 600 millions de dollars au budget proposé pour la défense antimissile et de les allouer à l’antiterrorisme. Selon Gellman, Rumsfeld conseilla à Bush d’opposer son veto à cette décision. Le matin du 11 septembre 2001, le plan anti-al-Qaïda de Clarke se trouvait sur le bureau de Bush, en attente de signature. C’était la neuvième directive présidentielle à propos de la sécurité nationale au cours de sa présidence. L’administration Bush aurait-elle pu empêcher les attentats du 11-Septembre, si elle avait pris les menaces plus au sérieux ? C’est possible. Le 3 août, un saoudien du nom de Mohamed al-Kahtani, essaya d’entrer aux États-Unis à Orlando, en Floride, pour, présume-t-on, participer au complot du 11-Septembre. Il fut renvoyé dans son pays par un agent des douanes qui craignait qu’il ne devienne un immigrant clandestin. Le 16 août, des agents du FBI et du INS (Service de l’immigration et de la naturalisation) arrêtèrent, dans le Minnesota, un autre pirate potentiel, Zacarias Moussaoui, après avoir été alertés par son instructeur de vol. Cependant, en dépit de nombreuses demandes, ils n’obtinrent pas la permission de fouiller son appartement ni d’examiner son ordinateur portable. Ces incidents « auraient pu révéler au grand jour le complot du 11-Septembre, écrit Eichenwald, si toutefois le gouvernement avait été en état d’alerte élevée. » Clarke a la même thèse. Quand l’administration Clinton fut avertie d’une attaque éventuelle en décembre 1999, remarque-t-il, le président ordonna à son conseiller à propos de la sécurité nationale de « tenir des réunions quotidiennes avec le ministre de la Justice, la CIA et le FBI. » En conséquence, les dirigeants de ces agences donnèrent l’ordre à leurs branches locales d’enquêter à fond sur tout ce qu’elles pouvaient trouver. C’était devenu la priorité numéro un de ces agences. » Cette vigilance, suggère Clarke, contribua à l’arrestation le 14 décembre d’un algérien nommé Ahmed Ressam, qui arrivait du Canada avec l’intention de faire exploser une bombe à l’aéroport international de Los Angeles. L’administration Bush aurait pu agir de la même façon en 2001. « Il y avait, remarque Clarke, enfouis dans les dossiers du FBI et de la CIA, des renseignements au sujet de deux de ces terroristes d’al-Qaïda qui se trouvaient être des pirates de l’air [Khalid al-Mihdar et Nawaf al-Hazmi]. Les dirigeants du FBI l’ignoraient, mais si les dirigeants avaient dû tout signaler à la Maison-Blanche, tous les jours… ils auraient remué ciel et terre et ils auraient découvert que ces gars étaient là. » Est-ce que cela aurait, pour autant, déjoué les attaques du 11-Septembre ? « On avait une chance, soutient Clarke, mais les responsables de l’administration Bush, au plus haut niveau, ne l’ont pas saisie. » Quand Donald Trump balance des insultes à ses adversaires, les gens respectables lèvent généralement les yeux au ciel. Mais c’est précisément le refus de Trump d’être respectable qui l’aide à susciter des débats que les élites préféreraient éviter. Et il est parfois important que ces débats aient lieu. Comme les conseillers de George W. Bush dominent toujours l’establishment républicain dans le domaine de la politique étrangère – un establishment qui n’a pas rompu fondamentalement avec son héritage idéologique –, la façon dont il a agi doit être prise en compte dans le débat actuel sur le terrorisme. Pendant de nombreuses années, cet establishment dans le domaine de la politique étrangère a soutenu que s’interroger sur l’échec de Bush à empêcher le 11-Septembre était une calomnie scandaleuse. C’est la raison pour laquelle Fleischer traite maintenant Trump de « conspirationniste ». Il estompe sciemment la frontière entre accuser Bush d’avoir orchestré les attentats et accuser Bush de ne pas les avoir empêchés par manque de vigilance efficace. Toutefois Bush a effectivement péché par manque de vigilance. Les preuves sont accablantes. On peut admettre que la fidélité de Jeb à son frère l’empêche d’affronter cette réalité. Mais il n’a aucun droit d’exiger que l’ensemble de la population détourne les yeux. Source : The Atlantic, le 19/10/2015 Traduit par les lecteurs du site www.les-crises.fr. Traduction librement reproductible en intégralité, en citant la source. |