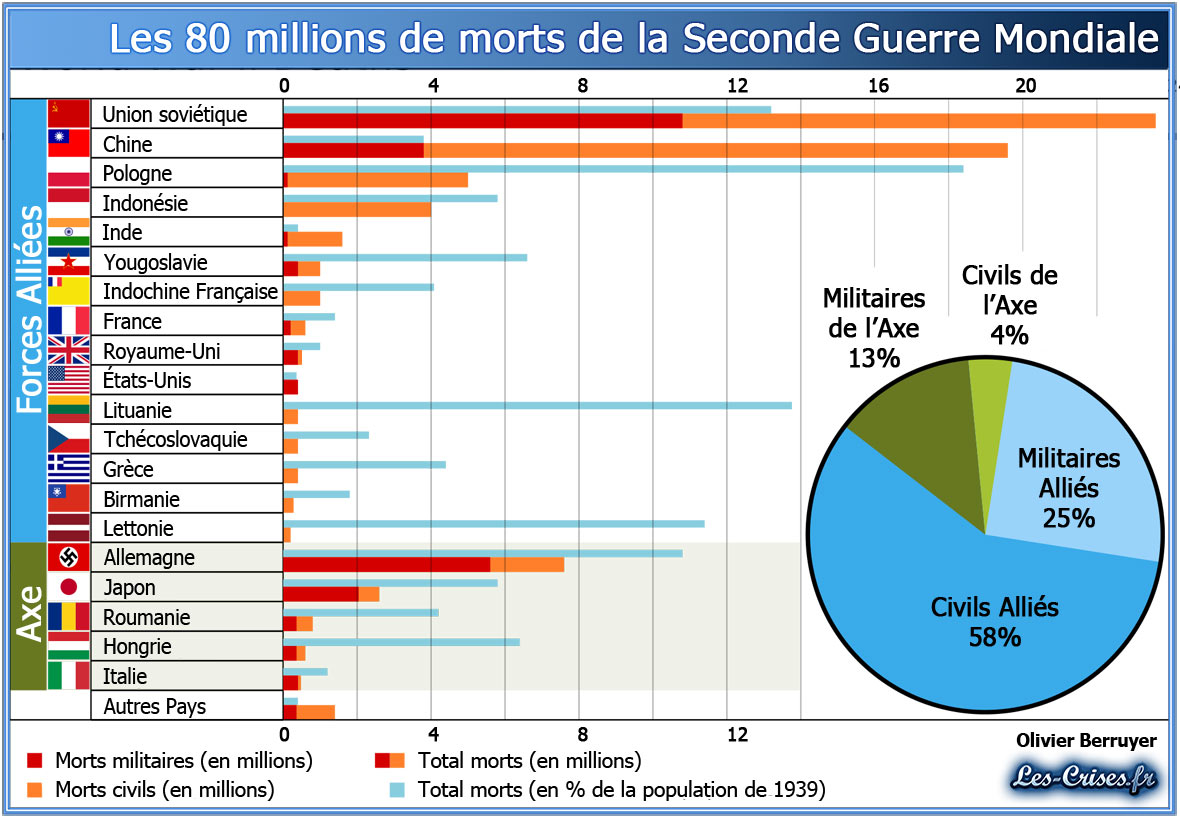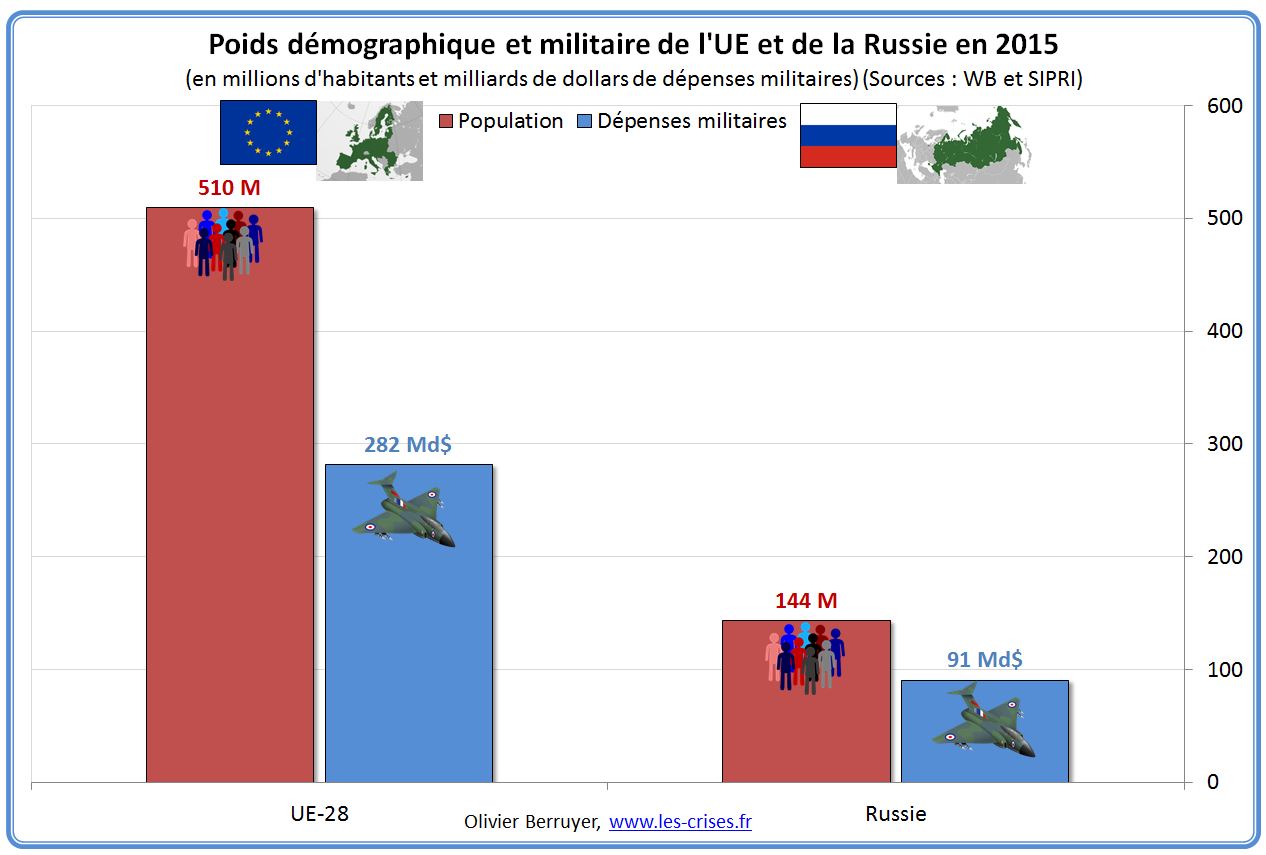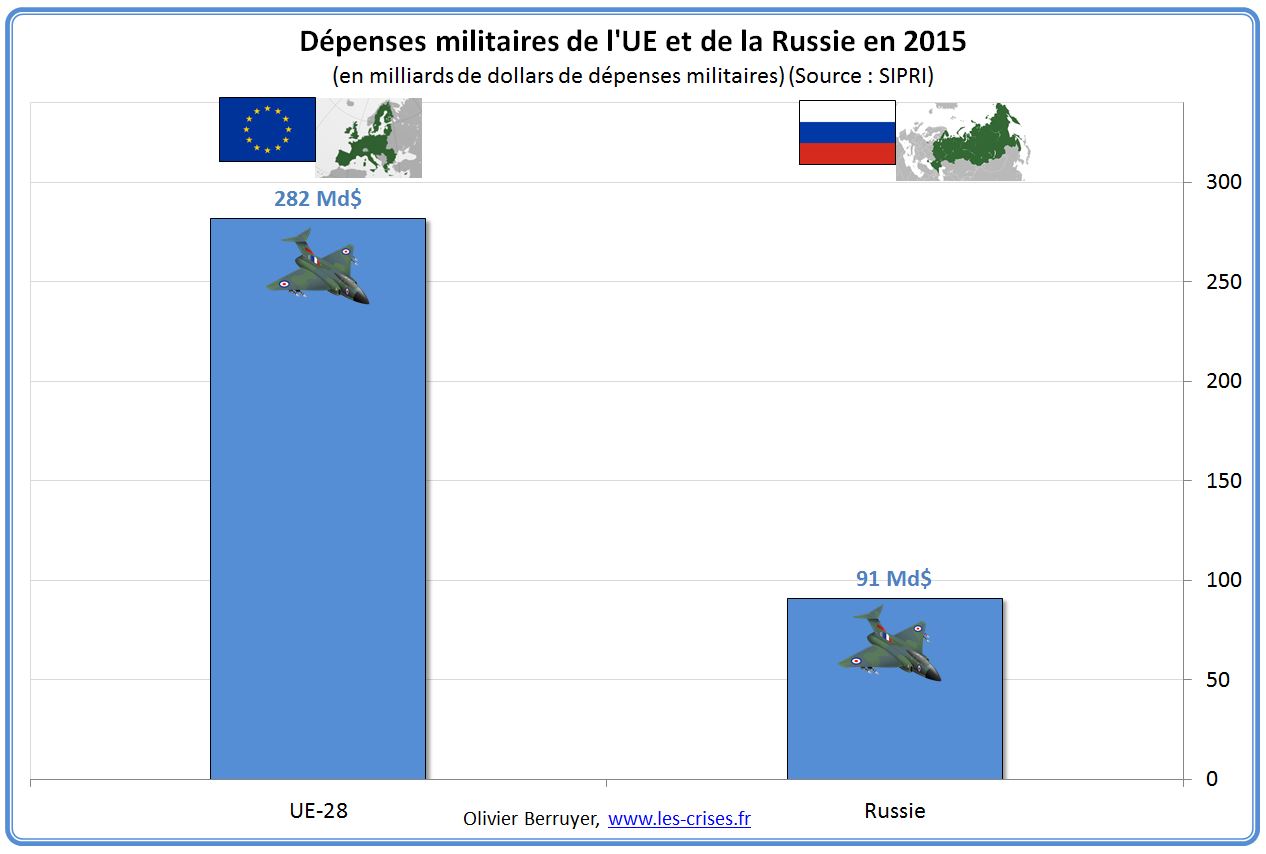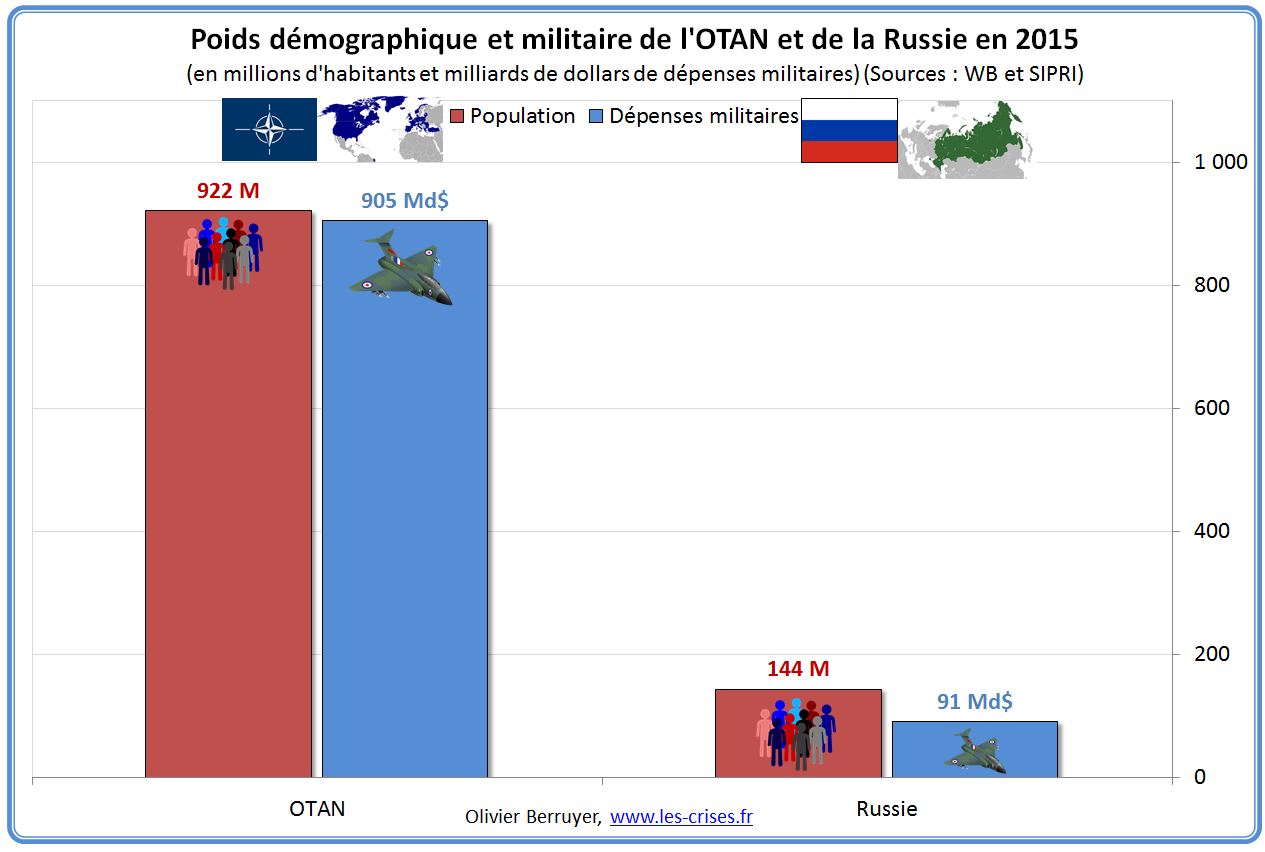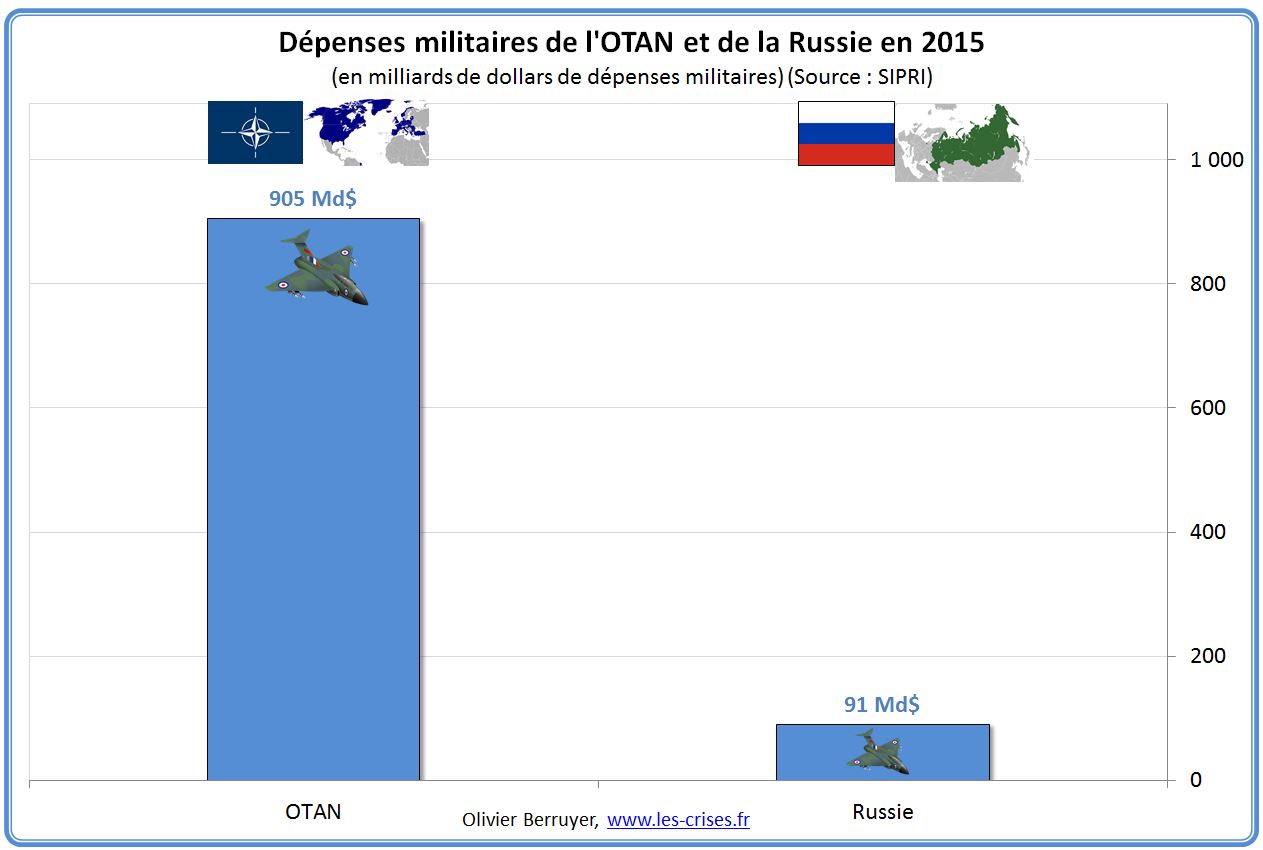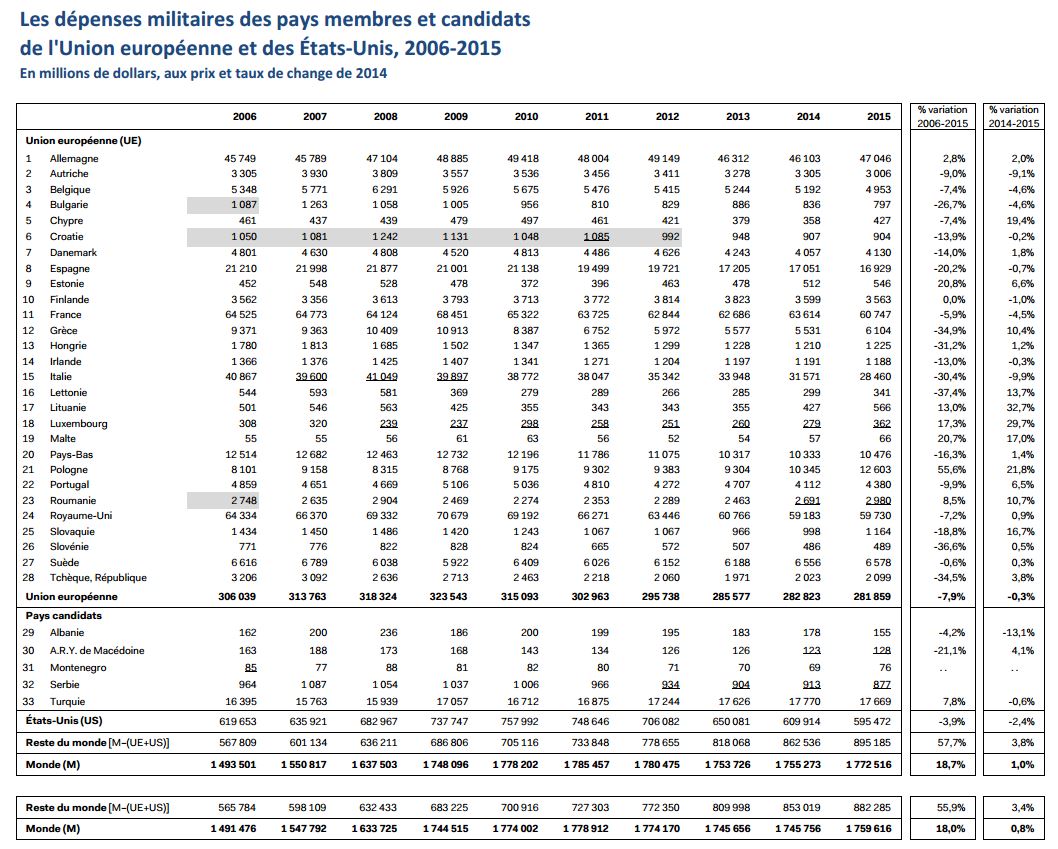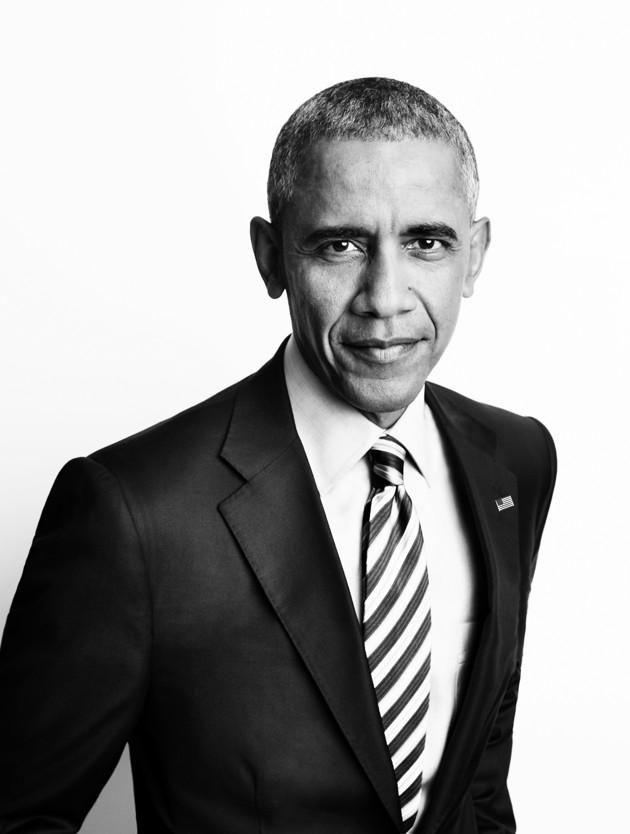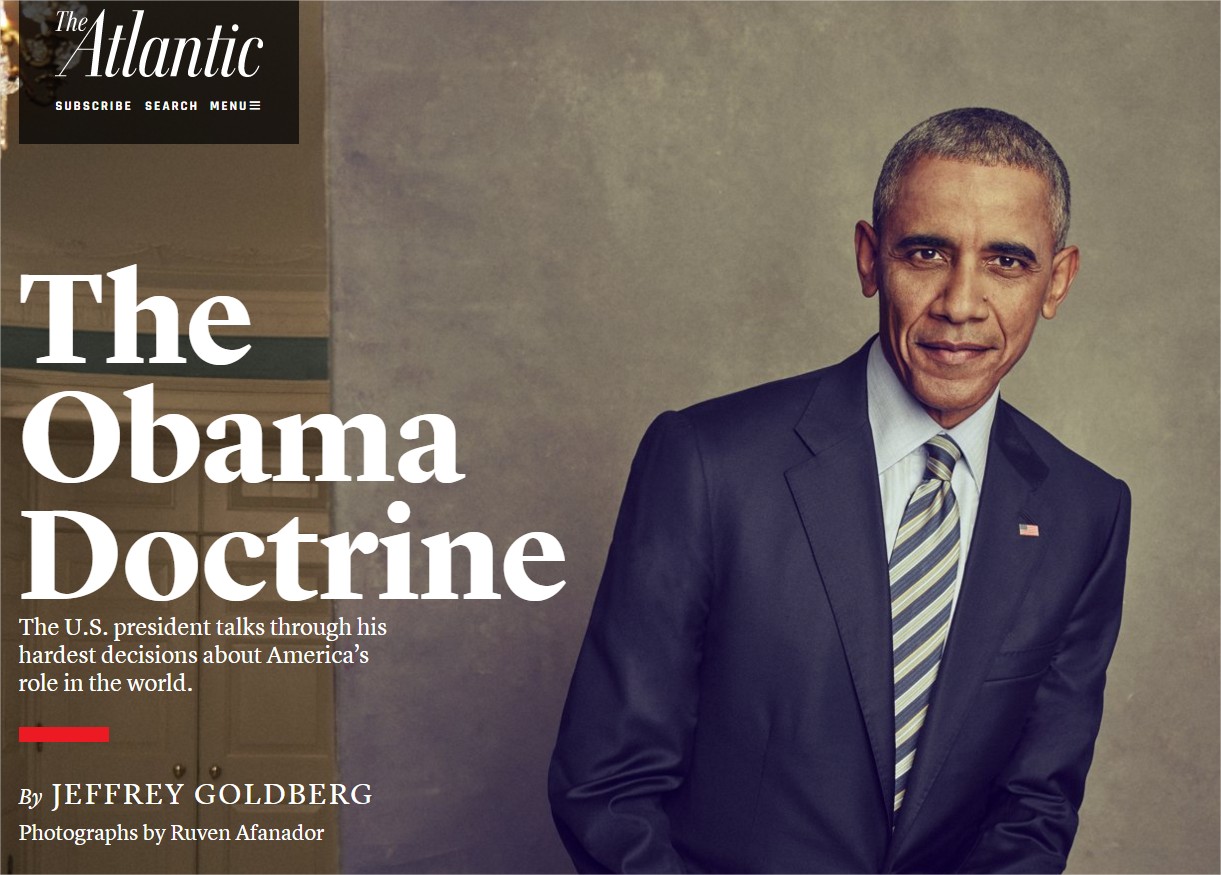Cette série de 5 billets est une traduction d’un article de Jeffrey Goldberg, qui a interviewé à de multiples reprises Obama pour le rédiger. C’est une sorte de “Testament diplomatique”, où il fait le bilan des décisions les plus difficiles qu’il a dû prendre concernant le rôle de l’Amérique dans le monde. Merci aux contributeurs qui ont traduit ce très long article.
Obama a fermement résisté aux demandes de Kerry, et semblait ressentir une impatience grandissante face à son lobbying. Récemment, lorsque Kerry tendit un résumé écrit des futures étapes pour mettre plus de pressions encore sur Assad, Obama dit : « Ho, une autre proposition ? » Des représentants de l’administration m’ont dit que le vice-président Biden également commençait à être irrité des demandes de Kerry pour plus d’action. Il a dit en privé au Secrétaire d’État : « John, tu te souviens du Vietnam ? Tu te souviens comment ça a commencé ? » Lors d’une réunion du Conseil sur la sécurité nationale se tenant au Pentagone en décembre, Obama annonça que personne, excepté le secrétaire à la Défense, ne devrait lui amener des propositions pour une action militaire. Les officiels du Pentagone comprirent que la déclaration d’Obama était une remarque directement adressée à Kerry. Obama a fait le pari que le prix d’une action directe en Syrie serait supérieure à celui de l’inaction. Un jour en janvier, dans le bureau de Kerry au Département d’État, j’exprimai l’évidence : Il avait plus qu’un parti pris à l’égard de l’action menée par le président. « Probablement, » a reconnu Kerry. « Ecoutez, sur ces choses il a le dernier mot… Je dirais que je pense que nous avons eu une relation très symbiotique, synergique, ou peu importe comment vous appelez ça, qui fonctionne très efficacement. Parce que je viendrai avec un parti pris “Essayons de faire ceci, essayons de faire ça, faisons ça.” » La prudence d’Obama en Syrie a vexé ceux qui dans l’administration avaient vu des occasions, à différents moments durant les quatre dernières années, de préparer le terrain contre Assad. Certains pensaient que la décision de Poutine de combattre au nom d’Assad aurait décidé Obama à intensifier les efforts américains pour aider les rebelles anti-régime. Mais Obama, au moins au moment de l’écriture de ces lignes, ne bougerait pas, en partie parce qu’il pensait que ce n’était pas à lui d’empêcher la Russie de faire ce qu’il jugeait une terrible erreur. « Ils sont débordés, ils saignent, » me dit-il. « Et leur économie s’est contractée durant trois années de suite, de façon drastique. » 
Obama rencontre le roi de Jordanie Abdullah II à la Maison-Blanche en février 2015. Durant les dernières réunions du Conseil de sécurité nationale, la stratégie d’Obama se référait occasionnellement à “l’approche Tom Sawyer”. La vision d’Obama était que si Poutine voulait dépenser les ressources de son régime en allant peindre les clôtures en Syrie, le gouvernement américain devrait les laisser faire. Plus tard durant l’hiver, cependant, lorsqu’il apparut que la Russie réalisait des avancées dans sa campagne pour solidifier le régime d’Assad, la Maison-Blanche commença à discuter des possibilités de renforcement de l’aide aux rebelles, toutefois l’hésitation du président sur un engagement plus intensif persista. Lors de conversations que j’eus avec des membres du Conseil pour la sécurité nationale durant les deux derniers mois, j’eus le pressentiment qu’un événement – une autre attaque du style de San Bernardino par exemple – forcerait les États-Unis à prendre des mesures nouvelles et plus directes en Syrie. Pour Obama, ce serait un cauchemar. S’il n’y avait pas eu l’Irak, l’Afghanistan et la Libye, me dit Obama, il aurait peut-être été plus prompt à prendre des risques en Syrie. « Un président ne prend pas de décisions dans le vide. Il n’a pas une ardoise vierge. Tout président sensé, je pense, reconnaîtrait qu’après une décennie de guerre, avec des obligations qui requièrent encore aujourd’hui un important niveau de ressources et d’attention en Afghanistan, avec l’expérience de l’Irak, avec le stress que cela met sur notre armée – tout président sensé hésiterait à s’engager à nouveau dans la même région du globe avec les mêmes dynamiques à l’œuvre et probablement la même issue insatisfaisante. » Etes-vous trop prudent ?, demandais-je. « Non, » dit-il. « Est-ce que je pense que si nous n’avions pas envahi l’Irak et n’étions pas toujours engagés à envoyer des milliards de dollars, de nombreux formateurs et conseillers militaires en Afghanistan, j’aurais pu penser prendre davantage de risques afin d’essayer d’aider à l’amélioration de la situation en Syrie ? Je ne sais pas. » Ce qui me frappa est que, alors même que son secrétaire d’État l’avertit à propos d’une dramatique apocalypse européenne alimentée par la Syrie, Obama n’avait pas fait basculer la guerre civile du pays dans la catégorie des menaces prioritaires. L’hésitation d’Obama à rejoindre la bataille en Syrie est relevée comme une preuve par ses détracteurs de sa trop grande naïveté ; sa décision de 2013 de ne pas envoyer les missiles est une preuve, avancent-ils, qu’il est un bluffeur. Cette critique irrite le président. « Plus personne ne se souvient de ben Laden, » dit-il. « Plus personne ne me parle du fait que j’ai mobilisé 30 000 soldats supplémentaires en Afghanistan. » La crise de la ligne rouge, dit-il, « est le point de la pyramide inversée sur lequel toutes les autres théories reposent. » Un après-midi à la fin de janvier, alors que je quittais le bureau ovale, je fis allusion auprès d’Obama à un moment d’une interview de 2012 lorsqu’il m’avait dit qu’il n’autoriserait pas l’Iran à obtenir l’arme nucléaire. « Vous avez dit, “Je suis le président des États-Unis, je ne bluffe pas.” » Il dit, « Je ne bluffe pas. » Peu de temps après cette interview, il y a quatre ans, Ehud Barak, qui était alors le ministre de la Défense d’Israël, me demanda si je pensais que la promesse d’Obama de ne pas bluffer était elle-même un bluff. Je répondis que je trouvai cela difficile à imaginer que le leader des États-Unis blufferait à propos de quelque chose de si important. Mais la question de Barak ne me quitta pas. Donc, alors que je me trouvais sur le pas de la porte avec le président, je demandai : «Était-ce du bluff ? » Je lui dis que certaines personnes aujourd’hui pensaient qu’il aurait bien attaqué l’Iran pour l’empêcher d’obtenir l’arme nucléaire. « C’est intéressant, » dit-il, de manière évasive. Je commençais à dire : « Est-ce que vous… » Il m’interrompit. “Je l’aurais vraiment fait,” dit-il, sous-entendant le bombardement des installations nucléaires iraniennes. “Si je les avais vues se développer.” Il ajouta : “La question est maintenant insoluble, parce que c’est complètement conjoncturel, ce que constitue l’obtention” de la bombe. “C’était la dispute que j’avais avec Bibi Netanyahou.” Netanyahou voulait qu’Obama empêche l’Iran d’être capable de construire une bombe, et non simplement d’avoir une bombe. “Vous aviez raison de le croire,” dit le président. Et il a ajouté l’élément capital. “Ceci entrait dans la catégorie des intérêts américains.” Je me suis alors souvenu de ce que Derek Chollet, un ancien membre du Conseil de la sécurité nationale, m’avait dit : “Obama est un parieur, pas un bluffeur.” 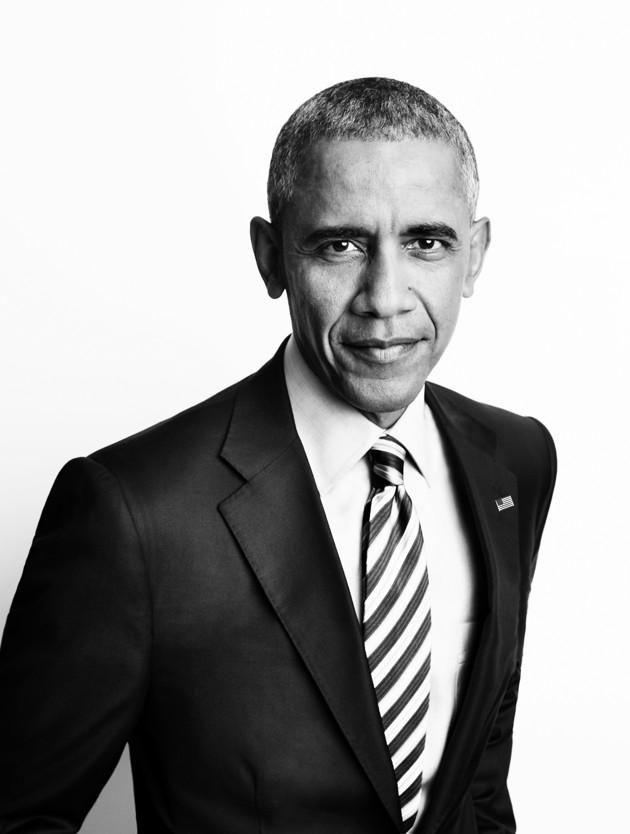
Le président avait joué très gros. En mai dernier, alors qu’il tentait de faire passer l’accord nucléaire iranien devant le Congrès, je lui dis que cet accord me rendait nerveux. Sa réponse était éloquente. “Écoutez, dans 20 ans, si Dieu le veut, je serais encore là. Si l’Iran a une arme nucléaire, mon nom sera là-dessus,” dit-il. “Je pense qu’il est juste de dire qu’en plus de nos intérêts profonds de sécurité nationale, j’ai un intérêt personnel à bien verrouiller tout cela.” Au sujet du régime syrien et de ses soutiens iraniens et russes, Obama avait parié, et semblait prêt à continuer à parier que le prix d’une intervention américaine directe serait plus élevé que le prix de l’inaction. Et il est suffisamment sanguin pour vivre avec les ambiguïtés périlleuses de ses décisions. Bien qu’Obama ait dit, lors de son discours du prix Nobel de la paix 2009, que “l’inaction déchire notre conscience et peut amener à une intervention plus coûteuse par la suite,” aujourd’hui les opinions des interventionnistes humanitaires ne le touchent pas, du moins pas publiquement. Il sait certainement que la prochaine génération de Samantha Power critiquera sa réticence à faire plus pour arrêter la boucherie en cours en Syrie. (A ce sujet, Samantha Power sera aussi critiquée par la prochaine Samantha Power.) À l’approche de la fin de son mandat, Obama croit qu’il a fait un grand cadeau à son pays en restant en dehors du maelström – et je soupçonne qu’il croit qu’un jour, les historiens le jugeront sage pour cela. Les collaborateurs de l’aile Ouest de la Maison-Blanche [The West Wing, titre d’un feuilleton sur la vie quotidienne du président et de ses collaborateurs, NdT] disent d’Obama, comme président ayant hérité de son prédécesseur d’une crise financière et de deux guerres actives, qu’il souhaite vivement laisser “des affaires en ordre” à quiconque lui succédera. Voilà pourquoi le combat contre l’ÉI, un groupe qu’il considère comme une menace directe contre les États-Unis, quoique non existentielle, est la priorité la plus urgente du reste de son mandat ; tuer le soi-disant calife de l’État Islamique, Abou Bakr al-Baghdadi, est un des objectifs prioritaires de l’appareil de sécurité nationale américain pour la dernière année d’Obama. Bien entendu, l’ÉI doit en partie son existence au régime d’Assad. Pourtant selon les normes exigeantes d’Obama, le maintien du régime d’Assad pour le moment ne s’élève pas au niveau d’un défi direct à la sécurité nationale américaine. Voilà ce qui est si controversé dans l’approche du président, et qui restera controversé pour des années encore – la norme qu’il a utilisée pour définir ce qui, précisément, constitue une menace directe. Obama a tiré un certain nombre de conclusions cohérentes sur le monde, et sur le rôle qu’y tient l’Amérique. La première est que le Moyen-Orient n’est plus extrêmement important pour les intérêts américains. La deuxième est que même si le Moyen-Orient était nettement plus important, il n’y aurait pas grand-chose qu’un président américain puisse faire pour l’améliorer. La troisième est que le désir inné des Américains de remédier aux problèmes de la sorte de ceux qui se manifestent le plus radicalement au Moyen-Orient amène inévitablement à la guerre, à la mort de soldats américains, et à la perte éventuelle de la crédibilité et de la puissance des États-Unis. La quatrième est que le monde ne peut se permettre une diminution du pouvoir des États-Unis. Au moment où les dirigeants de plusieurs alliés américains jugeaient que la direction d’Obama n’était pas à la hauteur des tâches à mener, il a trouvé lui-même la direction du monde insuffisante : des partenaires internationaux généralement sans vision ni volonté pour poursuivre des objectifs progressistes de grande ampleur, et des adversaires qui dans son esprit, ne sont pas aussi rationnels que lui. Obama est convaincu que l’histoire prend parti, et que les adversaires de l’Amérique – et certains de ses alliés potentiels – se sont placés eux-mêmes du mauvais côté, celui où fleurissent le tribalisme, le fondamentalisme, le sectarisme et le militarisme. Ils ne comprennent pas que l’histoire va dans son sens. “L’argument central est qu’en empêchant l’Amérique de plonger au milieu des crises du Moyen-Orient, le personnel des Affaires étrangères pense que le président précipite notre déclin,” m’a dit Ben Rhodes. “Mais le président de son côté est de l’opinion contraire, à savoir que l’extension excessive au Moyen-Orient nuira à notre économie, à notre capacité à trouver d’autres opportunités et relever d’autres défis, et, surtout, mettra en danger les vies des membres des services américains pour des raisons qui ne sont pas dans l’intérêt direct de la sécurité nationale américaine.” Si vous soutenez le président, sa stratégie est éminemment sensée : doubler la mise dans les parties du monde où le succès est plausible, et limiter l’exposition américaine pour le reste. Ses critiques pensent toutefois que les problèmes tels que ceux du Moyen-Orient ne se résolvent pas d’eux-mêmes – que sans intervention américaine, ils métastasent. À cet instant, la Syrie, où l’histoire semble pencher vers toujours plus de chaos, constitue le défi le plus direct à la conception du monde du président. George W. Bush était aussi un parieur, pas un bluffeur. On se souviendra de lui sévèrement pour ce qu’il a fait au Moyen-Orient. Barack Obama parie qu’il sera bien jugé pour les choses qu’il n’a pas faites. Source : The Atlantic, le 09/03/2016 Traduit par les lecteurs du site www.les-crises.fr. Traduction librement reproductible en intégralité, en citant la source. 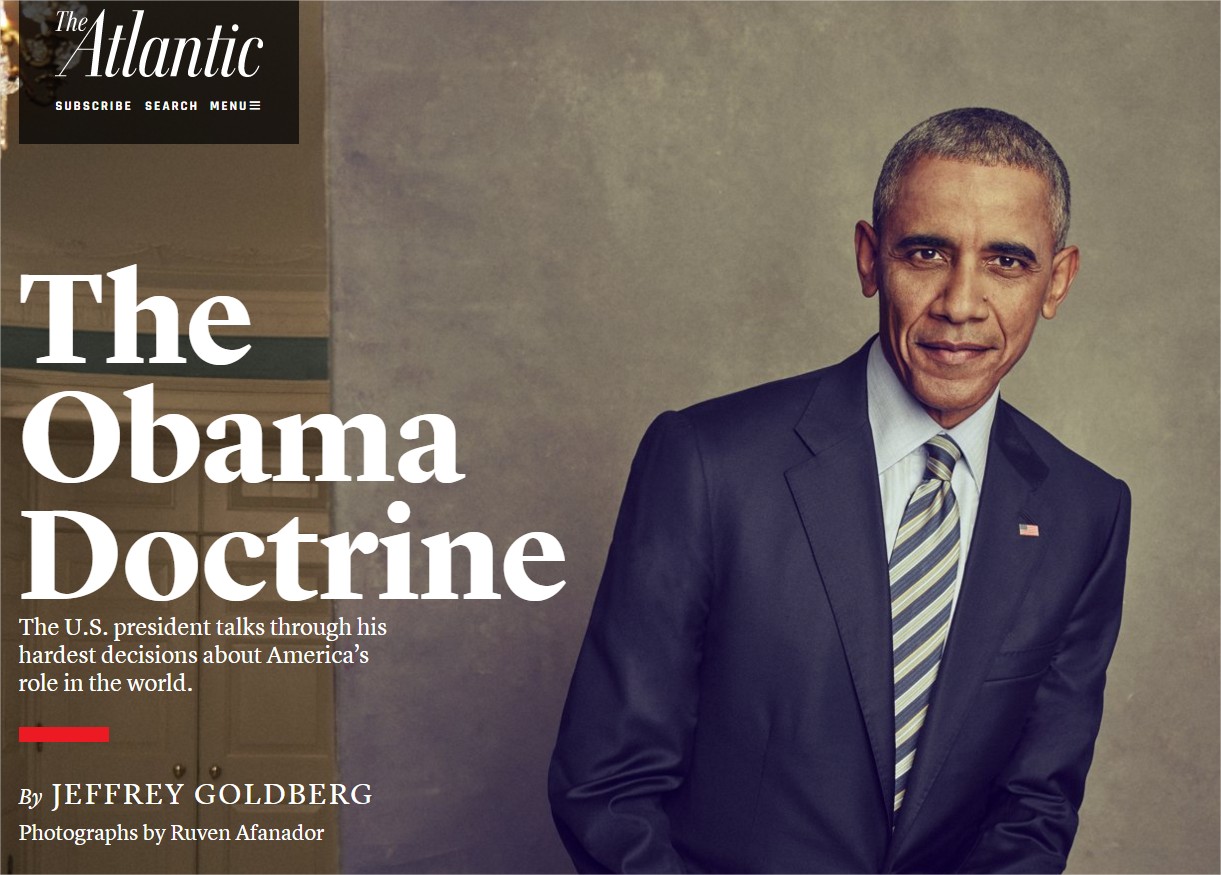
|