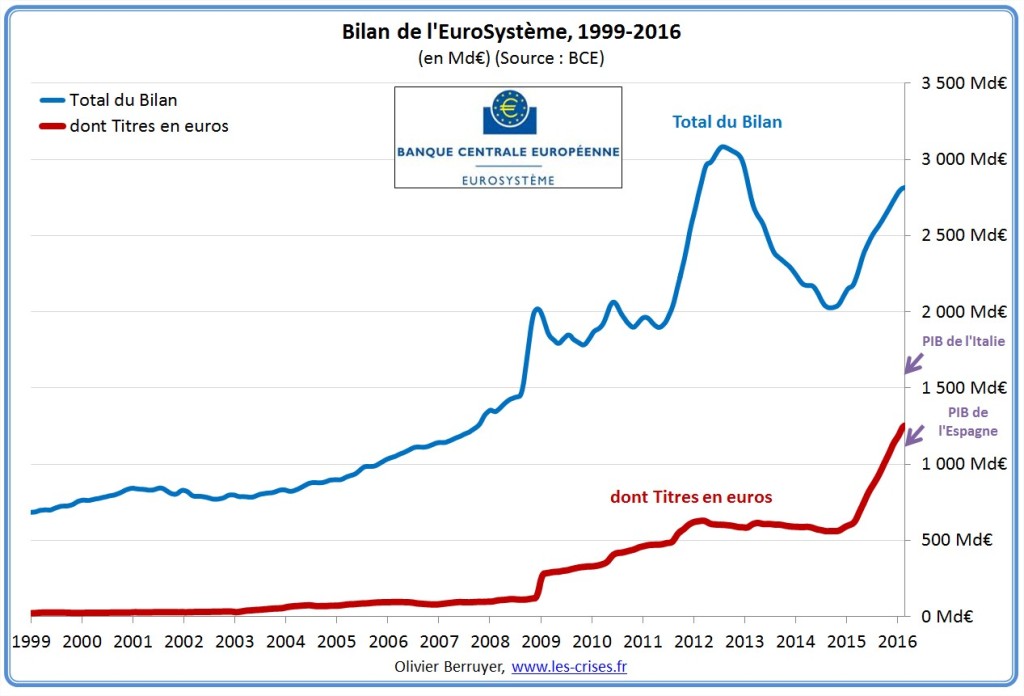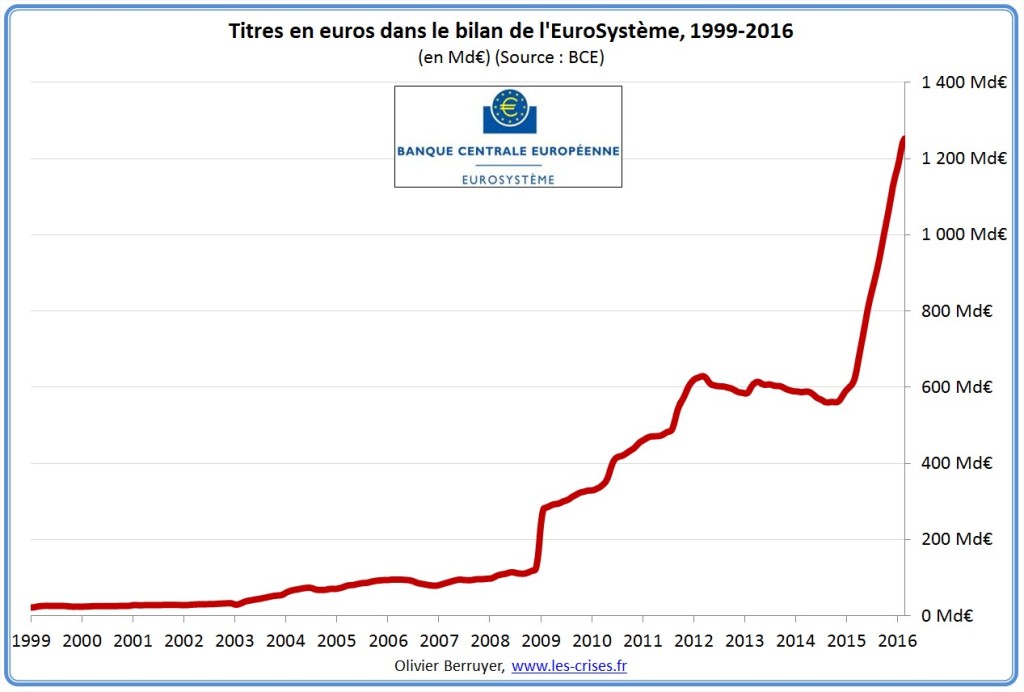| Source : Consortiumnews.com, le 18/02/2016 Le 18 février 20168 Exclusif : Le risque que le conflit multilatéral syrien déclenche une Troisième Guerre mondiale persiste, alors que la Turquie, l’Arabie saoudite et les néoconservateurs américains réfléchissent à une invasion capable d’arrêter les troupes russes – et potentiellement de faire dégénérer la crise syrienne en une confrontation nucléaire, tout ça pour protéger des terroristes d’al-Qaïda, a déclaré Robert Parry. Par Robert Parry Quand le président Barack Obama a répondu aux questions des journalistes mardi, celle qui aurait dû être posée – mais ne l’a pas été – était de savoir si oui ou non il avait interdit à la Turquie et à l’Arabie saoudite d’envahir la Syrie, car c’est bien ça qui pourrait faire dégénérer l’épouvantable guerre civile syrienne en une Troisième Guerre mondiale, voire en un conflit nucléaire. Si la Turquie (avec des centaines de troupes massées près de la frontière syrienne) et l’Arabie saoudite (et son aviation de pointe) mettent leurs menaces à exécution et interviennent militairement en Syrie pour sauver leurs obligés rebelles, dont le Front al-Nosra d’al-Qaïda, de la forte offensive du gouvernement syrien soutenue par la Russie, alors cette dernière devra prendre une décision concernant la protection de ses quelque 20 000 militaires présents en Syrie. 
Le président Barack Obama réunit le vice-président Joe Biden et d’autres conseillers dans le bureau ovale le 2 février 2016. [Photo de la Maison-Blanche] Une source proche du président Vladimir Poutine m’a dit que les Russes avaient prévenu le président turc Recep Tayyip Erdogan que Moscou était prête à utiliser des armes nucléaires tactiques pour sauver ses troupes face une attaque turco-saoudienne. La Turquie étant membre de l’OTAN, un tel conflit pourrait rapidement tourner en une confrontation nucléaire de grande envergure. Étant donné la mégalomanie d’Erdogan ou encore l’instabilité mentale, l’agressivité et l’inexpérience du prince saoudien Mohammed bin Salman (ministre de la Défense et fils du roi Salman), la seule personne capable d’empêcher une invasion turco-saoudienne est le président Obama. Mais je me suis laissé dire qu’il était réticent à interdire complètement une telle intervention, même s’il a cherché à calmer Erdogan et a clairement indiqué que les États-Unis ne participeraient pas à l’invasion. Pour l’instant, Erdogan a limité l’implication militaire directe de la Turquie en Syrie à des tirs d’obus transfrontaliers sur les forces kurdes, soutenues par les États-Unis, qui avaient repris du terrain à l’État Islamique (ISIS) dans le nord de la Syrie. La Turquie considère les combattants kurdes, le YPG, comme des terroristes, mais le gouvernement américain les voit comme de précieux alliés contre l’État Islamique, groupe dérivé d’al-Qaïda qui contrôle de larges territoires en Syrie et en Irak. Mais Erdogan a sans doute encore perdu le peu de patience qui lui restait après qu’un attentat à la voiture piégée a tué au moins 28 personnes mercredi à Ankara, la capitale turque. La bombe visait apparemment un convoi militaire et les officiels turcs suspectent des militants kurdes, également visés par les forces turques à l’intérieur du pays. Alors qu’aucune preuve n’a été avancée, les officiels turcs suggèrent que l’attaque a été commanditée par l’Iran ou la Russie, encore un signe du degré de complexité du chaos géopolitique syrien. “Ceux qui pensent qu’ils peuvent détourner notre pays de ses objectifs en utilisant des organisations terroristes verront qu’ils ont échoué,” a déclaré Erdogan selon le Wall Street Journal. (Mercredi soir la Turquie a bombardé des positions kurdes dans le nord de l’Irak en représailles à l’attentat d’Ankara.) Le dilemme pour Obama est que la plupart des alliés traditionnels des États-Unis comme la Turquie, l’Arabie saoudite, le Qatar, ont été les principaux soutiens et sources de financement des groupes terroristes sunnites en Syrie, y compris le Front al-Nosra d’al-Qaïda et – quoique dans une moindre mesure – l’État Islamique. Maintenant, ces “alliés” voudraient que les États-Unis risquent une confrontation nucléaire avec la Russie pour, de fait, protéger al-Qaïda. 
Le président turc Recep Tayyip Erdogan Biden laisse échapper la vérité L’ironie de la situation a même été reconnue par le vice-président Joe Biden lors d’une conférence à Harvard en 2014. Biden répondait à la question d’un étudiant en disant que la Turquie, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis avaient “versé des centaines de millions de dollars et des dizaines de milliers d’armes à quiconque se battrait contre [le président syrien Bashar el] Assad”. Le résultat, dit Biden, est que “ceux qui ont été approvisionnés sont al-Nosra, al-Qaïda et les djihadistes extrémistes venus du monde entier.” Les risques de ces alliances nébuleuses ont aussi été soulignés par le rapport de la Defense Intelligence Agency (DIA) en août 2012 qui avait averti l’administration Obama que la force grandissante d’al-Qaïda et des autres djihadistes sunnites en Syrie pourrait mener à la création d’un “État Islamique” dont les militants pourraient se replier en Irak où la menace était originellement apparue après l’invasion américaine. La DIA précisait que la force grandissante d’al-Qaïda en Syrie “crée le climat idéal pour que AQI [al-Qaïda en Irak] retourne dans son berceau de Mossoul et de Ramadi et apporte une nouvelle impulsion sous couvert d’unifier le djihad entre l’Irak et la Syrie sunnites et le reste du monde arabe sunnite contre ce qu’ils considèrent l’ennemi, les dissidents [i.e. les chiites]. ISI [L’État Islamique en Irak, ancêtre d’ISIS, connu comme l’État Islamique] pourrait également déclarer un État Islamique au travers d’une union avec les organisations terroristes en Irak et en Syrie, ce qui créerait de graves risques pour l’unification de l’Irak et la protection de son territoire.” Malgré la clairvoyance du rapport de la DIA et l’aveu de Biden (pour lequel il a rapidement présenté des excuses), le président Obama n’a pas modifié la stratégie de soutien aux opposants d’Assad. Il a laissé l’Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie continuer à faire passer des armes aux éléments les plus extrémistes de la rébellion. Dans le même temps, le gouvernement américain insistait sur le fait qu’il n’armait que les rebelles “modérés”, alors que ces groupes étaient pour la plupart absorbés ou contrôlés par al-Nosra d’al-Qaïda et/ou ISIS, un dérivé ultraviolent d’al-Qaïda. En Syrie, au lieu de coopérer avec la Russie et l’Iran pour aider l’armée d’Assad à vaincre les djihadistes, l’administration Obama a continué à la jouer fine en insistant – comme le secrétaire d’État John Kerry l’a dit récemment – sur le fait que des “groupes d’opposition légitimes” armés existaient indépendamment du Front al-Nosra d’al-Qaïda. 
Le secrétaire d’État John Kerry saluant les journalistes à Genève le 8 Novembre 2013. (Crédit photo : Département d’État) Cependant, en réalité, les prétendus rebelles modérés autour d’Alep et d’Idlib sont des seconds couteaux d’al-Qaïda dont la valeur pour la cause est justement de pouvoir prétendre aux livraisons d’armements de la CIA qui peuvent être ensuite transmises à al-Nosra ou à l’allié clé d’al-Nosra, Ahrar al-Sham, ainsi qu’à d’autres combattants djihadistes. Nosra et Ahrar al-Sham, les principaux éléments de la création saoudienne “l’Armée de Conquête,” ont déployé des missiles TOW américains aux effets dévastateurs sur l’armée syrienne dans la victoire des djihadistes l’année dernière dans la province d’Idlib ; un succès qui a finalement décidé Poutine à envoyer l’aviation russe pour défendre le gouvernement syrien en septembre dernier. Aider l’État Islamique Pendant ce temps la Turquie a laissé près de 100 km de frontière ouverte pour que différents groupes djihadistes puissent passer des renforts et de l’armement tout en laissant l’État Islamique sortir son pétrole pour le revendre au marché noir. L’automne dernier, après que la Russie (et des États-Unis réticents) ont commencé à bombarder les convois de pétrole d’ISIS, la Turquie a abattu un avion de chasse russe près de la frontière turque, entraînant la mort du pilote et d’un membre de l’équipe de sauvetage. Maintenant, alors que l’armée syrienne, soutenue par la Russie, fait des progrès considérables dans sa lutte contre les rebelles majoritairement dominés par al-Nosra autour d’Alep et commence à refouler l’État Islamique hors de son fief Raqqa, et que les forces kurdes soutenues par les États-Unis avancent aussi dans leur front contre l’ÉI, la Turquie d’Erdogan commence à redouter fiévreusement que son projet de soutien aux djihadistes syriens, vieux de 5 ans, ne s’effondre. Au milieu de ce tumulte, la Turquie presse le président Obama de soutenir une invasion limitée de la Syrie ayant pour but de créer une “zone sûre”, censée protéger les rebelles syriens ainsi que les civils du nord de la Syrie. Mais derrière ce plan aux allures humanitaires se cache un plan plus ambitieux de marcher sur Damas et ainsi renverser le président Assad. C’est un objectif que se partagent la Turquie, l’Arabie saoudite et d’autres États sunnites, ainsi qu’Israël et l’influent bloc néoconservateur américain et ses “interventions libératrices”. Pour sa part, Obama a appelé Assad à “démissionner” mais favorise une solution diplomatique. La Russie a soutenu une solution politique, en organisant des élections libres, laissant ainsi au peuple syrien le choix du destin d’Assad. Les Russes ne se sont pas gênés de rappeler le subterfuge occidental en Libye de 2011, lorsque les États-Unis et l’OTAN ont sanctionné une résolution “humanitaire” du conflit au travers du Conseil de Sécurité des Nations Unies, prétendant protéger le peuple libyen, mais se couvrant derrière cette dernière afin de provoquer un violent changement de régime ; un cas typique du pied dans la porte. Alors qu’en Syrie, la Russie fut témoin durant plusieurs années du soutien apporté par les États-Unis, la Turquie, le Qatar et d’autres États sunnites aux différents groupuscules rebelles sunnites tentant de renverser Assad, un alaouite, représentant d’une branche de l’islam chiite. Bien qu’Assad ait été violemment critiqué pour son attitude radicale face au soulèvement, il a tout de même réussi à maintenir un gouvernement laïque qui tâche de défendre chrétiens, alaouites, chiites et d’autres minorités. En plus d’être la cible des puissances sunnites régionales, Assad est depuis longtemps sur la liste des néoconservateurs israéliens car il est vu comme la pièce maîtresse du “croissant chiite”, qui s’étire de l’Iran à l’Irak en passant par la Syrie et le Liban. Depuis que les dirigeants israéliens (et donc les néocons américains) perçoivent l’Iran comme le plus grand ennemi d’Israël, les efforts pour démolir le “croissant chiite” se sont concentrés sur la défection d’Assad – même si son éviction risquerait de créer un vide politico-militaire qui pourrait être rempli par al-Qaïda et/ou l’État Islamique. 
Le président syrien Bachar el-Assad Faire de la Syrie le lieu de cette guerre par procuration a eu des conséquences catastrophiques sur les Syriens. Depuis cinq ans, la violence des engagements tant des rebelles que de l’armée a ravagé le pays, tuant plus de 250 000 personnes et en forçant à l’émigration des vagues entières de réfugiés désespérés vers l’Europe, déstabilisant l’Union européenne à son tour. En conséquence, alors que les États-Unis et leurs alliés au Moyen-Orient – notamment l’Arabie saoudite et la Turquie – ont encore nourri le conflit en approvisionnant les rebelles, dont notamment le Front al-Nosra, branche d’Al-Qaïda, avec des missiles américains TOW et d’autres armes sophistiquées, le président russe Poutine a décidé qu’il était temps d’aider le gouvernement syrien à juguler l’expansion du terrorisme sunnite, une menace planant également sur la Russie. Se moquer de la Russie Dans un premier temps, Washington se moqua des efforts russes, les qualifiant de peu efficaces, cependant les récentes victoires de l’armée syrienne ont eu comme effet de transformer, sous la surprise, les moqueries initiales en colère. Par exemple, le Washington Post, figure de proue du néo-conservatisme, a publié à jet continu un flot d’éditoriaux et de lettres ouvertes dénigrant les victoires russo-syriennes. “La Russie, l’Iran et le gouvernement syrien conduisent une offensive majeure avec pour objectif la reconquête de la ville d’Alep et les territoires contrôlés par les rebelles qui la connectent à la frontière turque,” se lamente le Post. “Ils ont coupé une route de ravitaillement de la ville et sont près d’en contrôler une autre, piégeant les rebelles, ainsi que des centaines de milliers de civils.” Alors qu’on aurait pu penser qu’éjecter les forces d’al-Qaïda hors d’un centre urbain majeur comme celui d’Alep soit en soi une bonne chose, les rédacteurs néocons du Post prétendent que seuls de nobles rebelles “modérés” contrôlent cette zone, et qu’en conséquence il est du devoir des États-Unis de les protéger. Il n’est fait aucune mention du Front al-Nosra d’al-Qaïda, sûrement afin de ne pas abîmer la belle image souhaitée par cette propagande. Le Post pressa alors Obama de faire quelque chose : « Face à cette offensive, qui promet de détruire toute chance d’une fin acceptable de la guerre civile syrienne, l’administration Obama a observé une attitude de passivité et de confusion morale. Le président Obama reste silencieux. » Dans un autre éditorial hystérique, les rédacteurs du Post ont évoqué ce qu’ils ont appelé « le monde réel » où « le meilleur scénario possible, après cinq ans d’inaction américaine, est une paix partielle laissant la Syrie divisée en zones contrôlées par le régime [d’Assad] et l’État Islamique, et quelques enclaves coincées laissées à l’opposition et aux Kurdes. Même cela exigerait que l’administration Obama intensifie énergiquement son assistance militaire à des groupes rebelles et affronte la Russie avec plus que des discours. » Cependant, dans le vrai « monde réel », l’administration Obama a fait passer des équipements militaires aux rebelles cherchant à renverser un gouvernement internationalement reconnu depuis des années. Cette aide a évité de faire apparaître aux yeux des Américains le fait que beaucoup de ces groupes rebelles collaboraient avec le Front al-Nosra d’al-Qaïda et/ou l’État Islamique. 
Le président iranien Hassan Rouhani (à gauche) serre la main du président russe Vladimir Poutine au sommet de l’Organisation de Coopération de Shanghai dans la capitale kirghize de Bishkek, le 13 septembre 2013. (Crédit photo : Press TV) Comme l’expert du Moyen-Orient Gareth Porter l’a rapporté, “Les frappes aériennes russes en question ont pour ambition de séparer la ville d’Alep, qui est à l’heure actuelle le principal centre de pouvoir d’al-Nosra en Syrie, de la frontière turque. Pour réussir, les forces russes, syriennes et iraniennes ont attaqué les troupes rebelles déployées dans les villes se situant le long des routes d’Alep jusqu’à la frontière. Ces rebelles comprennent des unités d’al-Nosra, de leurs proches alliés d’Ahrar al-Sham et d’autres groupes d’opposition armés – certains d’entre eux avaient reçu des armes de la CIA dans le passé… “Selon de nombreuses sources, y compris de certaines qui ont été explicitement soutenues par les États-Unis, il est clair que toute unité organisationnelle anti-Assad armée dans ces provinces est engagée dans une structure militaire contrôlée par des militants d’al-Nosra. Tous ces groupes rebelles se battent au côté du Front al-Nosra et coordonnent leurs actions militaires avec lui.” Mais le Washington Post et ses acolytes grand public américains ne veulent pas que vous connaissiez la réalité du “monde réel” qui est que les saints rebelles “modérés” de Syrie combattent côte à côte avec al-Qaïda, qui fut responsable de la mort de près de 3 000 Américains lors du 11-Septembre et de la participation de l’armée américaine dans une série de conflits au Moyen-Orient qui ont coûté la vie à environ 8 000 soldats américains. L’étrange objectif de sauver la peau d’al-Qaïda ne serait certainement pas un bon argument de vente pour obtenir le soutien du peuple américain à une nouvelle guerre, qui pourrait opposer l’arme nucléaire russe à l’arme nucléaire américaine, avec toutes les horreurs qu’un tel conflit pourrait entraîner. Toutefois, la gênante vérité sur le rôle d’al-Qaïda se glisse occasionnellement dans les médias grand public, quoique seulement en passant. Par exemple, la correspondante du New York Times Anne Barnard a rapporté samedi dernier qu’un cessez-le-feu avait été proposé en Syrie, en écrivant : “Avec la condition que le Front al-Nosra, la branche d’al-Qaïda en Syrie, puisse être encore bombardé, la Russie met les États-Unis dans une position difficile ; les groupes d’insurgés qu’ils soutiennent coopèrent en certains endroits avec la bien armée et bien financée Nosra dans ce qu’ils appellent une alliance tactique par nécessité contre les forces du gouvernement.” Le dilemme d’Obama Donc, le dilemme auquel Obama fait face est de savoir si les États-Unis devraient se joindre à la Turquie et à l’Arabie saoudite dans une flagrante invasion de la Syrie pour sauver la cause d’al-Qaïda. Bien sûr, ce n’est pas comme cela que ce serait vendu au peuple américain. Le projet serait formulé avec de jolis mots sur “l’humanitarisme” et le besoin de maintenir la “crédibilité” américaine. Mais Obama semble suffisamment se rendre compte de la réalité actuelle pour résister jusqu’ici aux appels frénétiques des néoconservateurs et des faucons de Washington. Je me suis dit également qu’Obama avait découragé la Turquie et l’Arabie saoudite de prendre les choses en main eux-mêmes. Après tout, une invasion à grande échelle par la Turquie et l’Arabie saoudite en soutien d’al-Qaïda et d’autres rebelles sunnites opposerait la force d’envahisseurs non seulement à l’armée syrienne mais à ses alliés l’Iran et le Hezbollah (chiite) – et plus dangereusement à la Russie, qui manque d’effectifs à l’intérieur de la Syrie pour être au niveau de l’armée turque, mais pourrait déployer des armes nucléaires tactiques, si nécessaire, pour sauver la vie de soldats russes. Voici donc les différences significatives entre Obama et l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton. Elle a publiquement appelé l’armée des États-Unis à établir une « zone de sécurité » à l’intérieur de la Syrie, ainsi qu’une zone d’exclusion aérienne. Même si tout cela a l’air joli et paisible, cela exigerait en fait la même invasion que la Turquie recherche et exigerait que la force aérienne des États-Unis élimine la plupart des forces aériennes et des défenses antiaériennes syriennes. Ce serait un acte de guerre majeur. 
La secrétaire d’État Hillary Clinton et le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov. (Crédit photo : Département d’État) Mardi, lors d’une conférence de presse Obama a été a interrogé sur le conflit syrien mais c’était dans le cadre typique grand public insinuant que Obama est trop faible pour traiter avec Poutine. Durant cinq ans, les médias grand public des États-Unis n’ont pas pu aller plus loin qu’inciter Obama à accroître l’intervention des États-Unis en Syrie et ainsi apporter un autre « changement de régime ». Malgré la preuve du contraire, une illusion chère à Washington demeure que quelques opposants « modérés » pourraient remplacer Assad et apporter une heureuse démocratie à la Syrie. De similaires illusions ont précédé les catastrophes des « changements de régime » en Irak et en Libye – et l’on pourrait même revenir sur l’objectif de l’administration Reagan de « changer de régime » en Afghanistan qui a conduit à l’émergence des Talibans, d’al-Qaïda et, en premier lieu, du djihadisme moderne. Mais aujourd’hui les enjeux incluent un risque potentiel de confrontation nucléaire avec la Russie – les États-Unis étant exhortés à se charger du risque existentiel pour toute l’humanité au nom de la préservation des espoirs d’al-Qaïda de hisser son drapeau noir sur Damas. Il est difficile d’imaginer une exigence plus folle de la part des acteurs principaux de la politique étrangère dans les hautes sphères de Washington. [Pour aller plus loin sur le sujet, voir sur Consortiumnews.com "Tangled Threads of US False Narratives," "Hidden Origins of Syria’s Civil War," et "Obama’s Most Momentous Decision."] Source : Consortiumnews.com, le 18/02/2016 Traduit par les lecteurs du site www.les-crises.fr. Traduction librement reproductible en intégralité, en citant la source. |