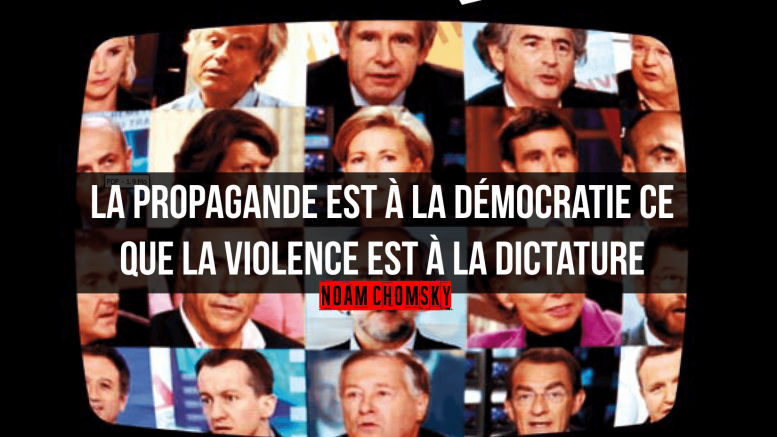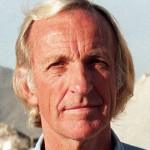1916: la bataille de Verdun, symbole de la guerre
| Source : Christophe Barbier, pour L’Express, le 13 janvier 2016.
Bataille de Verdun: Français et Allemands se disputent quelques kilomètres, entre février et novembre 1916, au prix de 750000 tués ou blessés environ.Si la bataille de la Somme fut aussi importante et plus meurtrière, c’est le combat livré pour défendre Verdun qui entre dans l’Histoire, jusqu’à devenir la métaphore même de la guerre. Ces trois cents jours d’enfer dominent le mitan d’un premier conflit mondial dont L’Express poursuit le récit. La bataille de Verdun aurait pu s’appeler la bataille de Belfort. Et les noms de Douaumont, de Vaux ou du bois des Caures être remplacés, dans la mémoire nationale, par ceux de Cravanche, Châtenois-les-Forges et du mont Salbert. En effet, le commandement allemand hésite longuement, à la fin de 1915, entre ces deux cibles qui possèdent la même caractéristique: pour des raisons symboliques (la rive droite de la Meuse à Verdun, la résistance de Denfert-Rochereau à Belfort) autant que tactiques, la France ne peut se permettre de les perdre. Dans son fameux mémorandum de Noël, remis au Kaiser, Erich von Falkenhayn, le généralissime allemand, ne cite ni l’un ni l’autre, mais évoque ces “objectifs pour la conservation desquels le commandement français est obligé d’employer jusqu’à son dernier homme”. Formulée ex post par un militaire cherchant à minorer son échec, et fort contestée depuis, la thèse demeure intéressante: à Verdun, il s’agit de “saigner la France”, d’ouvrir sur son flanc une plaie béante par laquelle tant de vies s’écouleront que la reddition tricolore sera inévitable. Au grand quartier général de Chantilly, Joseph Joffre ne croit pas à cette stratégie, persuadé que Verdun est une diversion avant une attaque majeure ailleurs, et déterminé à ne pas se distraire de son ambition principale pour 1916: l’offensive franco-britannique majeure prévue dans la Somme au début de l’été.
En dix mois, 70 des 95 divisions françaises sont envoyées sur le front de Verdunvia la route, partant de Bar-le-Duc, qui sera baptisée “Voie sacrée” par Maurice Barrès.Il lui faut pourtant vite reconnaître, dès que les canons écrabouillent sous les obus les alentours de Verdun, le 21 février, qu’il va se jouer là un épisode majeur du conflit. Verdun, c’est “la guerre dans la guerre”, comme le dit Paul Valéry. Verdun, c’est aussi la “métaphore de la guerre”, selon l’expression de Jean-Yves Le Naour, auteur d’une indispensable somme consacrée à 14-18 (1). Verdun, c’est encore le modèle de l'”hyperbataille”, concept forgé par un autre historien, François Cochet, et qui mêle l’ampleur matérielle d’une attaque à ses ravages humains. Verdun, c’est enfin la mémoire collective, française d’abord, puis universelle après l’apparition, main dans la main sur le site, en septembre 1984, de François Mitterrand et de Helmut Kohl. Verdun, vu depuis 2016, résume 14-18; vu depuis 1916, Verdun résume l’enfer. Dix mois de combats à Verdun, moins de vingt-quatre heures à AusterlitzFrançois Cochet le note dans La Grande Guerre (Perrin): 11824 référencements sont consacrés à Verdun dans le fonds bibliographique Gallica… Suprématie frappée du sceau du symbole, et néanmoins injuste, car la bataille de la Somme, la même année, est tout aussi importante et plus meurtrière. Verdun, c’est un front d’à peine 20 kilomètres, mais sur ces arpents, six obus tombent pour chaque mètre carré de terre entre février et décembre – sanglant labourage. A ce roulement meurtrier s’oppose la rotation des effectifs, qui en dix mois fait passer par ces lignes 70 divisions sur les 95 de l’armée française, afin d’y engager des troupes toujours fraîches, grâce à la fameuse “noria” de camions qui emprunte la “Voie sacrée” célébrée ensuite par Maurice Barrès. La première caractéristique d’une hyperbataille est sa durée: dix mois pour Verdun, la moitié pour la Somme, quand Austerlitz ou Waterloo se conclurent en moins de vingt-quatre heures. La seule hyperbataille courte en 1916 est celle du Jutland, parce qu’elle est navale: 103 bâtiments allemands commandés par l’amiral Scheer affrontent, le 31 mai, les 151 unités de la flotte britannique de l’amiral Jellicoe. Mais la brièveté n’empêche pas la violence (2551 tués côté Reich, 6094 côté Royaume-Uni) et crée l’incertitude, car on ne sait pas vraiment qui sort vainqueur de ce choc. L’hyperbataille, c’est d’abord une affaire de matériel: le jour du déclenchement de Verdun, les Allemands ont amassé 3 millions d’obus face à leur cible – contre 15000 en stock dans les lignes françaises. La France disposait en 1915 de 1100 canons sur les 25 kilomètres de front pour l’offensive de Champagne, l’Allemagne en aligne 1500 sur 10 kilomètres à Verdun. Et dans la Somme, les Alliés mettent en batterie, du 24 au 28 juin, un canon tous les 18 mètres, pour jeter en quatre jours 2 millions d’obus sur les troupes du Kaiser.
Verdun en ruines (photo non datée). Le 21 février, aux premières heures de la bataille, 1300 obusiers allemands pilonnent le front en vue de prendre la ville.Mais, autant les Français n’ont guère anticipé l’attaque allemande à Verdun, autant les Allemands se préparent dans la Somme, en bâtissant les Stollen, abris de béton enfouis jusqu’à 10 mètres sous la surface, d’où ils sortent avec leurs mitrailleuses, sourds mais aptes au combat, pour faucher des tommies qui s’avancent au pas, benêts, pensant que toute vie a été effacée devant eux. L’hyperbataille, c’est la quantité de matériels, qu’illustre une fameuse “liste de courses” de Ferdinand Foch, avant la Somme, où l’on trouve 2,5 millions de grenades ou encore 3200 téléphones avec leurs 13200 kilomètres de câbles; mais c’est aussi la “qualité”, c’est-à-dire l’innovation. En 1916, les airs deviennent un champ de bataille décisif: le 29 janvier, les zeppelins, volant très haut, gagnent sans encombre Paris pour y jeter des bombes; aux premiers jours de Verdun, les chasseurs allemands se relaient pour que les avions ennemis ne puissent venir repérer les batteries qui tonnent et guider la riposte d’artillerie. La France se met vite à la hauteur, avec des avions plus légers, qui volent à 162 kilomètres/heure et dont les mitrailleuses tirent entre les pales des hélices – dans la Somme, le ciel est totalement franco-britannique. Le progrès est aussi au sol, avec l’apparition côté allemand du terrifiant Flammenwerfer, un lance-flammes qui grille à 15 mètres des soldats attendant, baïonnette au canon, l’assaut de leur tranchée, et, côté britannique, le surgissement stupéfiant, le 15 septembre à l’aube, des premiers chars d’assaut. Armés de canons quand ils sont dits “mâles” et de mitrailleuses dans leur version “femelle”, 36 chars de 30 tonnes chacun ont été acheminés de nuit pour créer la surprise. Elle est complète, qui amène les commentateurs à évoquer des “châteaux roulants” ou le retour des éléphants d’Hannibal. Mais les chars sont trop peu nombreux pour emporter seuls la victoire, leurs chenilles se bloquent parfois et le “marmitage” ennemi, alors, les détruit. “Verdun, une bataille politique”L’hyperbataille demeure donc une affaire d’hommes, tels les chasseurs du lieutenant-colonel Driant, massacrés le 21 février en défendant le bois des Caures: ils reçoivent trois obus par seconde de 7 heures à 16 heures, qui tuent 75% d’entre eux, mais les 350 survivants stoppent 10000 fantassins allemands pendant deux jours. Il y a aussi les soldats qui montent sur leur dos de quoi installer un téléphérique sur l’Isonzo, théâtre de nombreux combats entre Italiens et Austro-hongrois. Il y a enfin tous ceux qui servent de chair à canon, broyés par les obus en “défensive” ou hachés par les mitrailleuses lors des offensives.
Côté “boche”, 337 000 soldats sont tués ou blessés à Verdun.Au cours du bloodiest day, le 1er juillet, les Britanniques perdent, selon les sources, entre 40000 et 60000 hommes, tués ou blessés, dont 30000 tombés en six minutes! Pour François Cochet, même si les calculs s’entrechoquent dans les grimoires comme les soldats sur le terrain, on peut estimer à 1312856 les hommes mis hors de combat dans la Somme. Quant à Verdun, les chiffres s’élèvent à près de 750000… Ces soldats ne tombent pas sans raison: des chefs les envoient se battre dans la boue. Jean-Yves Le Naour a ainsi raison d’intituler l’un de ses chapitres “Verdun, une bataille politique”. Tout au long de l’année 1916, le conflit dégénère entre la Chambre et le GQG, c’est-à-dire entre les parlementaires (mais aussi l’exécutif) et le généralissime Joffre. On le voit dès le 1er janvier, quand le président de la République, Raymond Poincaré, veut aller visiter la place de Verdun, qu’on lui dit “stratégique”: Joffre l’en dissuade. Une fois la bataille enclenchée, Poincaré se rend à six reprises, dans l’année, sur les arrières du champ de bataille. Perdre Verdun serait, dit-on à Paris, une “catastrophe parlementaire”, c’est-à-dire que le gouvernement, dirigé par Aristide Briand, n’y survivrait pas – et que peut-être le régime lui-même serait mis à bas pour que les militaires commandent vraiment… Verdun, c’est donc le nouveau Valmy dans les discours, mais dans les couloirs du pouvoir, le prétexte à toutes les manigances. On joue Castelnau contre Joffre, Nivelle contre Pétain… Tous les jours, Georges Clemenceau lâche ses coups dans son journal, L’Homme enchaîné. Le 16 juin commence le “comité secret”, des séances parlementaires à huis clos, mais Briand retourne la situation et le quotidien Excelsior, à sa Une du 10 juillet, le représente foulant une peau de tigre… Néanmoins, il a compris qu’il ne pourrait durer vraiment qu’en sacrifiant Joffre. Dès le 14 février, le rapport du sénateur Charles Humbert accable l’homme de Chantilly: “Ce pays va à sa perte si on ne change pas les hommes.” Le général Gallieni, sauveur de Paris nommé ministre de la Guerre, s’use en affrontements avec Chantilly, et finit par remettre en Conseil des ministres, le 7 mars, une note accablante que nul ou presque ne veut prendre en main et dont Briand niera longtemps l’existence. Malade de la vessie – en fait, atteint d’un cancer de la prostate qui l’emporte le 27 mai -, Gallieni démissionne le 10 mars. “Moi, du moins, j’ai essayé d’être ministre de la Guerre”, plaide-t-il. Et Briand réplique, cynique: “Veni, vidi, vessie…” Pendant ce temps, les poilus tombent par milliers… Ce que Gallieni ni Clemenceau n’ont décroché, le sang va l’obtenir: la tête de Joffre. Même si le fort de Douaumont est repris le 24octobre, même si la bataille de Verdun est jugée officiellement gagnée le 19 décembre, trop de vies ont été perdues pour trop peu de gains: le retour aux lignes du début de 1916 dans la Meuse, une dizaine de kilomètres de progression dans la Somme.
Dans les rangs français, Verdun a fait 362 000 victimes.Le 3 décembre, Briand propose à Joffre d’être nommé maréchal de France et installé à Paris en un commandement suprême chargé de coordonner les visées du gouvernement et celles des armées. Le généralissime accepte, mais constate vite qu’on lui refuse l’état-major promis, qu’il n’a pas même de bureau au ministère et doit s’installer dans une pièce vide de l’Ecole militaire… dont il paie le chauffage! Raymond Poincaré lui remet son bâton de maréchal à la sauvette, sans cérémonie, et indique ainsi sa véritable affectation à celui qui semblait indéboulonnable un an plus tôt: la retraite… Pourtant, 1916 aurait pu être l’année de la paixLa politique est tout aussi retorse loin de France. Même si le courageux Broussilov attaque les troupes de Vienne le 4 juin, pour fixer l’ennemi sur place avant l’offensive de la Somme, la Russie n’envoie que 50000 soldats à l’Ouest, sur les 400000 réclamés. De même, quand la Roumanie attaque la Hongrie, le 28 août, les Alliés ne tiennent aucun de leurs engagements: l’armée d’Orient n’avance pas, pas plus que les Russes, pour aider Bucarest. Quand la Bulgarie pénètre en Roumanie, la situation se retourne et les Austro-Hongrois prennent Bucarest le 6 décembre… Pourtant, 1916 aurait pu être l’année de la paix. Pas tant celle rêvée par les militants pacifistes de la conférence de Kienthal, en Suisse, où apparaissent “à titre personnel” trois députés français, que celle proposée subitement, le 12 décembre, par le chancelier allemand Bethmann-Hollweg. Las! En cette offre imprécise Français et Britanniques voient un piège: l’Allemagne veut juste reprendre son souffle après une année terrible. Même les Etats-Unis, qui ont tenté depuis plusieurs mois de faire cesser les hostilités, se résignent, conscients que la guerre sous-marine, bientôt relancée par Berlin, les contraindra à entrer en guerre dès qu’un navire américain sera frappé. Le conflit durait depuis dix-sept mois quand 1916 s’est ouverte, il va en durer encore vingt-deux quand 1916 se clôt. L’Allemagne n’a pas saigné la France à Verdun, pas plus que le “On les aura!” lancé le 10 avril, dans une note à ses troupes, par le général Pétain, n’a été vraiment couronné de succès. Le 21 novembre 1916, Aristide Briand demande le recensement de la classe 18, en vue de son appel anticipé sous les drapeaux. Le massacre continue… (1) 1916. L’enfer, par Jean-Yves Le Naour. Perrin, 376p., 23€.
Première Guerre Mondiale : 1916, L’enfer de Verdun – Documentaire complet |